Philosophe allemand spécialiste d’esthétique et de musique, Harry Lehmann voit ce livre, synthèse de nombre de ses recherches, traduit en français par les éditions Allia dans le cadre de leur série consacrée à la musique relevant de ce qu’on appelle le « classique contemporain ». Extrêmement ambitieux dans sa démarche et ses prises de position, La révolution digitale dans la musique pourrait combler une lacune grave dans la littérature consacrée à la question des bouleversements causés par le numérique dans la musique, sujet dont l’intérêt semble concerner un large public. Pourtant, l’ouvrage est loin de convaincre, mais peut permettre d’interroger à gros traits une certaine pensée musicale et esthétique actuelle dont il est un témoin.
Harry Lehmann, La révolution digitale dans la musique. Une philosophie de la musique. Trad. de l’allemand par Martin Kaltenecker. Allia, 224 p., 17 €
Le désir souverain de définir le numérique – ici, le digital – comme révolutionnaire par nature a dépassé chez nombre d’auteurs le simple effet de mode, touchant désormais à la pulsion irraisonnée et, ce qui est plus déraisonnable, inquestionnée. Harry Lehmann, dans La révolution digitale dans la musique, s’empare de la question pour la musique savante contemporaine, dans une démarche plus qu’ambitieuse, qui suscitait avant la lecture une certaine attraction tant le sujet est pris en charge de façon topique dans l’ignorance généralisée et l’irréflexion systématique, et mérite qu’on en balise une meilleure intelligence.
L’ambition intellectuelle du philosophe allemand ne masque pas une certaine hybris, revendiquant d’entrelacer l’enquête sociologique, économique, musicologique, historique, à un propos qui se dit essentiellement philosophique. D’où la collection de vingt-et-un chapitres très disparates, explorant l’hypothèse de travail de l’auteur : les possibilités offertes au monde de la musique par les nouvelles technologies digitales et numériques y occasionnent une révolution, sous les termes plus précis d’une « désinstitutionnalisation et d’une démocratisation de la musique contemporaine ». Suivant ce cahier des charges, Lehmann se fait sociologue pour analyser le milieu de l’édition musicale, des conservatoires ou des orchestres ; historien et organologue dans son histoire succincte de la notation ou de l’instrumentation savante occidentale, polémiste et musicologue quant aux théories et philosophies de la musique depuis le XIXe siècle, etc. Chaque chapitre vise alors à démontrer l’hypothèse de départ, qui est la rupture majeure dans cette histoire que constitue l’innovation technologique du numérique dont le seul exemple comparable demeure selon l’auteur celui de la notation guidonienne au XIe siècle de notre ère.
On pourrait, à l’issue de cette description hâtive, arrêter la critique à un simple constat lointainement bourdieusien, qui est que nous avons affaire à un effet de champ caractéristique : philosophe de l’avant-garde et de la modernité, Harry Lehmann cherche à tout prix à penser en pionnier une révolution qu’il a intérêt à présupposer, et la démonstration scientifique en pâtit constamment à force de percevoir dans le champ restreint de données qu’il se donne la confirmation de ses postulats. Mais cette casuistique et ses paralogismes révèlent cependant les brouillages actuels, voire anciens, dans lesquels évoluent la pratique et la pensée de la musique, ou au-delà de l’ensemble de la vie artistique et intellectuelle, et méritent à ce titre que l’on s’y arrête plus longuement. Non pas pour une jouissance cruelle de critique, mais parce que ces pensées veulent dire tout, si ce n’est leurs partis pris et leurs préjugés, qui dans ce cas sont nombreux mais jamais affirmés, et que l’universalisation et la généralisation péremptoires d’opinions personnelles soumises au débat, à propos même d’un sujet « léger » comme la musique, imposent certains contrepoints.
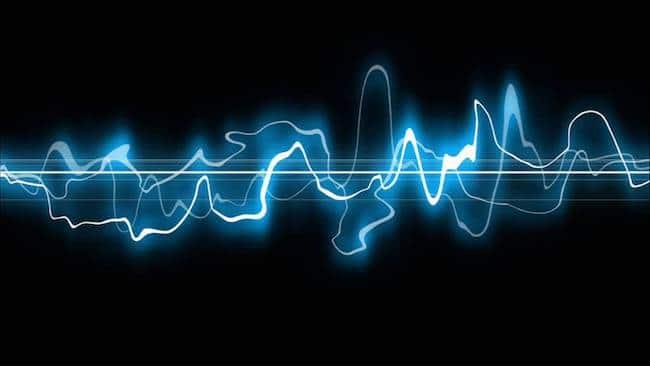
Harry Lehmann prend de nombreuses précautions liminaires pour définir ses objets et sa terminologie, en la resituant dans les débats scientifiques auxquels il participe. Il ne semble pourtant pas donner les moyens de situer son œuvre là où elle réside cependant. Par ses références et ses démarches intellectuelles, l’ouvrage s’inscrit en effet centralement au sein de deux traditions qu’on peut sans trop manquer de nuance qualifier d’allemandes : la première, philosophique et sociologique, est en grande partie celle de la théorie critique et de l’école de Francfort, quoiqu’on décèle çà et là de menus restes des pensées idéalistes postkantiennes, notamment lorsqu’il s’agit de traiter de Wagner. De ce point de vue, l’appareil philosophique semble souvent pris en défaut par ses propres contradictions, impropre qu’il est, face aux nuances qu’impose son objet, à s’évader de certaines antinomies arbitraires voire absurdes, du fait de ce cadre théorique discutable. L’échappatoire de l’auteur se situe bien souvent dans des affirmations à l’emporte-pièce dont on peine à trouver la justification intellectuelle : « De simple interprète, le musicien devient un artiste-performer » ; « la musique d’avant-garde se constitue sur le refus […] du système tonal », etc. Le comble de cette tradition critique revendiquée mais très confusément mise en œuvre intervient lorsque l’auteur finit, au nom des neurosciences, par réaffirmer la dimension « biologique » du Beau, fondé dans la Nature, s’opposant à ceux qui le résument à une simple dimension culturelle et feraient par là preuve d’un irénisme coupable. Si bien que, sous des dehors affichés de postmodernité mis en œuvre notamment par de nombreuses références actuelles ou passées, le propos semble indubitablement conservateur et réactionnaire, avançant par coups de force logiques et scientifiques qui trahissent certaines références pourtant revendiquées.
La seconde tradition de l’auteur est sans doute plus problématique encore, au vu de son objet d’étude, et pourrait s’exprimer schématiquement comme une réduction de la « Nouvelle Musique » (c’est-à-dire la musique classique contemporaine) à ce qu’en dit son école de pensée dominante en Allemagne, celle de Darmstadt dont Stockhausen reste le plus illustre représentant. John Cage n’est cité qu’à travers sa pièce silencieuse, Xenakis pour son intérêt pour l’électronique perçue dans une téléologie problématique comme pré-histoire du numérique, et rien n’est dit à propos de Messiaen ou de Britten, parmi tant d’autres; en parler aurait permis de ne pas affirmer que la modernité du XXe siècle s’était systématiquement opposée au tonal. Le mouvement spectral, Fluxus, la musique sérielle, sont évacués en trois lignes, car ne correspondant pas à un pendant musical du dadaïsme et du surréalisme, érigés en parangons non questionnés de la (post)-modernité artistique. La moindre des ironies n’est pas, dans ces oublis et lacunes d’un propos à visée catégorique, de se donner comme mission de rétablir une histoire que l’auteur juge « escamotée ». À l’inverse, Harry Lehmann laisse entrevoir une histoire de la musique toute personnelle, dans laquelle n’auront pas voix au chapitre l’essentiel des créateurs du XXe siècle. Certains compositeurs oubliés ou allusivement traités (Charles Ives ou Conlon Nancarrow, ainsi que de nombreux jazzmen) auraient par ailleurs permis d’être plus circonspect face à l’innovation et l’ouverture des possibles permises par la robotique, l’informatique et le numérique.
Le propos sociologique s’effondre dès lors souvent de lui-même face aux contradictions internes du discours, et ne fera pas oublier de sitôt les analyses d’Howard Becker, de Bourdieu, ou plus récemment de Nathalie Heinich. Voulant à tout prix, par exemple, démontrer la démocratisation de ces musiques, l’auteur réduit à néant en un tournemain subventions, conservatoires, orchestres publics, jusqu’aux professions même d’interprète ou de compositeur qui subissent dans le propos une révolution radicale qu’une simple promenade dans les conservatoires et lieux de concert suffit à infirmer pour le présent, et à nuancer pour l’avenir. Car, maltraitant souvent l’histoire (l’évolution du plain-chant, réduite au seul grégorien, est au bas mot très approximative et passe sous silence tous les apports récents de la musicologie médiévale et renaissante [1]), Harry Lehmann se fait aussi à de nombreuses reprises haruspice peu précautionneux d’un avenir tout tracé. Ainsi, « les compositions par échantillons de […] Takasugi nous permettent d’entrevoir ce que seront à l’avenir des œuvres authentiquement conçues pour échantillonneur » ; « Grâce à la numérisation du processus de composition, le talent spécifique d’instrumentiste […] ne sera plus nécessaire ». Étrange futurologie, qui reste coupable de se présenter sous des atours scientifiques et rigoureux pouvant duper un public non averti.
Car c’est bien là ce qui pose problème. L’ouvrage, comme de nombreux autres, se pare d’une superficielle aura de légitimité dans le ton et le langage choisis, dans le pouvoir des maisons d’édition et structures universitaires qui accueillent son auteur, aussi dans les fausses évidences empiriques d’un propos qui conclut souvent au bon sens pour appuyer son argumentaire. Il participe ainsi à véhiculer des cadres de pensée extrêmement problématiques à bien des égards, et dont on retiendra trois exemples saillants parmi d’autres. Tout d’abord, le topos de la révolution numérique, dont on ne nie bien sûr pas la réalité, mais qui a fait l’objet ces dernières années d’une gargantuesque littérature économique, historique, critique, etc. en nuançant largement la portée, et qu’on juge de plus en plus mineure par rapport aux révolutions industrielles précédentes. Surtout, la notion traduit une compréhension quasi sacrale de la technique, deus ex machina plus ou moins an-historique face auquel les individus et les sociétés seraient impuissants. Il aurait été plus intéressant, sans doute, de montrer comment les nouvelles technologies créent de nouveaux rapports de force entre les acteurs du monde musical. Par exemple, l’enjeu des différents formats de la musique numérique oppose de nombreux acteurs, notamment les partisans d’un compressage désastreux (notamment le MP3) qui, malgré ses atouts économiques, a déjà bouleversé les capacités auditives d’une génération, face à un groupement disparate de militants de l’internet libre, de musiciens et producteurs indépendants, qui défend des formats plus respectueux du son. Au risque de paraître naïf, les nouvelles technologies sont elles aussi des outils entre les mains des acteurs, non des pouvoirs transcendants s’imposant aux mortels – mais on ne peut qu’indiquer les penseurs s’étant intéressés à ces questions, Simondon en tête pour les plus récents, si peu audibles face à une certaine hébétude devant le numérique.

Autre difficulté posée par Harry Lehmann à nos yeux, la conception historique et culturelle que sous-tend son propos. Il suffirait d’introduire dans cette réflexion sur la musique les traditions classiques indiennes, chinoises ou arabes, ou encore l’ensemble des musiques populaires du monde entier, pour faire exploser ce schéma décidément très restreint. Ce dernier, frappé encore une fois au sceau d’une certaine postmodernité fort dogmatique, ne cesse de présupposer un progrès historique des arts qu’exemplifie la tentative peu convaincante de déconstruction du concept d’avant-garde dans l’ouvrage. Cette conception, que nombre de postmodernes permettent pourtant depuis longtemps de dépasser, présuppose implicitement une hiérarchie des œuvres et des arts, autre nom de l’académisme, très explicite dans le désintérêt pour toute autre musique que celles évoquées par l’auteur, qui force à penser au conservatisme d’Adorno à propos du jazz. Dans cette perspective, cet ouvrage propose à son tour plutôt une contre-révolution sous un discours présenté comme moderniste, dans la lignée de nombreuses autres théories esthétiques récentes, y compris pour d’autres arts, comme l’a démontré Rainer Rochlitz (« La querelle de l’art contemporain », dans Feu la critique).
Enfin, Harry Lehmann formule une pensée de la musique et de l’art fort critiquable, articulée bien souvent autour d’un conservatisme naturaliste déjà évoqué, et d’une tentative de réintroduction d’une axiologie dommageable. En effet, tout en niant la notion contemporaine du Beau chez de nombreux musiciens, il affirme, grâce à une interprétation caricaturale et décontextualisée des mouvements surréalistes et dadaïstes, une primauté nouvelle des « valeurs » esthétiques dans la compréhension de l’art. Cela est d’autant plus regrettable que l’histoire de l’art du dernier siècle a pu radicalement annihiler cette question, qui mérite dès lors un travail plus sérieux d’approfondissement.
Pour toutes ces raisons, la traduction en français de cet ouvrage permet d’établir quelques jalons en même temps qu’elle invite à s’interroger à propos d’un certain état de la pensée critique, musicale en particulier, artistique et intellectuelle en général. Ces jalons sont d’abord ceux d’une stricte vigilance par rapport à un état du débat esthétique dans lequel la complexité des enjeux et la spécialisation des acteurs permettent une grande porosité entre nos catégories souvent obsolètes de pensée : comment comprendre un ouvrage qui, après tant d’autres, se prétend ultra-contemporain ou postmoderne lorsqu’il promeut des pensées si facilement assimilables à un conservatisme réel ? Comment réagir face à un ordre du discours de part en part critiquable dans sa mise en œuvre, mais qui fait écho aux fausses évidences qui le valident hâtivement dans une opinion publique mouvante ? Plus que l’angoisse face à une vogue réactionnaire actuelle bien établie et subvertissant pensées et discours dans un trouble parfois peu lisible, c’est par cette invitation au travail et à la création artistique et scientifique qu’il faut recevoir cet ouvrage d’un intérêt intrinsèque contestable, ainsi que par la certitude que musiciens et penseurs sauront, comme ils le font déjà, apporter un démenti à certaines des affirmations consignées ici. Plus largement, il invite, après de nombreux penseurs auxquels Lehmann fait peu référence, à délaisser au maximum les miroirs aux alouettes des quêtes de « révolutions », pour considérer que le plus fascinant des sciences et arts de l’homme réside dans ce qui, comme disait Gide, permane, et qui est le profond.
-
Le travail récent de Philippe Canguilhem sur l’improvisation polyphonique à la Renaissance synthétise nombre de ces apports, et permet par exemple d’invalider ou de relativiser les catégories historiques choisis par Harry Lehmann, voulant que la musique religieuse médiévale ait privilégié la monodie pour des raisons d’abord technologiques et techniques.












