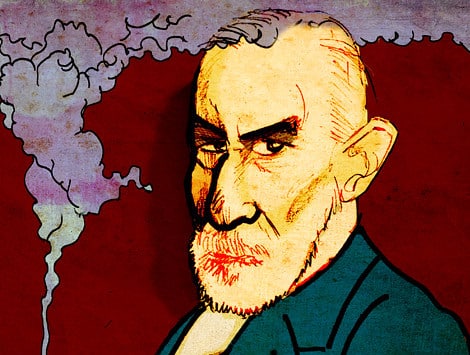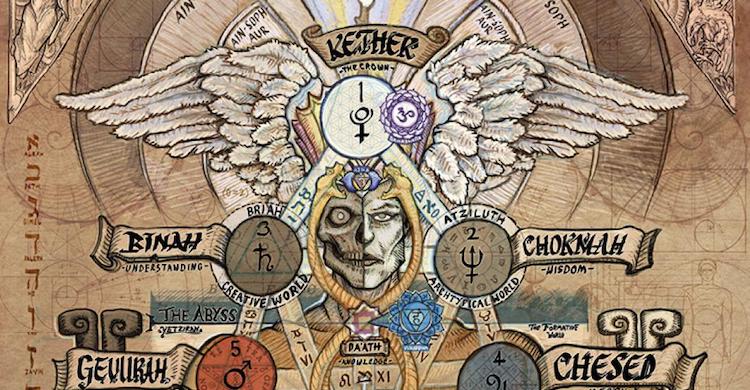Au terme de « pastiche », contre lequel Diderot disait être « bien fâché » du fait de sa connotation péjorative, on préférera la locution prépositive « à la manière de » pour qualifier la correspondance inattendue entre Freud et Spinoza que nous propose Michel Juffé.
Michel Juffé, Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza : Correspondance 1676-1938, Gallimard, coll. Connaissance de l’inconscient, 315 p., 24,50 €
Michel Juffé, philosophe qui connaît aussi bien l’œuvre de Freud que celle de Spinoza, nous fait croire un instant, avec la complicité de son éditeur et de son directeur de collection, à la découverte d’une correspondance inédite entre l’inventeur de la psychanalyse et ce philosophe d’Amsterdam, descendant de Juifs espagnols passés par le Portugal, victime d’un herem, proscrit donc de sa communauté, Benedictus, dit Baruch, Spinoza, né en 1632, mort en février 1677, soit un mois après sa dernière lettre au Viennois.
Au long d’un échange épistolaire d’une rare densité – ni le courrier électronique ni les transports aériens n’existaient alors et le temps ne faisait pas défaut –, ils s’écrivent seize lettres étalées sur une année alors que la fin de leur vie approche. On ne dira pas ici, et pour cause, où ni comment ils se sont rencontrés ; on sait seulement que le psychanalyste, toujours méfiant (c’était aussi un trait de caractère du Hollandais) à l’égard des philosophes – il le fut, par exemple, vis-à-vis de Nietzsche –, ne se mit à lire de manière sérieuse Spinoza, l’Éthique notamment, que sur la recommandation de son ami Romain Rolland à qui il avait confié être en train d’écrire « une série de textes sur Moïse », lesquels seront publiés quelque temps plus tard, en 1939, l’année de sa mort.
Comme il est normal, ces échanges vont crescendo au fil des mois : courtes lettres les premières semaines, qui débutent alors par du « Très honoré Maître » et du « Cher Monsieur le Professeur », puis longues missives ornées de « Très cher ami » et autres « Très cher Sigmund », véritables synthèses philosophiques et psychanalytiques, truffées de considérations politiques – sur le nazisme et Hitler ; sur les mésaventures de Johan de Witt, ce leader républicain progressiste admiré de Spinoza, assassiné en 1672 après l’invasion des Pays-Bas par les troupes de Louis XIV – et de tableaux familiaux et généalogiques sous-tendus de considérations œdipiennes qui ne masquent pas les difficultés de Freud confronté à l’univers féminin, ce que Spinoza lui fait observer sans détour en parlant de ce qu’il ne cache que peu ou mal, à savoir « qu’il en pense le plus grand bien [des femmes] à condition qu’elles [lui] restent subordonnées ».
Mais n’allons pas trop vite ; à se plonger ainsi dans de multiples raisonnements de haute volée, dans les anecdotes, les rêves et les états de santé, on en vient rapidement, et ce n’est pas le moindre des tours de force de Michel Juffé, à oublier que, pour être parfaitement plausible, plus que vraisemblable, rigoureusement étayé de citations et de références, ce dialogue épistolaire est de part en part fictif, ce que l’auteur se garde bien de perdre de vue, en se livrant au contraire à une sorte de surenchère lorsqu’il précise, par exemple, dans une note page 210, que Freud, entretenant son correspondant de la situation européenne à la fin des années trente, « oublie que les notions : communisme, bolchevisme, socialisme, soviet, etc., ne peuvent être connues de Spinoza ». En évoquant ce trait d’humour parfaitement intégré à l’entreprise au point de lui conférer un surcroît de vérité, on est conduit à préciser une donnée qui n’est pas mineure, celle qui place l’auteur comme une sorte de tiers discret entre les deux épistoliers, qui nous guide et avec qui le lecteur que nous sommes entretient des sortes d’apartés, temps de brève complicité, tel celui constitué par cette autre note, page 183, dans laquelle il nous est confié que Freud, citant une phrase de Ferenczi à propos de l’interprétation d’un rêve de Spinoza, « se garde bien de citer la suite pour ne pas risquer d’offenser Spinoza ».
On s’égarerait à ne considérer cette somme que sous l’angle d’un exercice de style qui, si brillant qu’il soit, n’apporterait que peu de chose sur le fond. En réalité, il apparaît qu’entre le philosophe, curieux de tout et peu enclin à se laisser abuser par les apparences et les légendes, désireux de toujours mieux connaître la place de l’homme dans l’univers, et l’explorateur des tréfonds de ce qu’il nomme lui-même « l’âme », il y a une passion commune s’agissant du fonctionnement de cet animal particulier qu’est l’homme, de ses modes de connaissance de la nature et de son rapport – dépendance et domination – au social.
C’est donc Freud qui prend la plume le premier pour dire à Spinoza son estime, son admiration pour sa capacité à ne pas s’en laisser conter, pour son dédain des bigots de toute espèce, et pour lui dire combien il partage l’idée qu’« il n’y a pas de lumière supérieure à la nature », qu’il n’y a pas non plus « d’autorité extérieure aux hommes », mais pour lui faire part aussi de ses réticences sur ce que le philosophe nomme « l’absolue béatitude » et plus encore sur sa référence à « l’esprit du Christ », Freud reprenant là sans le dire des assertions critiques énoncées dans L’Avenir d’une illusion, ce qu’indique Michel Juffé dans une incise qui marque ainsi d’emblée sa double posture, intérieure et extérieure, dans le dialogue qui s’engage.
Vont alors se succéder des débats marqués par l’expression de désaccords et la recherche d’une proximité sur la question de la nature de l’inconscient et de ses rapports avec l’entendement, des exposés sur l’appareil psychique, sur la place de la dimension sexuelle, point sur lequel Spinoza marquera à plusieurs reprises sa difficulté à suivre Freud quant à la prépondérance que celui-ci lui donne. La question du père, celle de la horde sauvage, le rapport aux idées darwiniennes, feront également l’objet d’âpres discussions au sein desquelles on verra Freud ne pas céder sur le fait qu’en toute culture la question d’un père « protecteur et potentiellement menaçant » se posera toujours, mais consentir à renoncer à ses « fantaisies phylogénétiques ».
Autre point de désaccord, la résistance de Spinoza à l’idée d’une pulsion de mort, qu’il juge « un être de raison, dépourvu d’existence, une divinité qui agit de manière surnaturelle ». Mais l’on sait aussi que cette résistance-là sera amplement développée ensuite jusque dans les rangs du mouvement psychanalytique – ce encore aujourd’hui. Les deux correspondants aborderont avec la même verve la question du peuple juif, se trouvant globalement d’accord pour mettre en cause sa prétendue supériorité mais Spinoza se montrant, en chaque occasion, encore plus radical que Freud, comme en témoigne cette observation parmi d’autres : « croire qu’ils [les juifs] attirent spécialement les malheurs est aussi une des illusions propres à notre peuple. Et parfois vous y tombez ! ».
Questions de psychanalyse, bien sûr ; et ce long dialogue a ceci de remarquable que, bien loin d’énumérer les poncifs d’une sorte de vulgate psychanalytique, il apparaît comme le paradigme de toute discussion honnête entre un intellectuel qui résiste aux idées maîtresses de la psychanalyse tout en les respectant et un analyste s’efforçant, non de convaincre, mais de faire entendre ce que Freud appelait lui-même un « mode de penser » rompant avec toute forme d’imprégnation morale, qu’elle soit ou non d’essence religieuse. Mais questions d’histoire, aussi bien, et notamment celle du mouvement psychanalytique ; sur ce point, discret mais passionnant, Michel Juffé prête à Freud des propos dont on se prend à regretter qu’ils ne soient qu’apocryphes : « Mes élèves ont peu ajouté sur l’essentiel et ont plutôt brodé dans le détail ; mais comme je tenais beaucoup à mon œuvre, la « cause freudienne », j’ai élagué tout ce qui pouvait diverger de ma doctrine autant par crainte qu’elle ne soit détruite […] que par une sorte de jalousie infantile […] Je me reconnais ainsi une certaine ressemblance avec ce père primitif qui empêche ses enfants de se reproduire, c’est-à-dire de faire des enfants dont je ne suis pas le père ». L’actualité de ce propos n’est pas à souligner, et il n’est pas interdit de penser que Michel Juffé alias Freud s’adresse aux analystes d’aujourd’hui sur l’air d’un « à bon entendeur salut ».
En cela, ce constat quelque peu désabusé entre en concordance avec ces ultimes mots de Spinoza répondant à Freud qui lui avait dit, en post-scriptum de sa dernière lettre, reconnaître qu’il s’était livré à lui comme à un analyste : « plutôt qu’adieu je préfère vous dire : à notre éternelle amitié ».
Reconnaissance et respect de l’altérité absolue, enrichissement mutuel, passion de la recherche de la vérité, ce sont là sans doute des éléments qui peuvent contribuer à la transformation d’une relation analytique en une relation d’amitié ; c’est là un des enseignements, et non des moindres, que l’on peut tirer de ce bel ouvrage.