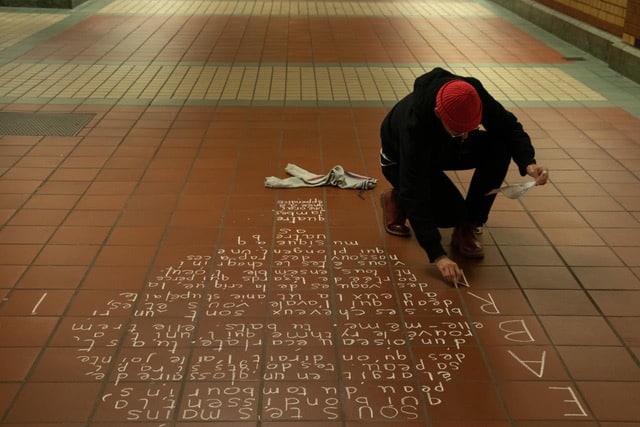Voici un roman – Mathilde Desaché s’inspire du dernier amour de Stendhal dans un couple à trois – et des problèmes inattendus : celui, posé par Isabelle Rèbre, du deuil et de la mort à propos des images photographiques, Lakis Proguidis poursuit sa réflexion sur l’art du roman en remontant de Gombrowicz à Rabelais, et les énigmes du sol à urbaniser par Hans Bernoulli.
Le cicisbeo, chevalier servant d’une noble dame, proche du patito qu’on croise dans les romans de Balzac ou de Germaine de Staël, a pour mission de l’accompagner en soirée quand son mari est absent. Selon le marquis d’Argens, toutes les dames en Italie ont leur sigisbée : « C’est ainsi qu’on appelle l’Ami de Cœur du Mari, qui se donne dans le Public pour Soupirant de la Femme. » Ce triangle affectif sert d’ouverture au Sigisbée, simple en apparence : « Ils étaient amis. Ils vous aimaient tous deux. Nous nous aimions tous les trois. »
Le roman s’inspire du dernier amour de Stendhal pour Guilia Rinieri, pupille d’un diplomate toscan, Daniele Berlinghieri, qui s’est opposé à leur mariage, trouvant Stendhal trop âgé, et sa charge récente de consul insuffisante, car il ne croyait pas à la stabilité du nouveau régime. Mathilde Desaché place Berlinghieri au croisement d’une construction ingénieuse, les lettres adressées de 1813 à 1831 par Caterina à sa fille Giulia, qui lui a été enlevée à l’âge de deux ans, et à son ami, le Signor Beyle, chargé de la retrouver. Elle y peint avec talent la Venise enchantée de sa jeunesse avant l’arrivée néfaste du général Bonaparte, son mariage avec Giovanni Querini, leur séparation quand il est nommé ambassadeur, la laissant livrée à l’autorité tyrannique du capofamiglia Andrea Querini et aux créanciers de son époux, abandonnée au seul soutien de son sigisbée, la naissance de Giulia huit mois après le retour de Giovanni.
La conduite des protagonistes, lâches, cruels, en contradiction flagrante avec les sentiments généreux que leur prête Caterina, s’éclaire au fil des pages. En miroir, invitée à lire l’ouvrage en cours du Signor Beyle, elle lui conseille d’en changer le titre, qui devrait souligner la dualité du héros avec des mots simples, par exemple « ‘Le Lys et le Chardon’, ‘Le Sucre et le Sel’, ‘Le Blanc et le Noir’… Ce serait à la fois intelligible et énigmatique. » Dominique Goy-Blanquet
Paraît enfin le très attendu deuxième volet de la trilogie annoncée sur l’art du roman de Lakis Proguidis, six ans après le premier, Rabelais, que le roman commence ! Fondateur de la revue L’Atelier du roman, Proguidis n’est pas seulement un critique, c’est un théoricien qui situe le roman au cœur de la civilisation occidentale. À ses yeux, il ne s’agit pas d’un « genre littéraire » mais d’un art à part entière.
Dans le premier volet, Proguidis pointait le passage du prologue de Pantagruel où le narrateur s’adresse aux « talvassiers », introduisant ainsi le lecteur dans le champ romanesque, une véritable révolution ontologique. Ici, il développe son idée à travers sa lecture de La pornographie de Gombrowicz, l’un des auteurs de sa trinité littéraire, à côté de Kundera et de Papadiamandis.
Ce deuxième volet, comme le précédent, se lit comme une fiction, mélangeant anecdotes personnelles et théorie littéraire. Il y aura donc encore l’incident déclencheur, ancré dans le corps propre de l’essayiste, aboutissant à une découverte fondamentale. Dans le premier livre, il s’agissait d’un fou rire qu’il associait au personnage de Ludvik de La plaisanterie. Ici, le rire est remplacé par le cri : un jour, en 1978, alors que Proguidis – embauché comme ingénieur en Iran – conduisait un pick-up sur une route désertique du Baloutchistan, il s’est subitement mis à hurler, tout seul au milieu du désert, expérience liée cette fois à sa lecture, trois jours auparavant, de La pornographie.
L’autre révélation – également corporelle – aura lieu en 1991 à Roissy, à l’aéroport Charles-de-Gaulle, lors d’une discussion avec un ami chirurgien sur la laparoscopie, méthode chirurgicale qui permet d’opérer sans ouvrir le patient, et qui annonce l’avenir des médecins-robots. De retour dans le RER, Proguidis réfléchit sur Rabelais, médecin, traducteur d’Hippocrate, et auteur de la formule : « La pratique de la médecine est un combat et une farce jouée à trois personnages, le malade, le médecin, la maladie ». Proguidis, qui depuis un an a eu l’intuition que le roman est un art autonome, trouve soudain la manière de le concevoir : « Ce n’est pas par nos notions du corps humain que nous devons aborder son être mais par sa notion du corps à lui, par le corps romanesque. » À partir de Rabelais, l’homme sera habité par des personnages romanesques, tel Ludvik, tout en faisant partie d’un corps romanesque, celui des lecteurs : « Corps romanesque : l’homo individuum doublé de lecteur de romans. C’est ce corps qui caractérise esthétiquement l’Europe des Temps modernes ». On songe au christianisme – « Nous sommes le corps du Christ » –, où les fidèles font partie du corps qu’ils ont ingéré : chez Proguidis, on pourrait dire : « Nous sommes le corps de Gargantua ».
Pourquoi cette forme artistique s’impose-t-elle à l’époque de la Renaissance ? Selon Proguidis, c’est à cette période que le « régime mimétique » – Proguidis définit la mimesis comme « l’intégration de chaque forme particulière dans un monde ordonné » – commence à se désagréger, que « le processus d’individuation connaît un formidable bond en avant ». Dans ce nouveau monde proto-capitaliste, soumis aux aléas de l’existence, il fallait un art ouvert, voué au hasard. Qui mieux que le lecteur pour apporter une dose d’aléatoire ? À vous, chers lecteurs, d’ingérer L’être et le roman. De Gombrowicz à Rabelais, et d’intégrer ainsi son corps de lecteurs. Steven Sampson

En publiant La chambre claire juste après la mort de sa mère, Roland Barthes a fondé une évidence nouvelle : désormais, il va de soi que l’image photographique a quelque chose à voir avec la mort, tout du moins avec le deuil. Du coup, le regard porté sur les représentations anciennes de personnages que l’on sait morts de longue date en est lui-même modifié. Pourtant, nous savons bien que les tableaux ou les sculptures n’étaient pas ordinairement faits pour figer un moment de la vie au moment où elle paraissait s’échapper. Nous ne les considérons comme figures du deuil que par analogie avec la photographie telle que nous la comprenons depuis Barthes.
Isabelle Rèbre fonde sa réflexion sur cette évidence nouvelle depuis un demi-siècle, avec l’idée de franchir une étape supplémentaire en posant la question du deuil à propos des images cinématographiques. Il ne s’agirait pas alors de l’image figée de quelque personne morte mais de la mort comme processus connu pour tel. Cela suppose qu’il ne s’agisse pas d’un jeu au sens d’une représentation par un acteur ou une actrice à qui aurait été commandé un rôle qu’il conviendrait de jouer le mieux possible, c’est-à-dire de la façon la plus crédible, étant entendu qu’il n’y aurait pas lieu de supposer que ce ne serait qu’un jeu.
Le personnage filmé doit être un vrai mourant, donc un malade qui se sait en phase terminale et qui a souhaité que ses derniers jours soient filmés par un cinéaste professionnel, avec une large part d’imprévisibilité, à propos certes des événements à venir, mais aussi concernant la manière de filmer et le choix des images à retenir, avec déjà cette question toute simple de savoir si et dans quelles conditions le film ainsi tourné est susceptible d’être projeté. En contactant la cinéaste Naomi Kawase pour lui proposer ce projet, le photographe condamné à court terme par son cancer fournissait déjà des éléments de réponse à de telles questions, la base pour un dialogue fructueux, qui s’est concrétisé dans « l’expérience d’accompagnement » qu’est le film La danse des souvenirs de Naomi Kawase.
Un film de deuil peut aussi être centré sur une « expérience de séparation », comme est Le répondeur ne prend pas de messages d’Alain Cavalier. Le cinéaste montre son deuil de la femme aimée et désormais disparue. La mort a eu lieu et reste la douleur. Il peut certes repeindre en noir la totalité de l’appartement dans lequel ils vivaient. Il peut aussi partir à la recherche de photos gardiennes de la trace effacée, ces photos que l’on ne va pas plus trier que ne le ferait un collectionneur comme Walter Benjamin. Mais qu’en faire pour manifester le deuil que cause cette séparation ? Elles disent le deuil non d’être des photos, mais d’apparaître dans un film, immobiles dans le royaume d’images en mouvement. Un tel film est alors en lui-même une œuvre de sépulture.
La troisième partie du livre est consacrée à une « expérience de franchissement des frontières », avec le Journal de David Perlov. Également photographe, l’auteur de ce film-fleuve de cinq heures se confronte à la mort à travers les guerres que traverse son pays, entre celle de Kippour en 1973 et celle du Liban en 1982, La peur quotidienne et la logique mortifère de ces guerres successives retentissent sur la conscience du cinéaste, qui assume la subjectivité de sa position en s’efforçant de ne pas ressasser l’idéologie ambiante célébrant le culte de l’héroïsme. Chez ce cinéaste aussi, l’insertion d’images fixes à l’intérieur d’un film est une manière efficace de dire le deuil.
Voilà donc trois approches différentes du deuil au cinéma, et donc de ce que peut être le cinéma lui-même. Exhiber la mort comme processus ou au contraire donner le deuil à ressentir dans le contraste entre images fixes et en mouvement. En étudiant ainsi le rapport entre ces films-essais et la mort, Isabelle Rèbre dit beaucoup sur la nature du cinéma lui-même, ses limites et sa force. Marc Lebiez
Hans Bernoulli (1876-1959), architecte et urbaniste suisse, avait publié cet essai en 1946 sous le titre Die Stadt und ihr Boden. La traduction en français de ce manifeste sous le même titre reste d’actualité, il s’agit de libérer les projets d’urbanisme de la contrainte de la propriété privée du sol sur lequel la ville se développe.
« Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York, c’est une ville debout. » Cette verticalité, cette érection magnifiée par Céline dans Voyage au bout de la nuit est bien partie du sol, une surface partagée, basique, fondamentale, c’est le foncier, soit les deux premières dimensions. L’essai de Hans Bernoulli s’appuie sur des cas européens, un vieux monde depuis longtemps cadastré. Cet héritage est confronté, discuté par la croissance urbaine qui s’affirme après la Seconde Guerre mondiale. Penser les villes en plan, c’est-à-dire d’abord à plat, sur la surface à bâtir….
La ville et son sol : « son » est décisif : il s’agit de l’appropriation qui lui donnera forme. Depuis le XIXe siècle, la régulation de l’extension urbaine consécutive à la révolution industrielle avait été un sujet constant. Économistes et juristes ont débattu du statut du sol à urbaniser : privé, public, municipal, étatique… Du passé privé faut-il faire table rase ? Les architectes-urbanistes ont plaidé, avec plus ou moins de succès, selon les contextes politiques et culturels, pour dégager de ces contraintes les projets à réaliser avec urgence pour l’habitat et les services à la population.
Bernoulli appuie son argumentation sur une très riche iconographie de plans et de cadastres plus ou moins anciens et sur des photographies aériennes illustrant des projets. Le lecteur est ainsi guidé dans une sorte de généalogie graphique dont les sources sont essentiellement allemandes, suisses et britanniques. À ces états des lieux urbains, il ajoute des scénarios comparatifs de choix et des résultats possibles, qui placent le lecteur dans l’atelier de la fabrique des nouveaux quartiers de la ville. Quelle maille parcellaire privilégier pour satisfaire de manière optimale une demande de logements ?
En 1946, une partie des villes européennes étaient à reconstruire et ce contexte historique précis a trouvé matière à réalisation dans cet essai pensé antérieurement. Quatre-vingts ans plus tard, le sol à urbaniser n’est plus celui des ruines, il reste un « grand commun » dont l’aménagement est une question spatiale, sociale et environnementale. Jean-Louis Tissier
Chronique coordonnée par Jean-Yves Potel