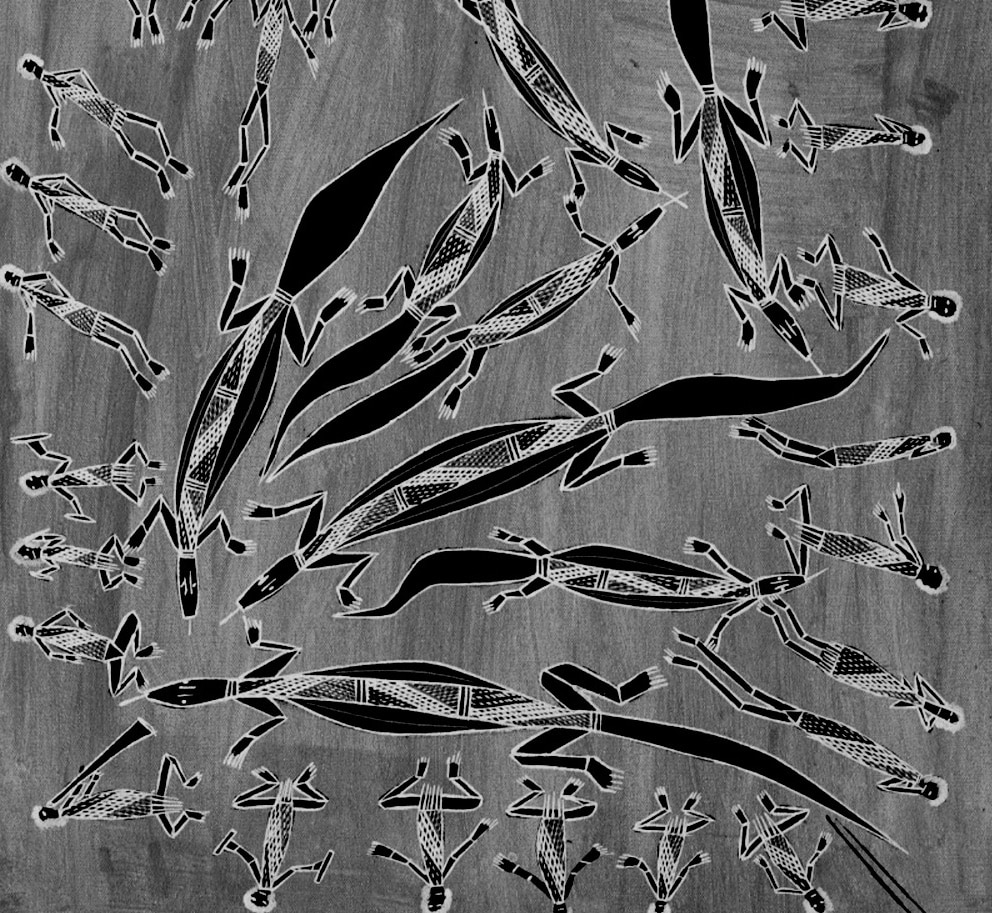Se loger dans une grande ville s’apparente à un parcours du combattant, y compris pour ceux qui disposent de revenus appréciables. Le niveau élevé des loyers et le prix démentiel des logements proposés à la vente contraignent de nombreux citadins à s’éloigner des villes-centre et à privilégier les déplacements automobiles, ce qui dégrade l’environnement et le climat. Comment sortir de ces impasses ? Comment offrir des logements abordables, confortables, correctement placés ? L’ouvrage de David Rottmann propose des solutions à contre-courant.
Les villes se porteraient mieux si les promoteurs immobiliers y cessaient leurs activités. Cette proposition hétérodoxe n’émane pas d’un gauchiste tonnant contre les méfaits du « grand capital » ou d’un hippie réfugié dans une bergerie du Larzac. L’auteur de cet ouvrage est un urbaniste qui exerce dans une agence de programmation et qui est chargé de cours à l’École urbaine de Sciences Po. En dépit de son titre provocant, l’ouvrage qu’il signe est celui d’un professionnel ancré dans les réalités. Son métier de programmateur l’amène à côtoyer l’ensemble des professionnels du secteur, ce qui lui donne une vue globale sur la situation du logement. Insistant sur l’ampleur de la crise actuelle, l’ouvrage ne se limite donc pas à l’impuissance d’un constat. Il propose de se passer des promoteurs immobiliers pour mobiliser d’autres opérateurs et d’autres logiques plus à même, selon lui, de construire les logements abordables et confortables dont les citadins ont un si pressant besoin.
L’ouvrage commence par égrener « Des nouvelles du front » et ces dernières ne sont pas bonnes. Là où les promoteurs sont le plus actifs, soient dans les dix-sept plus grandes agglomérations françaises, la situation est encore plus mauvaise qu’ailleurs. L’offre de logements locatifs y est en chute libre, avec une baisse record à Nice et à Paris, se traduisant par une mise en concurrence insensée entre les candidats à la location. L’auteur évoque un article du journal Le Monde (10 octobre 2024) qui cite l’exemple d’un logement parisien mis en location à un prix raisonnable sur le site Le boncoin. En une demi-heure, l’annonce reçoit 148 réponses ! Dans les grandes villes, le poids des loyers a plus que doublé, comparativement aux revenus des locataires potentiels. Pourtant, les logements à louer y sont de petite taille et pas toujours bien placés. Leur qualité est souvent moyenne, y compris dans le parc récent.
La situation est encore pire pour les candidats à la propriété : le prix moyen des logements anciens a été multiplié par 2,3 en France métropolitaine entre 2001 et 2020. De ce fait, les prix moyens au mètre carré s’envolent : 10 000 euros à Paris, près de 5 000 à Lyon, plus de 3 000 à Marseille. À Paris, il faut désormais compter sur un revenu mensuel de 7 215 euros pour prétendre acquérir un appartement de 50 m2.
Les 5,3 millions de logements sociaux ne suffisent pas pour offrir une alternative. En 2024, 2,7 millions de ménages attendent que leur demande soit satisfaite (+ 100 000 par rapport à 2023), particulièrement dans les grandes villes. La construction ne permet pas de réduire significativement cet imposant déficit. Seuls 85 000 nouveaux logements sociaux ont été livrés en 2024, atteignant un creux historique (environ 114 000 par an entre 2015 et 2018).
Dans cette situation morose, les entreprises de la promotion immobilière ne sont guère épargnées. Leur activité s’est fortement rétractée depuis l’épidémie de covid-19. En 2024, la promotion immobilière a construit 50 000 logements après en avoir produit le double en 2011. Pour sortir de l’impasse, faut-il renforcer les mesures d’incitation publique qui permettraient à la promotion de relancer son activité ? C’est évidemment le discours que tient la Fédération des promoteurs immobiliers, qui demande aux pouvoirs publics de rétablir un mécanisme d’incitation fiscale en direction des investisseurs bailleurs. Lorsqu’elle était Premier ministre, Élisabeth Borne a en effet annoncé la disparition du dispositif Pinel à partir du 31 décembre 2024, sans qu’aucune solution de remplacement soit envisagée.

Cet ouvrage défend une thèse opposée. Si la crise du logement est aussi profonde dans les villes françaises, ce n’est pas parce que les promoteurs sont insuffisamment soutenus par la puissance publique. L’auteur soutient au contraire que les aides publiques doivent cesser car la promotion n’est pas en mesure de satisfaire la demande. Elle produit trop peu de logements, même dans les périodes fastes, et ces derniers sont coûteux en argent public. Les logements sont trop petits, de mauvaise qualité et ils sont souvent mal placés. En s’entêtant dans cette voie, on ne résout rien et on fabrique à grands frais une ville low cost, incapable de répondre aux défis environnementaux qui nous guettent.
La promotion immobilière travaille prioritairement pour des investisseurs qui achètent des logements destinés à l’offre locative. Pour les inciter à investir, des générations successives d’abattement fiscaux ont été mis en place depuis 1984, qui ont pris le nom de leurs initiateurs : Méhaignerie, Périssol, Besson, Scellier, Duflot, Pinel. Quel que soit leur nom, ces dispositifs suivent la même règle : l’investisseur bénéficie d’un abattement fiscal s’il acquiert un logement qu’il s’engage à louer sur plusieurs années à un montant plafonné.
Depuis quarante ans, cette solution est unanimement apparue comme la plus pertinente pour offrir des logements au plus grand nombre. Reprise par des gouvernements de toutes obédiences, y compris de gauche, elle présente pourtant l’inconvénient de favoriser ceux qui sont susceptibles d’investir. Déjà aisés, ces ménages font un double bénéfice : se constituant un patrimoine qu’ils peuvent valoriser par un bail de location, ils bénéficient en outre d’un abattement fiscal. L’auteur calcule, à titre d’exemple, qu’un logement acheté 100 000 euros en 2008 dans le dispositif Scellier pouvait générer 4 000 euros de loyers plus 1 300 euros de remises d’impôts.
L’incitation fiscale dans le secteur du logement a donc pour effet de contribuer à l’accroissement des inégalités. En 2024, les 10 % des ménages français les plus riches concentrent près de la moitié du patrimoine national et captent un tiers de l’ensemble des revenus. Avec des prix immobiliers à la hausse, ces inégalités augmentent mécaniquement : le patrimoine immobilier des plus riches voit sa valeur augmenter, de même que les revenus à en attendre. Inversement, ceux qui ne détiennent aucun patrimoine et ne sont pas propriétaires de leur résidence principale voient leur situation se dégrader. Les dépenses pour le logement grèvent de plus en plus lourdement leur budget tandis que l’augmentation des coûts du crédit bancaire les empêche d’accéder à la propriété résidentielle.
Source d’injustice, les mesure d’incitation fiscale sont aussi très coûteuses. La Cour des comptes estime en 2023 qu’un « logement Pinel » coûte environ 50 000 euros à l’État, soit davantage que l’aide consentie à un logement social. Pour l’ensemble du dispositif Pinel, le coût total est estimé entre 10 et 12 milliards d’euros jusqu’en 2038. Dans son ouvrage L’État, le promoteur et le maire. La fabrication des politiques du logement (2018), Julie Pollard estime, quant à elle, que le coût des dispositifs antérieurs s’élève à 16,5 milliards en 2011.
Malgré leur coût, les logements produits par la promotion immobilière sont de piètre qualité. Cherchant un profit maximum, les promoteurs n’hésitent pas à rogner sur l’originalité architecturale, la superficie ou les performances techniques. La baisse de qualité est sans incidence sur les prix car les acheteurs ne sont pas regardants, étant surtout attirés par la profitabilité à court terme. Ils ne résideront jamais dans ces immeubles et, de ce fait, n’en subiront pas les désagréments ou les malfaçons éventuelles.
Les promoteurs sont conduits à économiser sur les coûts de la construction car ils doivent réserver leurs capacités d’investissement à l’achat de terrains qui supporteront leurs immeubles. Or, le marché du foncier urbain est très concurrentiel, les terrains libres étant rares. Pour l’emporter sur ses concurrents, un promoteur est donc contraint de proposer le prix le plus élevé au vendeur. Pour « se refaire », il doit rogner sur la construction ultérieure, le coût de cette dernière étant intégré au bilan prévisionnel global selon la technique du « compte à rebours », bien connue dans la profession. Cette dénomination s’explique par le fait que, à rebours de la chronologie, le début du processus, soit le prix d’achat du terrain d’assiette, est déterminé en fonction du prix de vente des logements espéré à l’issue de l’opération. Plus le montant à en attendre est élevé, plus le promoteur pourra offrir un prix intéressant au vendeur du terrain, espérant ainsi devancer la concurrence.
Dans un contexte de hausse rapide et continue des prix de l’immobilier, les promoteurs intègrent dans leurs « comptes à rebours » la valeur future des logements à construire, par exemple à t+2 ans. Cette anticipation leur permet d’acheter le foncier à des prix toujours plus élevés, alimentant une spirale spéculative particulièrement perverse. Dans le chapitre 4 (« Le fond du problème, la ville marchandise »), l’auteur montre que ce système en surchauffe attire d’autres investisseurs, qui considèrent le produit immobilier à l’aune de sa valorisation potentielle. Le logement est alors dissocié de son utilité sociale, il est réduit à une espérance de gain à court terme, à un produit financier souvent plus rentable que bien des placements boursiers. De ce fait, l’investissement immobilier passe dans les mains de groupes bancaires ou de fonds de pension de surface internationale. Nantis d’énormes moyens d’investissement, ces groupes interviennent surtout dans les grandes métropoles. Ils y financiarisent la production de logements et contribuent à la formation de bulles spéculatives qui peuvent avoir des effets destructeurs, ainsi que l’a montré la crise des subprimes américaines à partir de 2008.
À l’issue de ces analyses serrées, David Rottmann aboutit à une conclusion imparable. Pour poursuivre leur activité, les promoteurs immobiliers doivent bénéficier de deux conditions : un flux permanent d’investissements publics destinés à soutenir leurs profits ; un marché haussier qui leur permette de parier sur une hausse constante des prix de l’immobilier. De ce fait, la promotion immobilière contribue à creuser les déficits publics en même temps qu’elle gonfle artificiellement les prix du foncier et de l’immobilier. Le modèle de la promotion-construction est donc particulièrement néfaste pour l’avenir des citadins comme pour celui des villes. Il produit du logement « jetable » de mauvaise qualité à des prix toujours plus élevés, interdisant au plus grand nombre de se loger décemment.

Comment faire pour vivre dans des villes plus vivables ? Comment construire des logements plus confortables et moins onéreux ? En France, des alternatives existent comme le logement social, qui échappe aux logiques spéculatives. La construction des logements sociaux n’a pas pour objectif de tirer des profits financiers. Leur attribution ne se fait pas selon des logiques de marché mais en tenant compte de la situation sociale des demandeurs. Cependant, l’action publique s’est désengagée de la construction en régie directe des logements sociaux. De ce fait, les organismes HLM trouvent plus d’intérêt à acheter des logements construits par des promoteurs au sein de leurs propres opérations (procédure de « Vente en l’état futur d’achèvement » ou VEFA). Favorisant la mixité sociale, souvent de manière illusoire, la VEFA dépossède les organismes sociaux de leur capacité à construire des logements adaptés aux besoins des ménages éligibles (superficies, typologies, services à proximité, etc.). En outre, la VEFA présente l’inconvénient de renforcer l’allocation de ressources publiques à des bénéficiaires privés. L’auteur préconise donc d’augmenter les moyens affectés à la construction des logements sociaux. Sans dépenser davantage, il sera possible d’y consacrer les sommes autrefois affectées aux incitations fiscales favorisant les investisseurs privés.
Plus largement, l’auteur énonce une règle d’or : tout financement public doit générer un actif public durable. Les 50 000 euros d’argent public consacrés à un « logement Pinel » profitent exclusivement à des personnes privées (entreprises de promotion-construction, acheteurs) sans le moindre retour pour les ressources publiques. A contrario, 50 000 euros investis dans un logement HLM génèreront une valeur patrimoniale qui restera publique.
Si l’on privilégie l’objectif consistant à augmenter les actifs publics immobiliers, d’autres solutions émergent, comme le prêt social accession-location (PSLA) ou le bail réel solidaire (BRS). Le PSLA se déroule en deux phases : une première phase locative où l’accédant paye une redevance (incluant un loyer et une épargne) au propriétaire (public) du logement. Dans une seconde phase, l’accédant peut devenir propriétaire à un prix fixé à l’avance. Les PSLA sont proposés à prix plafonnés à des ménages sélectionnés en fonction de leurs revenus. Le BRS, quant à lui, dissocie la propriété du foncier de celle de l’immobilier. L’acheteur achète uniquement son logement et il loue le foncier à un organisme public. Ces deux manières de fractionner la propriété présentent les mêmes avantages. Dans les deux cas, un investissement public initial génère des retours financiers qui restent publics. Le PSLA et le BRS permettent en outre d’encadrer les prix du foncier et de l’immobilier, ce qui limite la spéculation et permet à des ménages modestes d’accéder à la propriété de leur résidence.
Peut-on faire la ville sans les promoteurs immobiliers ? Malgré ses défauts, la promotion immobilière présente un mérite : les promoteurs sont en capacité de construire rapidement en endossant un risque financier qui augmente à mesure que s’accroissent les incertitudes de la spéculation foncière. Elle est en mesure d’édifier des bâtiments sans que les finances des collectivités locales en soient significativement affectées. Outre celui des investisseurs, la promotion immobilière fait donc le bonheur des élus locaux en construisant des immeubles ou des centres commerciaux qui attestent de la vitalité de leur ville et de la sagacité de leurs décisions. On comprend donc les précautions de l’auteur lorsqu’il évoque le « démantèlement de la promotion immobilière » et on peut porter à son crédit l’audace d’aborder un tel sujet.
Les quelques pages consacrées à cette épineuse question restent toutefois trop générales. L’auteur escompte des transferts de compétences et de salariés entre le secteur de la promotion et celui de l’utilité sociale. Il espère que les promoteurs, mis sous pression par des pouvoirs publics redevenus offensifs, accepteront de limiter leurs marges et d’améliorer la qualité de leurs constructions. Mais la question reste en suspens : comment inciter les promoteurs à changer de pratiques… ou à changer de profession ? Voilà peut-être la seule réserve que l’on peut exprimer à l’égard d’un ouvrage original, bien construit et solidement argumenté, dont le propos est à la fois technique et accessible aux non-spécialistes.