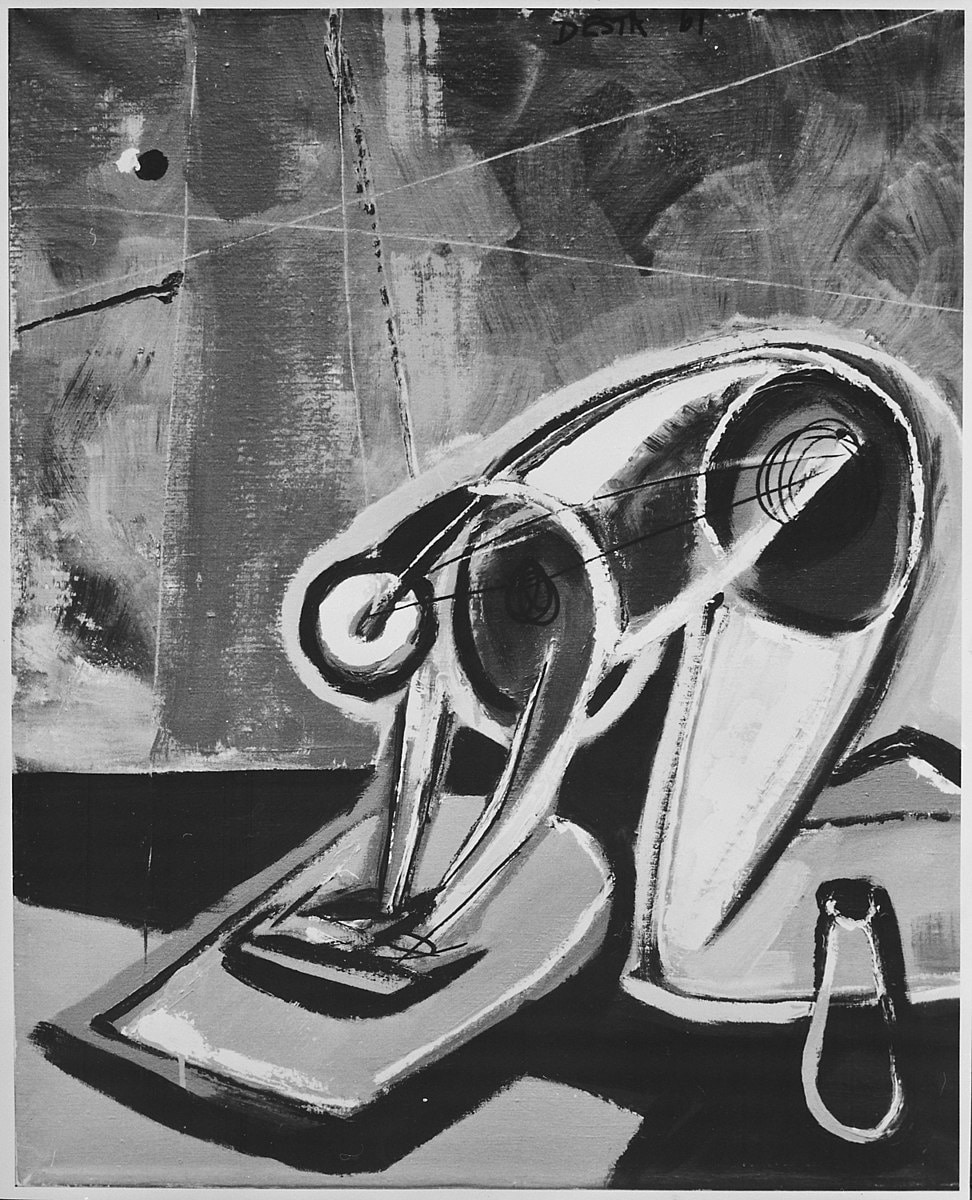Récit de vengeance, chasse au trésor, voyage initiatique, quête spirituelle, roman du retour : Où s’adosse le ciel trouble les genres. Le sixième roman de David Diop interroge la valeur de la transmission et la construction de soi vis-à-vis de l’ombre gigantesque de celles et ceux qui nous ont précédés.
Où s’adosse le ciel est un double récit : l’odyssée de Bilal Seck, Sénégalais de trente-sept ans qui rentre à Saint-Louis depuis La Mecque en 1894, et le récit de l’ancêtre dont il retrace les pas. L’ancêtre, c’est le scribe Sekhsekh, et le récit, celui de son indignité, mais de bien autre chose aussi : une trame touffue d’affrontements mythiques et d’alliances trompeuses sous Ptolémée II Philadelphe, devenue parole sacrée dont Bilal est le soixante-douzième passeur.
Ces deux histoires alternées, qui se font écho et où paysages et visages se superposent, peuvent sembler disparates au premier abord : dans le récit du XIXe siècle, Bilal est le protagoniste, trahi par son maître et ami Yérim Thiaw qui l’abandonne à La Mecque, tandis que le récit du IVe siècle avant J.-C. est à la fois un triangle amoureux et l’histoire de la rivalité entre le prêtre Ounifer et le général Ptahhotep, au milieu desquels la singulière destinée de Sekhsekh semble s’effacer.
Après avoir fait son pèlerinage à La Mecque et avoir foulé la terre qu’avait connue son ancêtre, c’est aux sources mêmes du mythe que remonte Bilal. Comme dans toute chasse au trésor, il doit devenir enquêteur et sémiologue pour toucher enfin à cette richesse matérielle et intangible. Les deux récits se rejoignent donc à travers la mémoire de Bilal ; pour lui, Sekhsekh, Kemi, Antef, Ounifer et Méret sont autant de personnages, de mythes vivants, mus par le désir, l’ambition et la passion, dont il cherche les traces en lui-même et jusque dans les ruines d’Abydos.

Roman profondément romanesque dans sa succession de rebondissements, de retournements de fortune et d’aventures, et sa représentation de passions extrêmes, Où s’adosse le ciel rappelle des motifs de l’œuvre de David Diop : la frontière ténue entre humanité et inhumanité, le chemin ardu du retour, la trahison et la vengeance, les rapports de domination et leur renversement. Mais là où L’attraction universelle, Frères d’âme et La porte du voyage sans retour pensent les ravages du colonialisme français, Où s’adosse le ciel est un roman africain, où la présence des colons reste en arrière-plan. Cette différence s’explique par l’attention portée aux migrations intra-africaines et par la temporalité du roman, qui repose sur la transmission d’une généalogie ancienne remontant à la dynastie lagide (elle-même s’insère dans une temporalité plus longue puisque Sekhsekh a encore en mémoire les bouleversements causés par Akhenaton mille ans plus tôt). Les origines égyptiennes de Bilal Seck ne sont pas neutres : en 1894, la pseudoscience occidentale fascinée par l’Égypte s’évertuait depuis déjà des décennies à démontrer qu’il n’y avait jamais eu de Noirs en Égypte antique. Dans son récent ouvrage The Message, Ta-Nehisi Coates revient sur ce mythe raciste, mais aussi sur son retournement contemporain, lié au besoin de faire renaître un attachement à une grande civilisation noire, à de grands ancêtres. Dans Où s’adosse le ciel, si Sekhsekh reste cantonné à un rôle subalterne, il transgresse, ose et désire ; il est scribe, porteur et passeur de tous les mythes, et reste la parole vivante d’une histoire ensevelie.
Le motif du retour est exploré sous toutes ses facettes : le roman inclut une carte du voyage interrompu et différé de Bilal jusqu’au Sénégal, mais le retour est avant tout un retour sur soi et une renaissance. Le roman s’ouvre ainsi sur un homme démuni, rejeté, qui a tout perdu sauf la mémoire, mémoire qui est aussi sa mission : « Bilal Seck était presque nu. Ses habits de pureté, deux pièces d’étoffe blanche, étaient désormais maculés de terre, tachés de sang et criblés de trous d’étincelle récoltés aux abords de foyers éphémères. Son seul bagage était sa mémoire. »
Bilal souffre d’une malédiction qui s’auto-perpétue, d’une honte liée à une souillure ancestrale. En effet, si le roman fait place au racisme auquel Bilal est confronté en tant qu’homme noir, Takrouri, la honte de Bilal est liée à l’histoire de Sekhsekh, que seuls ses descendants se remémorent génération après génération. Ce sang impur paradoxalement associé à une généalogie mythique l’assigne au statut d’esclave, de dominé, à une noblesse honteuse. Laissé pour mort – ou, plus exactement, laissé aux aléas d’une épidémie foudroyante de choléra –, il se voit comme doublement contaminé. L’impureté de sa condition vient à la fois du péché de son ancêtre, et de sa résistance suspecte à la maladie : « Il faisait l’épreuve de l’ostracisme du sang. Si son sang le préservait de la mort pour une raison inexplicable, alors qu’il touchait des corps saturés de miasmes morbides sans en souffrir, la tentation devait être grande d’associer sa résistance à une impureté surpassant celle qui avait abrégé tant de vies. »
Signe de sa noblesse ou de son infériorité, l’immunité de Bilal lui permet de renaître dans l’horreur, aux marges de l’humanité, de résister aux épreuves et de prendre forme : « Associé à sa personne depuis son enfance, son surnom, « le Gros » […] ne lui correspondait plus. Les privations avaient affiné sa taille et asséché sa musculature. Il se trouvait plus beau et fort qu’il ne l’avait jamais été ».
Les épreuves de Bilal le poussent à remettre en question les hiérarchies, à se faire sa place plutôt que de s’accommoder d’une domination injustifiée. Le texte voit la naissance de la volonté et du désir de vengeance d’un homme qui s’est mis en retrait : « Je suis bête, songeait Bilal, je suis resté célibataire pour mieux servir Yérim. […] Mais je ne serai plus jamais son homme lige, son subalterne, son réprouvé préféré. Je le forcerai à me traiter d’égal à égal, je me vengerai de sa trahison ».

Mais Bilal Seck n’est pas Edmond Dantès, et la vengeance portée par le texte est essentiellement une vengeance contre le destin qui se répète, contre la trahison des dominants. Le récit tragique des trahisons, vengeances et désirs du mythe égyptien se mue en un récit de formation, un roman de (ré)apprentissage pour Bilal, qui reconstruit son individualité et son humanité.
Cette reconstruction passe par une resignification du passé : en cela, le roman place au centre la question de la mémoire des mots, et le sens des mythes familiaux et collectifs. Alors que la mère de Sekhsekh, pauvre et illettrée, attrape les mots spontanément et possède les poèmes, cette mémoire dont il hérite devient un repère, un refuge et une prison pour Bilal. Le roman propose plusieurs passages de l’oralité à l’écriture – Bilal accepte que son histoire soit mentionnée dans la thèse d’un médecin français qu’il rencontre à Djeddah, inscription qui se révèle fondamentale par la suite. De plus, le récit des ancêtres finit consigné dans un cahier à la plume Sergent-Major, dans une transmission qui semble à la fois acter l’immortalité du mythe et le désacraliser.
Or, le récit de l’ancêtre désacralise déjà le mythe – par exemple, lorsque Sekhsekh orne de commentaires facétieux le papyrus du mythe de l’accouplement d’Isis et Osiris. Le récit de Sekhsekh lui-même est déjà une écriture, une illusion d’oralité dans la diégèse mais aussi un roman moderne, à la troisième personne qui permet des incursions de discours indirect libre. Il s’agit aussi d’un récit enchâssé, comme nombre de romans du XVIIIe et du XIXe siècle : ces romans-mémoires cherchaient à donner, via un narrateur garant de l’authenticité du texte, une illusion de véridicité (Manon Lescaut de l’abbé Prévost), puis, à l’aube du XXe siècle, à déconstruire cette véridicité factice (Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad). Au contraire, le récit de Sekhsekh est encadré par un narrateur qui donne au récit sa dimension mythique et intemporelle, mais dont on peut se demander s’il est tout à fait fiable : « Je suis le voyant, l’élu des élus. Je suis le rapporteur omniscient, le lien vivant entre le passé et le présent, le scribe d’antan et d’aujourd’hui. » Bilal est le passeur de sa génération, mais aussi la voix collective de tous ceux qui l’ont précédé, porteur d’une mémoire collective et d’une mémoire individuelle dont le roman suggère qu’elles sont liées par une honte que Bilal finit par dépasser : le roman implique un décalage, une tension fondamentale entre répétition et (re)signification.
On n’échappe pas à son destin, semble suggérer le roman : Yérim Thiaw, maître indigne qui fuit devant la mort et abandonne son ami, est inévitablement rattrapé et puni. On n’échappe pas au destin des autres, comme le découvre Bilal, « homme de destin » d’un étranger qu’il croise sur sa route. Mais le destin, c’est aussi mettre fin aux malédictions et aux prophéties autoréalisatrices, regarder la honte en face, pour ce qu’elle est : un songe, le socle bancal et empoisonné de mythes auxquels manquent seulement quelques hiéroglyphes.