Avec son livre La vie des arts (mode d’emploi), Jean-Marie Schaeffer clarifie de façon lumineuse un certain nombre de questions, d’ambiguïtés, d’apories et de flous touchant à ce que nous entendons par « art ». Il revendique à juste titre de ne présupposer « aucune connaissance historique ou technique, simplement de la curiosité ». Mais, pour sa part, sa réflexion est constamment informée et précise, tant historiquement que théoriquement.
Sans qu’on en ressente jamais le poids, il y a chez Schaeffer les traces d’une solide culture analytique et cognitiviste. Cependant, cette culture est toujours rapportée à une fréquentation et à une expérience personnelle des œuvres, qu’elles soient picturales, musicales ou littéraires. Et son champ de curiosité couvre aussi bien les origines paléolithiques de la figuration que le statut des œuvres d’art numériques dites NFT (non-fungible token, soit une œuvre digitale originale unique, ou à exemplaires limités, dont la propriété exclusive est garantie à l’acheteur par un système de blockchains sécurisées, à la façon des crypto-monnaies), là où, pour la plupart, nous perdons de vue la saisie d’une quelconque communauté d’appartenance entre ces pratiques.

Cela passe par une double extension qui est le préambule à une meilleure compréhension du phénomène artistique, et dont témoigne le titre de l’ouvrage. La première tient à la pluralisation de la notion d’art : « les arts » et non « l’Art » (comme tendent à l’essentialiser tant d’« Histoires de l’Art »). C’est que les arts constituent un champ ouvert, infiniment extensible et toujours surprenant et imprévisible, ainsi que le prouvent les plus récents développements de ses formes digitales. Au cours de l’Histoire, ce qui frappe c’est à la fois la métamorphose et la diversification des pratiques artistiques (qui, à vrai dire, a dû s’amorcer dès l’« origine ») : entre « haute » culture magique ou religieuse et « basse » culture artisanale et ornementale, entre œuvres liées à des fonctionnalités politiques précises, et « art pour l’art », entre œuvres à exemplaire unique (dites aussi « autographiques ») et œuvres infiniment reproductibles (comme le livre et la photographie), voire totalement dématérialisées.
Est-ce-à dire que l’Art n’existe pas ? Des historiens ont plaidé que, la notion d’art n’émergeant qu’au siècle des Lumières, toute qualification rétrospective comme « œuvres d’arts » d’artefacts antérieurs à cette époque n’était qu’une illusion moderniste. Schaeffer fait justice de cette position dogmatique en soulignant l’absurdité qu’il y aurait à dénier un statut artistique à la statuaire grecque ou aux fresques de Fra Angelico au prétexte qu’elles ne sont pas contemporaines d’une conceptualisation moderne de l’art. S’il est admissible que l’Art n’existe pas en tant que concept unique et collection d’objets partageant les mêmes propriétés, les arts existent indéniablement en tant que « famille » et on peut caractériser cet air de famille comme le propose Schaeffer en le définissant comme il le fait : « une pratique culturelle est une pratique artistique si elle ne peut atteindre sa fonction sociale ultime (quelle qu’elle soit) qu’à travers son appropriation par une conduite attentionnelle appréciative, soit sensible (regarder, écouter, toucher, humer…), soit intellectuelle (comprendre), soit, dans la plupart des cas les deux à la fois ». L’attention à une forme, sa prise en compte perceptive au service d’une finalité qui peut être tout autre, voilà qui réconcilie les fausses contradictions entre « art pour l’art » (la notion est douteuse, toute œuvre étant inscrite dans un réseau de fonctions sociales) et « art engagé », divertissement et culture, esthétisme et propagande.
Si nous avons de la peine à admettre un tel élargissement de la notion d’art, c’est que nous identifions l’art à un ensemble d’objets inertes et classifiés « artistiques » par leur appartenance à des collections muséales ou par leur validation critique ou historique. Et c’est ici que Schaeffer nous invite, par le titre de son livre ( La vie des arts) à une seconde extension, en pointant le fait que les arts ne consistent pas seulement en œuvres mais en relations induites par ces œuvres : « l’art n’a pas de réalité propre : il n’est que l’effet perçu des interactions à un moment donné entre les arts, et, ultimement, entre les artistes, leurs pratiques, les œuvres, les intermédiaires grâce auxquels les œuvres deviennent accessibles, et ceux qui font l’expérience de ces dernières ».

Une fois accompli ce que Valéry aurait appelé un « nettoyage de la situation verbale », Schaeffer se livre à une étude de cette « vie » relationnelle à travers toutes sortes d’angles d’approche aussi variés que stimulants. Le premier concerne la relation évidemment essentielle que nous entretenons tous avec les œuvres d’art en tant que « récepteurs » et qui évidemment leur donne « vie ». En quoi consiste-t-elle exactement ? Schaeffer, reprenant des travaux antérieurs et décisifs, la définit comme un exercice d’attention d’une nature particulière car centré sur le vécu de l’expérience à laquelle l’œuvre nous donne accès. Si en effet nous passons notre vie à « faire attention » à tous les signaux qui jalonnent nos activités pratiques et auxquels il importe de répondre pour des raisons utilitaires, nous le faisons dans un souci d’économie maximale. Nous nous satisfaisons de l’identification du signal la plus rapide et la moins « coûteuse » possible. Mais face à une œuvre d’art, nous nous ouvrons délibérément à une « dépense » qui est animée par un plaisir : « Nous adoptons plutôt une attitude de curiosité ouverte, non préconçue et sans plan fixé d’avance : nous laissons l’œuvre nous envahir ou nous nous immergeons en elle (les deux dynamiques opèrent en fait conjointement), aux dépens de l’exploration hiérarchique caractéristique de l’attention « banale » qui vise à acquérir le plus vite possible une croyance stable. » Cette disposition n’est pas seulement centrée sur l’objet d’art, elle est aussi une attention à soi-même, aux souvenirs, aux associations et aux affects suscités par l’œuvre. C’est ce qui fait que toute relation aux œuvres d’art est à la fois « objective » (elle procède d’une observation des propriétés réelles de l’œuvre) mais toujours singulière selon son destinataire (résonances et émotions suscitées par l’œuvre sont propres à chaque individu, à sa culture et à son histoire propre). La réflexion que soulève une telle analyse de la réception esthétique, c’est que, si l’on devait envisager une « fin de l’art », cela tiendrait sans doute moins à une extinction de la production artistique, qui a plutôt tendance à se multiplier, qu’à un raccourcissement des boucles de l’attention de ses destinataires…
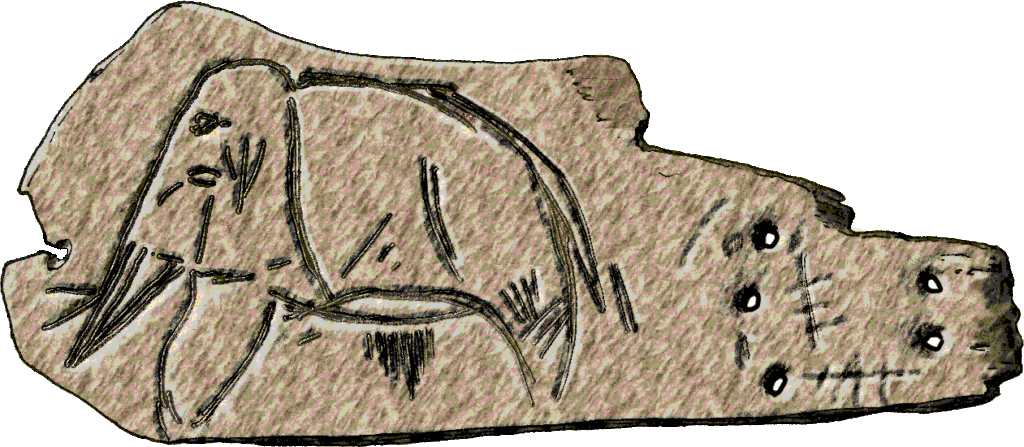
Une fois établis ces principes, Schaeffer peut procéder à la clarification d’un ensemble de questions régulièrement adressées à l’art et qui ne trouvent que des réponses confuses parce qu’elles ont été mal formulées. Parmi bien d’autres, j’en retiendrai deux. La première, « Y a-t-il une origine des arts ? », se trouve disqualifiée, non seulement par la science préhistorique qui, depuis le XIXe siècle, n’a cessé de faire reculer la datation des premiers témoignages d’art (de Lascaux jusqu’aux néandertaliens), mais aussi par sa téléologie implicite qui présuppose une origine « primitive » et un développement unifié des arts sur la planète. Schaeffer fait valoir à juste titre que les arts ont connu de multiples origines, des effondrements et des recommencements, sur les divers continents. La question semble d’autant moins pertinente que des pratiques différentes (le tressage de l’osier, la mosaïque ou le vitrail, pour en citer quelques-unes) n’ont cessé d’entrer et de sortir du champ des arts, avec des statuts variables et révisables au fil des siècles, en sorte que toute perspective globalement évolutionniste relève purement d’une illusion historique et d’un dogmatisme esthétique.
À l’autre extrémité de l’axe temporel, Schaeffer interroge une notion non moins problématique que celle d’« origine », quoique pour des raisons différentes. Il demande : « Qu’y a-t-il de contemporain dans l’art contemporain ? » Et dans ce cas, ce qu’il s’agit de dissiper c’est la double ambiguïté temporelle mais aussi sémantique de la notion de « contemporain ». D’un point de vue temporel, elle est déjà matière à débat puisqu’elle n’est nullement synonyme d’« actuel » mais comporte une épaisseur temporelle. Pour les historiens, elle se situe généralement dans la période qui court de la révolution française jusqu’à nos jours. Mais, pour la plupart des critiques d’art, elle sert à désigner l’art d’après 1945. Nathalie Heinich avait proposé de la dissocier totalement de toute valeur chronologique pour en faire un « genre » spécifique dans le champ des arts (en effet, ni Bob Dylan ni Francis Bacon ni Fellini ne relèvent à proprement parler de « l’art contemporain » bien qu’ils appartiennent indubitablement à l’époque ainsi dénommée). De façon plus nuancée, Schaeffer comprend l’« art contemporain » non pas exactement comme un « genre » mais comme un secteur de l’art muséal, en opposition et en dialogue avec « l’art moderne » (car, parmi les traits typiques de l’« art contemporain » – le ready-made, la performance, l’art conceptuel et l’installation –, les deux premiers trouvent leur origine chez les « modernes » que sont Duchamp et les dadaïstes). Là encore, à l’encontre de toute histoire unifiée de l’art, la reconnaissance d’une pluralité des mondes de l’art et du chevauchement de leurs temporalités constitue une clarification salutaire.
Schaeffer ne manque pas d’aborder les questions les plus dérangeantes et les plus actuelles à propos de la « vie » des arts. Je relèverai celle des « économies de l’art » qui ont connu au fil de l’histoire une profonde métamorphose : pour l’essentiel, artisans et artistes sont passés d’un marché de la demande (la plupart des œuvres répondaient à des commandes publiques, religieuses ou privées) à un marché de l’offre caractéristique de la modernité (l’artiste fait un pari en proposant les résultats de sa propre inventivité à un public virtuel d’acheteurs), avec tous les effets de risque et d’incertitude qu’entraîne ce renversement. Schaeffer note au passage que, sur ce marché pléthorique, le succès de quelques-uns ne peut masquer la précarité de la plupart, et il souligne la fragilité d’un tel modèle économique.
Pour finir, on s’attardera à sa réflexion sur une question qui aujourd’hui inquiète particulièrement le monde des arts, celle de l’intelligence artificielle (IA). À la question « l’intelligence artificielle peut-elle créer des œuvres d’art ? », Schaeffer répond sans ambiguïté qu’elle peut en tout cas les simuler à la quasi-perfection. Il est très probable aussi qu’elle jouera à l’avenir un rôle important mais non exclusif dans la production de certaines œuvres (comme, en son temps, a pu le faire la photographie « automatique »). Cependant, la concurrence de l’IA avec de véritables artistes relève du fantasme pour des raisons évidentes : l’IA ne peut que recombiner des données déjà existantes, elle ne peut pas, à proprement parler. en créer. N’ayant aucun accès au monde, elle ne saurait produire de nouvelles connaissances « puisqu’une connaissance naît toujours d’une rencontre avec la réalité ». Ce qui lui fera toujours défaut et qui demeure un trait décisif des arts, c’est la conscience historique de leur situation dans le temps, d’où émergent les œuvres véritablement créatives. Il était important de le rappeler dans cet essai qui dissipe avec talent mythes et fausses questions à propos des arts.












