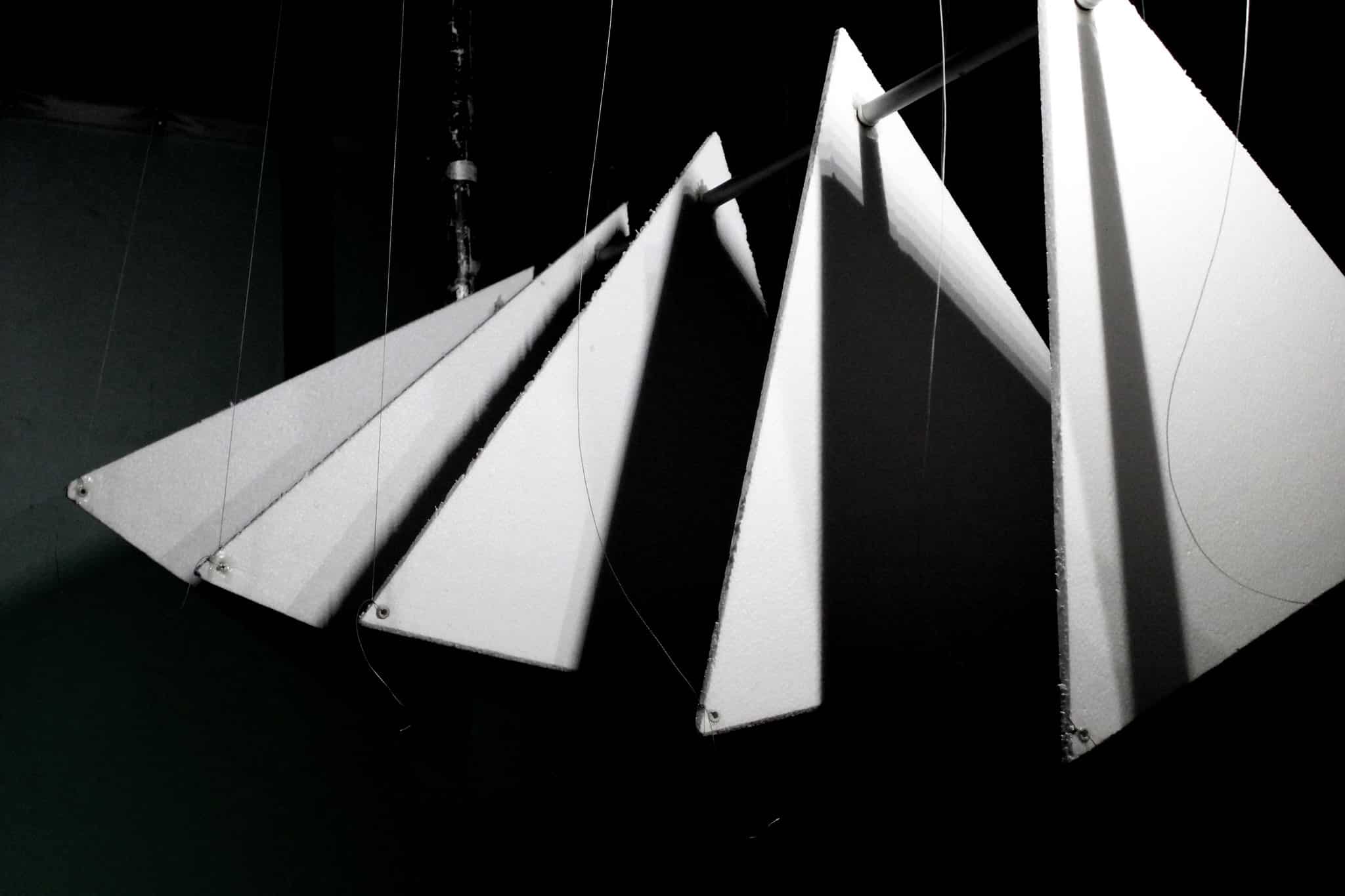Le vif de l’art (20)
11, avenue du Président-Wilson, 16e arrondissement de Paris – Une soixantaine d’années ont passé depuis que le palais de Tokyo, alors musée national d’Art moderne, accueillit la première rétrospective de l’œuvre de Nicolas de Staël, tout juste un an après sa mort, survenue en 1955. C’est dans l’aile jumelle du musée d’Art moderne de Paris qu’est présentée depuis la rentrée l’une des expositions les plus ambitieuses consacrées à l’œuvre du peintre.
À en juger par l’affluence des premiers jours, le public n’est manifestement pas lassé de la peinture de Staël, malgré la cascade d’expositions qui se sont succédé depuis celle organisée en 2003 par le Centre Pompidou. Palpable dès 1956, cet engouement, rappelle Charlotte Barat dans le catalogue, suscitait déjà à l’époque la moue d’une partie de la critique et des connaisseurs, pour lesquels la réception de l’œuvre de Staël avait été irrémédiablement biaisée par son destin d’artiste maudit.
À leurs yeux, cette légende satisfaisait à bon compte la quête d’absolu du tout-venant en lui épargnant l’effort d’examiner les peintures, qui étaient pourtant loin d’être de qualité égale, jugeaient-ils. Si les amateurs éclairés pouvaient – et peuvent encore – trouver de bonnes raisons de discerner les tableaux entre eux, il n’est en revanche pas certain qu’en soupesant de la sorte ils perçoivent plus clairement le sens de la peinture de Staël. Par temps incrédules, il est en effet un mythe bien plus difficile à ébranler que celui de l’artiste maudit : celui qui voudrait que ce ne soit qu’un mythe.

Il est vrai qu’en déambulant parmi les peintures de Staël vient un moment, qu’on ne saurait exactement situer mais qui se présente après qu’on en a vu de nombreuses, lorsque l’on découvre que la familiarité qu’on pensait avoir acquise à leur contact ménage encore une place pour la surprise, vient alors ce moment où l’on est tenté d’atténuer cette surprise en se disant qu’il devait peindre avec facilité. Cette sensation est d’autant plus troublante qu’à un autre moment, survenu un peu plus tôt, on songeait à l’inverse qu’il peignait laborieusement. Ces deux moments se confondent cependant, et leurs impressions respectives avec eux lorsqu’on s’aperçoit qu’elles vont en réalité de pair.
« Le tableau, se souvient Anne de Staël, la fille du peintre et la plus fine connaisseuse de sa peinture, c’était une fulgurance peinte très lentement. » En mai 1953, dans une lettre au poète Pierre Lecuire, Staël écrivait de même qu’il n’y avait, selon lui, que « deux choses valables en art. 1° La fulgurance de l’autorité. 2° La fulgurance de l’hésitation ». Abondamment citée, cette remarque mérite encore d’être rappelée car elle coïncide effectivement avec le sens de sa peinture, ou plus exactement avec sa façon de la mettre en œuvre, aussi facile que laborieuse, afin d’atteindre sans l’éteindre la fulgurance.
Dès les premières salles, une petite composition à l’encre de Chine de 1949 (Composition, collection particulière) suggère que Staël procédait d’abord comme le faisait Georges Braque, dont il a été proche, c’est-à-dire en concevant un « bâti ». Suivant ce modèle, il applique des aplats plus ou moins délavés sur le papier qu’il range à l’intérieur de très fines lignes entrecroisées, à moins qu’il ne déduise celles-ci des blocs épars, car ce mince réseau ne vise pas à les coudre ensemble, il les borde plutôt, les ourle en y affleurant.
Contrairement à Braque, donc, Staël maintient le bâti dans son état primitif. Ce qu’il agence patiemment finit bel et bien, cependant, par tenir, mais d’une manière telle que, face à l’œuvre, ne se dissipe jamais tout à fait le sentiment que ce qu’elle tient demeure en définitive tout près de se disloquer. Qu’on s’émerveille de ce qu’un tel phénomène puisse se produire simultanément (puisqu’il est en peinture des phénomènes incessants) inciterait à parler confusément de petit miracle ; mais la confusion du mot ne ferait en l’occurrence que rendre compte assez éloquemment de cette fulgurance que le peintre a soigneusement élaborée jusqu’à lui donner forme.
En observant cette fois ses Trois pommes en gris de 1952 (collection particulière), on saisit qu’entre-temps le peintre a cherché à concrétiser son bâti tout en lui conservant sa précarité. Afin d’y parvenir, il a peint cette fois depuis les fonds. En regardant de près l’un de ces petits carrés gris qu’il désigne comme une pomme, on devine que celui-ci a d’abord été de couleur taupe, et avant encore de couleur verte, ou bien d’un autre gris, plus foncé, comme celui de la table sur laquelle les « pommes » sont arrangées, et qu’il y avait mêlé aussi de l’outre-mer, du jaune en plus d’un peu de rouge.
Or, si cette « pomme » tient, c’est grâce à cet amoncellement de couches. Et si l’on songe pourtant qu’elle pourrait « tomber » sans rouler, c’est aussi grâce ou à cause de leur superposition. D’un côté, le motif se tient dans le tableau – solidairement – parce que Staël l’a lissé en surface au couteau ; d’un autre côté, parce qu’il en a laissé l’entour à découvert, il fait « jouer » avec et à sa surface le motif qui devient de la sorte une figure, une figure détachée du fond quoiqu’elle ne s’en sépare pas. La « pomme » acquiert ceci de fulgurant qu’elle saille sans ressortir, qu’elle est aussi solide que périssable.
Staël peut multiplier les motifs en leur donnant l’aspect de mosaïques mal ajointées (Fugue, 1951-1952, Phillips Collection), ou bien élever celles-ci en hauts bouquets (Fleurs grises, 1952, collection particulière), chaque tableau se présente sous l’aspect duel d’une surface appareillée comme le serait un mur (le fameux « maçonnage » de Staël) qui serait sur le point de s’ébouler. On devine alors qu’il faut à chaque fois tout recommencer, soit que le peintre atteigne la fulgurance au prix de l’instabilité, soit que la stabilité péniblement conquise sur la matière assourdisse l’effet recherché.
Dans les peintures de cette période (la toute fin des années 1940 et le tout début de la décennie suivante), le risque d’éboulement demeure toutefois contenu à l’intérieur des compositions, dans la mesure où Staël en a disposé les éléments sur l’intégralité de leurs surfaces, transformant du même coup les formes primaires qu’il emploie. Pour le dire de manière un peu schématique et périodique, dans les années 1945-1949, le peintre enchevêtrait des bâtonnets autour d’un axe vertical (par exemple dans Le Cube, 1946, galerie Louis Carré & Cie), bâtonnets que ses encres de 1948-1949 dissocient peu à peu, puis qu’il abandonne provisoirement au profit de formes pseudo-géométriques qu’il désimbrique à leur tour entre 1949 et 1951 afin de les distribuer en blocs irréguliers mais agençables. Ce faisant, Staël y voit certainement plus clair, ses compositions étant plus pondérées dès lors que le « poids » de ses motifs y est mieux réparti. Mais ce résultat leur a fait perdre le dynamisme des débuts.
C’est peut-être ce qui explique la fascination qu’a exercée sur le peintre le match de football auquel il assiste en nocturne au Parc des Princes au printemps 1952. À partir de là, en effet, il investit de mouvement le motif des tesselles que ses paysages d’alors avaient déjà entrepris de resserrer. Dans ses variations autour du football, qu’il s’agisse d’une toute petite huile sur carton ou d’une vaste peinture d’histoire (Parc des Princes, 1952, collection particulière, étonnamment le musée des Beaux-Arts de Dijon et le musée Granet d’Aix-en-Provence n’ont prêté aucun de leurs Footballeurs), les cubes ne se juxtaposent plus mais s’opposent, si bien qu’ils ressuscitent du même coup les formes bâtonnées de la première période.
Bien qu’elle soit de courte durée, cette redynamisation des compositions de Staël semble leur avoir ouvert le passage à une spatialisation d’une autre nature que les précédentes. Ciel à Honfleur (1952, collection particulière), Mer et nuages (1953, id.) et les autres marines de ces années-là ont ceci d’océanique qu’elles décrivent un mouvement sans que le peintre recoure aux éléments formels (bâtons, cubes) qu’il savait susceptibles de l’accélérer mais aussi de l’entraver. Tout repère aboli, les couches se superposent à présent en extension sans pour autant perdre en profondeur, à la manière de pages déchirées dont les déchirures dessinent une frange où les ondes se mêlent aux nuées et au vent – car Staël peint le vent. S’il reprend néanmoins çà et là certains motifs, ceux-ci continuent de se dissoudre progressivement dans l’économie générale de ses figures, dans ses nus (Femme assise, 1953, collection particulière) aussi bien que dans ses paysages (Le Soleil, 1953), jusqu’au point de rencontre entre les deux qu’instaure l’arbre.

À première vue, il concasse encore ses Arbres bleus (1953, coll. particulière), mais son Arbre rouge (1953, id.), quant à lui, se met littéralement à saigner. Or, par où la peinture saigne elle commence à se dissoudre, à la fois géométriquement (par quoi on retrouve le principe d’agencement) et chromatiquement (en sorte que le peintre obtient à l’huile le fondu qu’il tirait de l’encre de Chine). Avec La Palette (1954, coll. particulière) et Coin d’atelier fond bleu (1955, musée national d’Art moderne), son Nu couché bleu (1955, coll. particulière) est sans doute le résultat le plus fulgurant de ce sang-fusion qu’est devenue sa peinture peu avant que Staël ne mette fin à ses jours, alors qu’il peignait sa peinture la plus vaste, Le Concert (1955, musée Picasso d’Antibes).
Dans ces conditions, on ne peut que regretter que cette immense toile (de 3,50 m de haut sur 6 m de long) n’ait pas fait le voyage jusqu’aux quais de Seine, et s’étonner davantage que Les toits (1952), moins imposant mais tout aussi monumental (1,50 m par deux), n’ait pas quitté les cimaises de Beaubourg. L’une et l’autre peintures constituent en effet celles où le peintre, à la manière de Paul Cézanne, a résumé son apport : des Toits murés sous un ciel de zinc où se lit sa facture fracturée et, trois ans plus tard, une symphonie en cours d’exécution dans une mer rouge-sang, entre un piano à queue pour les graves et une contrebasse plus haute qu’un homme montant dans les aigus, les deux instruments et la mer avec eux dégouttant de peinture.
Il y aurait naturellement quelque chose d’indécent, et par surcroît d’outrecuidant, à considérer, comme on le dit dès 1955, qu’un homme parvenu à ce point de son art ne pouvait que mettre fin à ses jours, comme s’il n’avait pas eu la force de continuer, d’aller plus loin : ce que tout le parcours pictural de Staël dément. Pas plus qu’il n’y a de nécessité à ce qu’une forme succède à une autre forme sous son pinceau, ni de sommet que l’une d’elles permettrait d’atteindre une fois pour toutes, il n’y a de fatalité à ce que la peinture se retourne contre la vie de celui qui la lui a dédiée.
Il y aurait néanmoins quelque légèreté, une légèreté rassurante, à envisager qu’un homme qui voit tout en peinture et entend tout traduire à travers elle jusqu’à ne plus savoir s’exprimer qu’en sa langue, qui ne perçoit ce qui l’entoure – êtres et choses – que sous des dehors de motifs et de couleurs et de lignes à associer, qui brûle d’inquiétude à l’idée de ne pas savoir en restituer la vivacité à défaut de rendre la vie elle-même ; ce serait juger légèrement l’existence d’un tel homme que de croire qu’il ne s’est pas consumé à force de fulgurances, et manquer singulièrement d’imagination que de ne pas croire qu’il en soit venu quelquefois, en considérant les autres, à se maudire d’avoir été peintre au lieu d’être comme eux.