David Grann est un des grands maîtres de la « littérature du réel », que les anglophones désignent aussi par le terme de non-fiction. Avec l’épopée tragique du HMS Wager, vaisseau de la flotte impériale britannique mandaté vers les Amériques dans le cadre d’une mission extrêmement périlleuse, l’écrivain trouve la plus belle matière pour déployer tout son talent narratif, mélange détonnant de souffle romanesque et de rigueur journalistique.
Les naufragés du Wager se présente comme un magnifique roman d’aventures dont l’intrigue, fascinante à bien des égards, est menée tambour battant. Il se double d’une réflexion très contemporaine sur l’essence et le rôle des récits dans nos sociétés. Le sentiment d’immersion que procure sa lecture est proprement sidérant.
« Force est de reconnaître que je n’ai pas vu le navire heurter le récif ni l’équipage ligoter son capitaine. Je n’ai été témoin d’aucune de ces tromperies, d’aucun de ces meurtres » : dans son mot d’introduction, l’auteur nous prévient, il n’a pas assisté aux événements – et pour cause, ils se sont déroulés il y a plus de trois siècles.
Arrêtons-nous justement sur ce point. Il existe plusieurs courants au sein du Nouveau Journalisme contemporain. Parmi les plus caractéristiques, citons : les récits en « infiltration » (l’auteur dissimule son identité pour les besoins d’une enquête, allant jusqu’à apprendre un métier pour en saisir tous les rouages), les récits en immersion (l’auteur ne cache pas la finalité de son projet mais s’efforce de se fondre dans un environnement, y passant des mois, voire des années, un peu à la manière d’un sociologue ou d’un ethnologue). Puis, autre catégorie, ce qu’on pourrait appeler les « récits documentaires » : l’analyse extrêmement poussée d’un fait de société ou d’un événement spécifique, en général proche dans le temps – analyse qui, par la suite, prend la forme d’un récit haletant. Le livre de Grann fait partie de cette dernière catégorie, seulement – c’est là son originalité – il se penche sur une histoire très ancienne. D’où l’impression d’étrangeté qu’il produit : Grann traite d’un sujet historique (en cela, déjà bien codifié) avec les outils propres à notre époque. Le rendu est comparable à celui d’un documentaire composé d’images filmées dans un siècle éloigné – ce qui bien sûr est impossible, puisqu’il s’agit d’une période antérieure à la photographie.
Comme tous les journalistes littéraires, David Grann utilise les techniques narratives traditionnelles du roman. Pour autant, il n’invente rien. On pourrait considérer cependant qu’il « reconstitue » le passé, avec un très fort souci d’authenticité. Il s’est efforcé de rester le plus fidèle possible aux faits – à la vérité objective – en effectuant un travail de recherche colossal. Pour saisir son ampleur, il suffit de se reporter aux notes et à la bibliographie en fin d’ouvrage, accumulation inouïe de documents que Grann a épuisés à la manière d’un historien doublé d’un détective. En outre, il s’est rendu lui-même sur la fameuse île où ont échoué les marins, périple de trois semaines qui a lui permis de prendre la mesure de cet environnement inhospitalier. Il a même retrouvé quelques fragments de l’épave du HMS (His Majesty’s Ship) Wager sur les plages désolées de l’île.
La question de la quête effrénée de la vérité, si cruciale en ces temps de post-truth, est au cœur du journalisme littéraire. Richard Preston, autre spécialiste du genre, l’a parfaitement défini : « En échange, le lecteur accepte de ne pas invoquer la “suspension consentie de l’incrédulité”, la clause essentielle du contrat entre le lecteur et le romancier. Avec la non-fiction, le lecteur peut croire que les faits sont réels, même s’il a l’impression parfois de lire de la fiction. L’alliance entre le récit littéraire et la vérité que propose la non-fiction aboutit parfois à une expérience plus puissante que celle du roman [1] ».
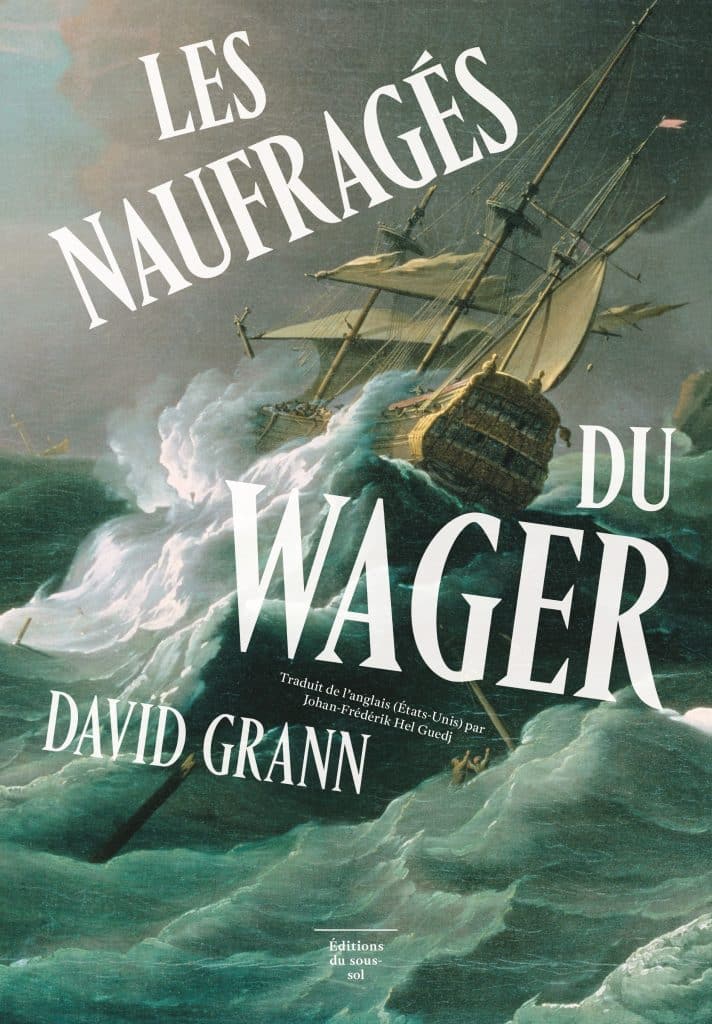
Certes, si au fond la vérité nous échappe toujours, elle demeure une valeur cardinale du Nouveau Journalisme. Un moyen de lutter contre la prolifération des récits mensongers, si toxique pour nos sociétés, qui contribue entre autres à l’essor du populisme le plus décomplexé. On sait à quel point ce thème est brûlant aux États-Unis en ce moment avec les inculpations historiques d’un ancien président, coutumier de la fabrication de faux récits.
En 1740, l’Empire anglais et l’Empire espagnol se livrent une guerre sans merci sur les mers. L’objectif est d’accroître leurs richesses, d’étendre leur territoire. Il y a une part de démesure dans cette soif inextinguible de conquête coloniale, sur fond d’injustice, de cupidité et de cynisme sans borne. C’est dans ce contexte historique qu’une escadre composée de six navires part en Amérique du Sud pour une mission secrète, dont le but est de prendre en chasse un galion espagnol, afin de récupérer son butin.
L’expédition est dirigée par le Commodore Anson, à la tête du plus imposant des navires, le Centurion. L’itinéraire prévu est celui de tous les dangers : après avoir traversé l’Atlantique, il faudra doubler le cap Horn – pire site imaginable pour naviguer, avec des ouragans incessants, des courants redoutables, des températures extrêmes –, avant de longer les côtes chiliennes et de rejoindre l’océan Pacifique, tout cela avec les moyens techniques rudimentaires de l’époque. Il apparaît vite que la mission est vouée à l’échec. Premier problème : le manque d’effectifs. Dans un passage remarquable (un des plus forts du roman), David Grann décrit l’attente autour de la ville portuaire de Portsmouth, les préparatifs qui n’en finissent pas. Il enchaîne une série de tableaux stupéfiants : on est à la fois sonné par la beauté des scènes, et horrifié par ce qui se joue petit à petit – l’enrôlement de force d’habitants, d’infirmes (on fait monter sur les bateaux des malades étendus sur leurs couchettes !) et même de bandits… la folie couve déjà.
À partir de là, les choses vont aller de mal en pis. Tout débute avec les épidémies. La première à décimer les marins est le typhus, véritable fléau qui ravage les équipages avant même que les bateaux aient pris la mer. À peine ont-ils le temps de se remettre que le scorbut se répand, tuant en masse. L’ironie est que cette maladie atroce trouve son origine dans une simple déficience en vitamine C – et aurait donc pu facilement être évitée. Bientôt, ce sont les intempéries qui frappent le convoi. Les vaisseaux sont obligés de se séparer et les commandements de se répartir autrement. C’est ainsi que Cheap se retrouve à la tête de l’un des navires, le HMS Wager, sur lequel l’intrigue va maintenant se nouer.
La personnalité complexe de Cheap est décrite avec subtilité par Grann. Le capitaine n’avait jamais dirigé de navire tout seul jusqu’alors. C’est un aristocrate, un ambitieux, un navigateur excellent aussi, mais endetté et éprouvant un désir presque maladif de reconnaissance. Le Wager, bateau de dimensions réduites, pas assez puissant pour affronter les mers du Sud, subit les conséquences d’une première erreur de Cheap. Le capitaine décide d’aborder le cap Horn pendant l’été austral ; certes lorsque l’air est le moins froid, mais le moment aussi où la mer est le plus impraticable.
De nombreux marins périssent dans la succession des tempêtes. Le Wager, seul à présent, isolé, sans aucun moyen de communiquer, fait naufrage sur une petite île. Commence alors la seconde partie du récit, que l’on pourrait qualifier de « survivaliste », l’île n’ayant rien à voir avec celle, idyllique par comparaison, de Robinson. Le climat est redoutable, il n’y a rien pour se nourrir, ce qui conduira les marins à se retourner contre leur capitaine, le rendant responsable de leurs malheurs.

Deux personnages apportent un contrepoint à Cheap : d’une part le chef des mutins, le canonnier Bulkeley, personnage charismatique et leader né, lui aussi ambivalent, à la fois homme réfléchi et pétri d’une rigueur religieuse qui l’amène à mal communiquer avec ses supérieurs. Enfin, et surtout, l’enseigne John Byron, âgé de seize ans au moment où il embarque, grand-père de l’illustre poète.
C’est sur la confrontation des trois points de vue que va se construire en grande partie le récit. Chacun a rédigé son propre journal de bord, anticipant qu’il pourrait servir plus tard de témoignage dans le cas d’un éventuel procès. C’est évidemment pour Byron que Grann éprouve le plus de sympathie, du fait de son jeune âge, de sa sensibilité et du regard encore émerveillé qu’il porte sur le monde maritime.
Pour autant, Grann n’omet pas de mentionner que Byron était, comme les autres, acteur d’une société coloniale et pétri du racisme des Anglais. Un point important, car à plusieurs reprises les indigènes viennent en aide aux naufragés, leur offrant même une issue éventuelle… Mais les marins, ne pouvant se résoudre à les voir autrement que comme des êtres inférieurs, vont les humilier et les indigènes finiront par se détourner d’eux.
La situation sur l’île empire. Les marins meurent de faim, certains se livrent même à des actes de cannibalisme. Toutes les bases morales s’effondrent. On est en plein dans les thèses de Hobbes (cité dans le roman) : extraits de la société, les marins sont principalement mus par la peur et la convoitise.
Un jour, Cheap, qui s’efforce toujours d’exercer son autorité, assassine un jeune marin ivre. C’est le départ de la mutinerie, qui sera au cœur du procès tenu en 1746 — soit six ans après l’affaire : le meurtre du marin par le capitaine d’un côté, la rébellion de l’équipage de l’autre. Bulkeley et ses hommes attaquent Cheap. Le groupe se scinde, l’un empruntant une embarcation de fortune avec l’espoir de rejoindre le Brésil, l’autre, vaincu (Cheap et ses fidèles) demeurant prisonnier de l’île maudite. Le plus étonnant étant qu’il y aura des survivants des deux côtés… Bulkeley et une partie de ses complices, après de multiples péripéties, vont parvenir à gagner le Brésil via le détroit de Magellan et enfin l’Angleterre, suivis par Cheap et ses hommes, qui réussissent à quitter l’île grâce à des autochtones quelques mois plus tard.
Bulkeley, de retour au pays, s’est empressé de publier un livre, pour se prémunir de toute accusation. Et déjà, de nombreux récits rivalisent pour raconter l’histoire du naufrage, désormais célèbre. À l’époque, les Anglais raffolaient de ce type d’écrits – c’est un autre aspect essentiel du roman : après la guerre avec les éléments, la guerre avec les canons, vient le temps de la guerre des récits. Grann excelle à montrer le pouvoir fascinant des histoires qui se confirment, s’infirment et se déplient sans fin. Les protagonistes eux-mêmes sont partis en mer avec divers comptes rendus de voyages dans leurs malles, en particulier le jeune Byron, pour qui ces livres constituent une porte d’entrée dans le monde des océans. Ils deviendront à leur tour auteurs de leur propre vie, inspireront par la suite de grands écrivains comme Patrick O’Brian, Herman Melville, Joseph Conrad ou Stephen Crane.
Quelques années après le retour des rescapés, le procès a enfin lieu, et son issue constitue l’un des rebondissements les plus étonnants du récit – que l’on se gardera bien de dévoiler ici. Quoi qu’il en soit, pour David Grann, le vrai coupable n’est pas l’individu, mais la société tout entière. Il change de focale et nous révèle l’autre sujet de son livre : « Les auteurs se présentaient rarement, leurs compagnons et eux, en agents du système impérialiste. Ils étaient la proie de leurs propres luttes quotidiennes et de leurs ambitions, occupés à manœuvrer leur navire, à obtenir des promotions et à gagner de l’argent pour faire vivre leur famille et, en fin de compte, à leur survie. Mais c’est précisément cette complicité irréfléchie qui permet aux empires de prospérer. En fait, c’est exactement ce dont ces structures impérialistes ont besoin : des milliers et des milliers de gens ordinaires, innocents ou non, qui servent un système, qui se sacrifient même souvent pour lui, sans qu’aucun, ou presque, ne le remette jamais en question ».
La prose de Grann est admirable de bout en bout ; son style visuel et percutant, enrichi par un lexique maritime utilisé de manière très judicieuse. Il y a quelque chose de l’Odyssée dans Les naufragés du Wager.
[1] Entretien de Richard Preston dans Le temps du reportage de Robert S.Boynton.
Sven Hansen-Løve est romancier, auteur d’Un emploi sur mesure (Editions du Seuil, 2018). Il prépare actuellement, à l’Université de Cadix, une thèse sur le journalisme littéraire.












