Bleu nuit, le deuxième roman de Dima Abdallah, sonde de nouveau la trajectoire mémorielle d’un homme aspirant à l’amnésie. Dans le Ménilmontant des années 2010, un journaliste quinquagénaire tente de réprimer sa mémoire à coup de vaillants rituels obsessionnels. Dima Abdallah livre un roman dense et poignant tressé d’amères leçons proustiennes.
Dima Abdallah, Bleu nuit. Sabine Wespieser, 232 p., 20 €
Dans Mauvaises herbes, son premier roman, Dima Abdallah donnait successivement à entendre les voix isolées d’un père et de sa fille dans le Beyrouth des années 1980, en pleine guerre civile. Ces intériorités solitaires semblaient communiquer entre elles à travers la superposition de leurs monologues, malgré les silences creusés par le temps et l’exil. L’autrice s’attachait à dépeindre leur perpétuelle négociation avec la mémoire, le père devenu au cours des années un être « doué pour l’oubli », et la jeune femme exilée à Paris s’arrangeant tant bien que mal avec le poids des souvenirs.
L’oubli se présente chez Dima Abdallah comme une recherche privilégiée, un principe réparateur et salvateur, comme une manière intime et personnelle de persister dans le monde. À lire les premières pages de Bleu nuit, on devine que vouloir oublier est une entreprise presque irréalisable.

Cimetière du Père-Lachaise, Paris © Jean-Luc Bertini
Le roman commence comme s’il était le livre d’une seule voix, d’une seule couleur. Ses premières pages ne laissent en rien présager son élargissement mémoriel et poétique à venir, tant les échos du souvenir paraissent s’étouffer dans la circularité blanche et feutrée d’un quotidien ritualisé, celui d’un homme ayant développé « une vraie passion pour le ménage ». Du Liban, des prénoms, des sens en éveil, des musiques et de l’enfance, rien ne parvient encore. Cet homme, dont le lecteur ne connaîtra jamais le nom, narrateur de l’oubli par excellence, vit depuis des années dans l’espace clos de son appartement. Menacé par des crises d’angoisse, journaliste en télétravail qui n’a jamais visité les expositions sur lesquelles il écrit, il finit par se précipiter au dehors et vivre dans la rue pour échapper aux souvenirs qui l’assaillent. C’est à l’annonce du décès d’une femme autrefois aimée, Alma, que surgiront les premières images bleues du livre, le souvenir d’une mer à Cabourg en hiver, image elle-même vouée à repousser le souvenir plus refoulé encore de la Méditerranée en été.
Comme des régions que l’on arpente sans y prendre garde, la mémoire dans Bleu nuit épouse la structure d’une surface archéologique. Il y avait déjà dans Mauvaises herbes le motif de la fouille et l’image de strates que l’on se retient pourtant d’explorer. De façon plus sensible encore, on retrouve dans Bleu nuit ce même motif de l’architecture d’une mémoire qui s’offre par couches successives. L’une des puissances narratives du roman repose sur cette appréhension progressive de la mémoire : une première strate du souvenir renvoie par écho à une seconde, et, de bleu en bleu, le lecteur pénètre de façon graduelle dans l’opacité d’un passé enfoui.
Mais la force principale du roman repose sans doute sur cette persistance du narrateur à vouloir vivre pour oublier. Cette insistance quasi éthique exacerbe de façon très nette l’intensité d’une violence repoussée au plus loin (ici, celle de la guerre civile libanaise) et l’expose au lecteur, de façon sourde et suggestive, plus crûment encore. Dans les romans de Dima Abdallah, la guerre civile retentit dans la vie des êtres à travers leurs propres corps. Ce sont les corps qui traduisent la mémoire des chocs. Les angoisses du narrateur de Bleu nuit rappellent la respiration saccadée de la petite fille de Mauvaises herbes, dont la crise d’angoisse avait alors ressuscité de violents souvenirs chez le père. Dans les deux romans, les protagonistes sont comme des foyers de souvenirs, des vecteurs de réminiscences. Chacun rappelle à l’autre ce qu’il s’emploie lui-même à oublier.
Bleu nuit se présente comme un maillage d’images et d’échos, de berceuses oubliées, de voix familières, de lueurs nocturnes et de visions bleutées. Les rues du XXe arrondissement de Paris deviennent – pour ce narrateur qui cherche à faire « redescendre le bleu » – une topographie symbolique et sensorielle, le lieu de réminiscences aléatoires, en même temps que la géographie mentale de nouveaux rituels. Dans la rue, il y a les étourdissements des bains de foule rue des Pyrénées, il y a la « cartographie des odeurs de linge propre et de pain chaud » vers lesquelles le narrateur aime à se diriger. Il y a surtout les rendez-vous à heure fixe que le narrateur se donne avec certaines passantes qu’il rencontre aléatoirement, et chez lesquelles il décèle une profonde solitude : Emma aux allures sculpturales d’un Giacometti, Ella et sa beauté botticellienne, Martha la fée, Aimée la magicienne… Et les prénoms et souvenirs à partir d’elles qui reviennent par effet de contiguïté : la cousine Hana, la tante Zeina, les grands-mères Bahia et Alya. C’est à ces occasions que des visions et des chansons surgissent – notamment une berceuse oubliée qui ponctue de façon lancinante les douloureux rappels du passé – et que remontent les premiers souvenirs familiers.
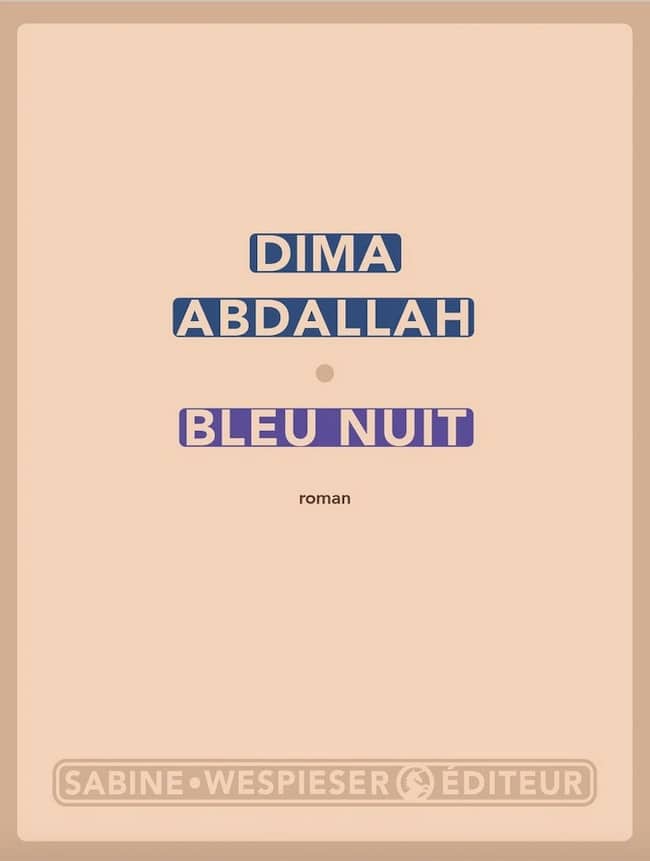
Mais, à chaque séquence du livre, ce sont des leçons de réminiscences que le narrateur s’attache à anéantir : « Je marche du matin au soir pour que mon corps en mouvement vide mon esprit. […] J’arpente le quartier en évitant toujours mon ancienne rue et aussi la rue du Liban ». À rebours de la démarche littéraire proustienne, le livre de Dima Abdallah se fonde à la manière d’un berceau-tombeau : le narrateur du roman ne cesse de faire mourir ce qu’il est appelé en permanence à faire renaître. Cette recherche persistante de l’oubli produit les effets les plus poétiques du texte. Des crises d’angoisse provoquées par les réminiscences de la mémoire, surgissent les visions les plus illuminées. Dans la souffrance angoissée de ce promeneur solitaire, le monde se dérègle, et les hallucinations sensorielles se muent en des visions poétiques aux accents très rimbaldiens : « Ce sera la tempête providentielle. Il pleuvra rouge du matin au soir jusqu’à ce que fleuve et rivière deviennent couleur de sang. Je serai un arbre triomphant des étés morts et enterrés. »
Il y a dans Bleu nuit les relents d’une violence qui côtoie les plus beaux souvenirs. Dima Abdallah parvient à traduire la marginalité des êtres, qui s’exprime fondamentalement dans le rapport que chacun des personnages entretient intimement avec la violence et la mort. Le jeu sur le symbole des prénoms (Layla, compagne de la nuit, et Nour, prénom entre autres de la mère du narrateur signifiant la lumière) lève dans le roman le faisceau symbolique d’une lumière perdue avec laquelle le narrateur cherche à renouer. Comme un perpétuel enfant (infans, celui qui ne parle pas encore) qui cherche à grandir et apprend à renouer avec sa langue et avec sa mémoire, le narrateur de Bleu nuit vit son exil dans le monde, et voit dans toutes celles qu’il rencontre l’équivalent de son isolement. Comme la dernière prière de Bleu nuit, on se souvient de la dernière adresse de la jeune femme exilée à Paris qui clôt Mauvaises herbes : « Ce qui a survécu de moi, comme les mauvaises herbes, a un petit quelque chose d’intraitable. Ce qui a survécu de moi continue à être un peu seul. »
On est frappé par la densité de ce texte qui s’enrichit des pulsations discontinues de cette « mémoire indocile ». Dans ses monologues, Dima Abdallah parvient d’une manière singulière à se saisir des soubresauts intérieurs de la conscience, à peindre la radicalité d’une solitude qui s’avère être aussi le siège d’une mémoire infiniment colorée et peuplée. Le narrateur porte avec lui des phrases qui l’accompagnent, il les écrit dans un carnet au fil de sa marche, et l’on songe aux déambulations du poète mélancolique des Petits poèmes en prose baudelairien, mais on trouve aussi au fil du chemin Céline, Camus… et c’est à partir de cette mémoire littéraire que la prose du narrateur finit par renvoyer à autre chose qu’elle-même, que les rapports analogiques, d’ordre poétique, surgissent.
Bleu nuit ne donne pas seulement à lire le récit d’un narrateur qui se souvient. C’est aussi le roman d’un homme qui, au contact du monde, recrée sa propre mémoire. D’une mémoire sensorielle pleinement ressuscitée, celle-ci se découvre aussi, comme dit le narrateur du roman, pleinement poétique : « Je crois que cette mémoire poétique est la plus puissante de toutes. Elle est invincible. Elle est faite de tout ce qu’on a senti et ressenti. Ce qu’on a vécu et ce qu’on a senti ne peut être séparé. Je dirais même plus : ce qu’on a vécu est avant tout ce qu’on a senti. »












