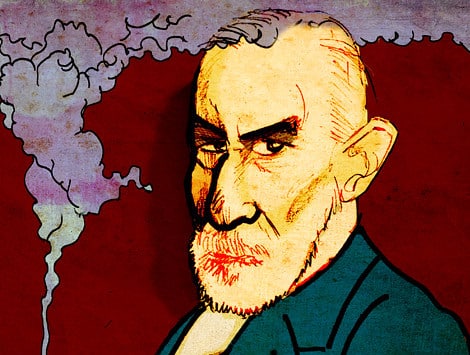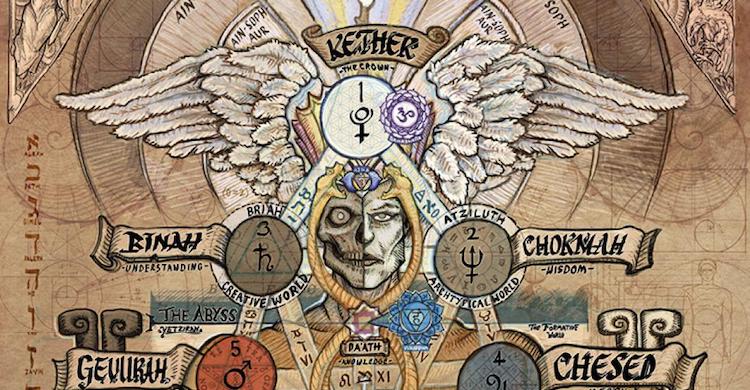Le dernier né de Catherine Chabert, Les belles espérances, prolonge une fratrie dédiée en grande partie à l’exploration du féminin au sens psychanalytique du terme, c’est-à-dire un « féminin » qui n’est pas l’apanage des seules femmes, même si elles en sont souvent les porte-parole. En effet, Freud est mort en laissant à ses successeurs un chantier immense, ce « continent noir de la féminité », si terrifiant pour lui, peut-être en ce qu’il serait paradigmatique de l’inconscient lui-même.
Catherine Chabert, Les belles espérances. Le transfert et l’attente. PUF, coll. « Le fil rouge », 180 p., 21 €
Catherine Chabert fait partie des psychanalystes qui ont relevé ce défi, depuis Féminin mélancolique (2003), en passant par L’amour de la différence (2011) et La jeune fille et le psychanalyste (2015), pour montrer que ce continent n’est pas si noir que ça, qu’il comporte une infinité de nuances. Dans une palette qui va du rouge le plus vif au noir profond, Catherine Chabert et ses analysants, ensemble, cherchent le ton juste, le détail vrai.
Maintenant, il faut se quitter… (PUF, 2018) traitait de la séparation, ménageant ainsi, à travers l’ouverture des points de suspension, la transition avec le thème du présent ouvrage, l’attente. Quel rapport entre le féminin et l’attente, pourrait-on se demander ? C’est par le biais d’une réflexion sur la position d’attente du psychanalyste, si difficile à tenir qu’elle nécessite un long apprentissage, que Catherine Chabert aborde cette question centrale qui interroge un autre « continent noir » des psychanalystes, celui qu’on appelle le contre-transfert.
L’attente est donc un sujet éminemment psychanalytique, indissociable du transfert et de l’espoir placé entre les mains de l’analyste. Roland Barthes l’avait bien compris, quand il écrivait dans Fragments d’un discours amoureux : « (Dans le transfert, on attend toujours – chez le médecin, le professeur, l’analyste. Bien plus : si j’attends à un guichet de banque, au départ d’un avion, j’établis aussitôt un lien agressif avec l’employé, l’hôtesse, dont l’indifférence dévoile et irrite ma sujétion ; en sorte qu’on peut dire que, partout où il y a attente, il y a transfert) ». Les parenthèses inscrivent dans la matière même du texte cet espace intermédiaire, salle d’attente, lieu de tous les espoirs et de toutes les angoisses, qu’est une séance analytique. Dans ce fragment de Barthes, la frontière entre l’analyse et la vie quotidienne se dissout dans l’attente incertaine, énervante, face à l’indifférence du monde. Toute personne qui attend se retrouve en analyse, en quelque sorte.
Attendre et espérer est donc notre lot commun, et Catherine Chabert part de la littérature pour donner le ton, en faisant appel à Dumas et son Comte de Monte-Cristo, et surtout à Dickens et ses Great Expectations : deux romans à suspense où la vengeance, plat qui se mange froid, joue un rôle important. Mais un train peut en cacher un autre, et la traduction chabertienne du titre de Dickens par Les belles espérances (plutôt que « grandes ») reflète bien plus finement l’ironie (toute féminine ?) du titre anglais. Dans ce roman, les apparences sont trompeuses, les rêves grandioses voués à la perte et à la désillusion, mais c’est le mouvement de la vie et du hasard qui finit par emporter le héros, Pip, vers sa bien-aimée. De même, décrivant le processus analytique, Chabert évoque ce long cheminement vers l’objet tant attendu, tant recherché, comme une traversée : « un chemin à travers des obstacles, des remous, des vagues, des tempêtes […] Ce qui compte, c’est l’exigence de mouvement ». L’attente, ce temps suspendu dans l’entre-deux, vient donc ici condenser la question difficile du contre-transfert de l’analyste, qui « contient le transfert sur le patient et sur l’analyse ».

« La salle d’attente, ou le quart-d’heure de réflexions désagréables » par Honoré Daumier (1855) © CC/Paris Musées/Musée Carnavalet
Ce qui fait peut-être l’originalité de ce livre, c’est que l’auteure s’expose justement en tant qu’analyste femme, aux prises avec les attentes, les projections et transferts de ses analysants. Rien n’est neutre en psychanalyse… Par exemple, Élodie : « avant de prendre contact avec moi, on lui avait dit que j’étais une femme chaleureuse, et, en me voyant, elle avait pensé “une femme de feu !” mais voilà, en lieu et place, elle trouvait une femme de glace qui ne faisait rien pour elle ». Un autre patient, Eugène, lui avoue avoir été attiré par son rouge à lèvres. La séduction est là, avec son corollaire, la trahison : les patients sentent bien que le véritable objet de passion de leur psychanalyste leur échappe. Mais, comme l’écrit Catherine Chabert, « le feu ne s’éteint pas, parce qu’il est entretenu par le contre-transfert dans chaque moment déceptif, chaque moment heureux de l’analyse. Le découragement ou la jubilation, le dépit et la colère, la blessure et l’enthousiasme, l’ennui et l’excitation sont évidemment déclenchés par les pulsions et leurs représentants, la scène et le théâtre peuvent toujours s’embraser à nouveau ». Aussi nous prévient-elle : ce livre parle d’elle, de l’analyste dans ses doutes, attentes, impatiences, projections ; « Il est impossible de séparer le transfert du contre-transfert : en présentant une cure, l’analyste s’expose lui-même autant que le patient dont il parle ».
Comment supporter l’immobilité, le silence ? Que se passe-t-il dans la tête de l’analyste pendant qu’il écoute, qu’il attend, pendant cette parenthèse-là ? Est-il impatient ? C’est là peut-être qu’intervient le rôle de la théorisation, ce travail souterrain, interne, de traduction, d’élaboration, de perlaboration aussi, soutenu par les outils de pensée donnés par la théorie. On voit bien l’usage qu’en fait Catherine Chabert, comme pour ralentir le tempo de l’action, calmer l’excitation qui émane des vignettes cliniques. Et le lecteur doit aussi s’arrêter, prendre le temps de souffler, alors qu’il voudrait bien connaître la suite de l’histoire. Le texte fait alterner des passages cliniques d’une grande intensité et des passages théoriques extrêmement condensés qui nous obligent à ralentir la lecture, à relire, à mettre en attente notre désir de tout comprendre, et vite. Il reflète dans sa forme même ces mouvements de l’analyse, avec ses accélérations et ses ralentissements, ses moments d’arrêt puis de reprise, de traduction et de retraduction, des deux côtés du divan. La position d’attente de l’analyste – et n’oublions pas que l’attente est aussi là pour faire durer le plaisir – en est donc la condition sine qua non : « Pour l’heure, le patient ne peut pas toujours se remémorer, l’inconscient prend d’autres voies, non plus seulement les mots, non plus seulement les souvenirs, mais aussi les actes. Une tâche essentielle attend alors le patient, celle de la perlaboration et celle-ci requiert chez l’analyste une position indispensable sans laquelle le processus serait empêché : il faut attendre ».
Il faut attendre, certes, mais comment attendre l’inattendu ? C’est l’injonction paradoxale à laquelle est confronté le psychanalyste et qui fait pendant au « soyez spontané » adressé à l’analysant. Comment s’en sortir ? Catherine Chabert plonge dans un bain à remous clinique et théorique qui bouscule à son tour le lecteur ; mais s’il est patient, il y verra peu à peu apparaître une des formes inattendues.
En effet, tout en parlant de Freud – quoi de plus banal pour un psy –, Catherine Chabert arrive à surprendre, à émouvoir. C’est sans doute le fruit de ce rapport si serré entre une théorie vécue et une clinique pensée : les deux se tricotent, changent de place dans un mouvement d’aller-retour constant entre plusieurs scènes qui se superposent, une mise en abîme où se reflètent, se confondent et se séparent les différentes scènes qui se jouent entre patient et analyste, d’un côté, et entre l’analyste et ses propres objets de transfert, de l’autre. Catherine Chabert souligne l’impact de ces déplacements incessants d’attentes sur le travail de l’analyste en séance. Mais souvent, ils permettent à l’analyste de freiner l’impatience d’un furor sanandi qui risquerait d’empêcher une maturation psychique qui ne peut être que lente, puisqu’elle n’est pas linéaire.
Si les deux attentes, celles du patient et de l’analyste, sont différentes, l’auteur souligne que l’analyste peut malgré lui « s’identifier aux attentes de son patient dans la collusion d’aspirations narcissiques toujours présentes ». Inversement, l’analysant intériorise peu à peu la capacité analytique de mise en suspens, cette capacité winnicottienne d’être « seul en présence de l’autre ». Le chemin parcouru par Eugène passe par le corps excitant de sa mère, retrouvé dans le rouge à lèvres de son analyste, pour aboutir à l’apaisement quand, à la faveur d’une porte qui s’ouvre enfin, revient le souvenir émouvant du parfum de sa mère venant l’embrasser le soir dans son lit. Athénaïs, après avoir terminé son analyse, revient de temps en temps chez son analyste lui raconter ses aventures, renouveler l’excitation de la première rencontre tout en se rassurant, se racontant qu’il y aura une prochaine fois.
Comme dans ses autres livres, dans Les belles espérances Catherine Chabert explore l’œuvre freudienne avec une virtuosité et une précision impressionnantes. Mais il n’y a pas que Freud qui aide Catherine Chabert à penser, la place qu’elle donne à Winnicott est centrale, même quand il est fortement critiqué, en particulier concernant ses positions sur le contre-transfert. Mais, au bout du compte, ce qui est exploré ici par Catherine Chabert, au-delà des complexités théoriques, c’est justement cet « espace intermédiaire, un entre-deux winnicottien, un lieu pour l’attente » où s’apprivoise l’absence, un entre-deux qui peut devenir un « entre-eux-deux », où l’enfant joue à la bobine, où la pensée s’improvise, un lieu d’être et d’imprévu.