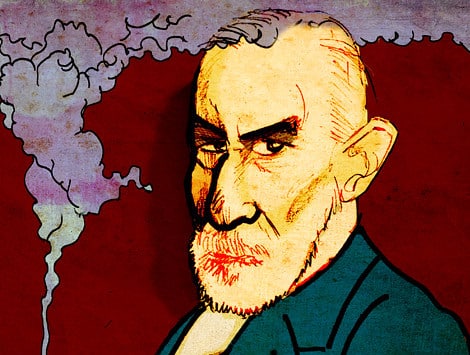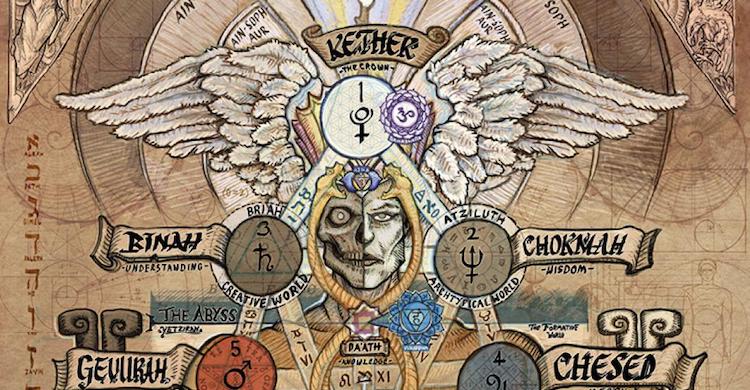Le texte du film de David Teboul, Freud, un juif sans Dieu, s’appuie en grande partie sur la correspondance de Freud avec ses proches. C’est un extrait d’une lettre à Martha Bernays, sa fiancée, qui, en ces temps de confinement, a attiré l’attention de la psychanalyste Zoé Andreyev.
David Teboul, Freud, un juif sans Dieu. Arte. Lundi 6 avril 2020 à 22.35 et sur arte.tv du 30 mars au 4 juin 2020
En 1886, Freud est à Paris pour suivre l’enseignement de Charcot. Il est séparé de Martha, non seulement par la distance, mais aussi par l’attente imposée à leur projet de mariage depuis déjà quatre ans du fait de sa situation financière encore instable ; ils se voient très épisodiquement, il lui écrit de longues lettres. Freud souffre de cette séparation, de cette mise en attente dont la durée est incertaine. Ses lettres sont remplies d’inquiétudes, de réassurances quant à la solidité de leur lien, de leur amour ; est-il vraiment à toute épreuve ?
Le 27 janvier 1886, Sigmund écrit à Martha : « Une chose m’a réellement surpris, non pas que tu m’aies pardonné si vite, car je sais que tu l’aurais fait, même si tu ne m’aimais plus, mais que de pareilles pensées te passent par la tête, de mauvaises pensées dont on reconnaît immédiatement qu’elles vous sont étrangères et qu’on ne peut néanmoins empêcher de surgir dans votre esprit ». Et le 2 février (extrait cité dans le film) : « Je n’ai cessé de te critiquer, de te réprimander et, en fin de compte, je ne désire rien d’autre que te posséder – et te posséder telle que tu es » (Sigmund Freud, Correspondance (1873-1939), Gallimard, coll. « Connaissance de l’inconscient », 1979, p. 210 et 214).

© Les Films d’Ici
Un lecteur averti (psychanalyste ou analysant) peut reconnaître dans l’intensité de cette correspondance et des affects qui s’y déploient le phénomène que Freud isolera plus tard, dans le laboratoire analytique, sous le terme de « transfert ». Le mouvement psychique d’autoanalyse freudien naît dans la douleur de la séparation combinée au plaisir d’une promesse de retrouvailles ; comme dans les romans épistolaires, c’est la dissymétrie temporelle qui donne naissance à l’intrigue, à l’excitation dangereuse de la liaison, avec son chassé-croisé de malentendus, d’attentes déçues, de quiproquos.
Les éditeurs des PUF ont donné le titre de La naissance de la psychanalyse à la correspondance de Freud avec Wilhelm Fliess, et l’on a coutume de considérer celui-ci comme le premier « transfert » freudien. Pourtant, la relecture de la correspondance avec Martha semble bien montrer que, si Freud peut être qualifié de « patient zéro » du « virus » de la psychanalyse, c’est Martha, bien avant Fliess, qui mérite le titre d’« analyste zéro » de l’histoire de la psychanalyse. L’addiction de Freud à l’écriture épistolaire ne trouve-t-elle pas ses racines dans cette attente, dans l’intensité de ce qui peut s’écrire, se dire, quand la réalisation physique du désir amoureux est empêchée, interdite ? Freud lui raconte ses rêves, sa vie quotidienne, ses pensées, son excitation à rencontrer Charcot, à entrer dans son monde, à traduire ses textes. Citons quelques passages de cette même lettre du 2 février : « Mais je bavarde, je bavarde ! Je voulais te dire tout autre chose, je voulais t’expliquer d’où vient que je sois si inabordable et si brusque avec les étrangers, ainsi que tu le dis… [Breuer] m’a dit qu’il avait découvert en moi, caché sous une timidité apparente, un être extrêmement hardi et sans peur. Je l’ai toujours pensé, mais sans avoir jamais osé en parler à personne. Il m’a souvent semblé que j’avais hérité de tout l’esprit d’insoumission et de toute la passion grâce auxquels nos ancêtres défendaient leur Temple, et que je pourrais sacrifier ma vie avec joie pour une grande cause. Et pourtant j’étais toujours si dépourvu de moyens, si incapable de traduire ces ardentes passions par des mots ou par des poèmes. Je me suis donc contenu et c’est cela, je crois, que les gens sentent en moi […] Mon doux trésor, je suis en train de te faire de bien stupides aveux et, à vrai dire, sans aucune raison, à moins peut-être que ce ne soit la cocaïne qui me délie la langue ».
Freud attribue à la cocaïne le pouvoir de lui « délier la langue », mais c’est l’écriture adressée à l’autre, dans l’intimité de la relation à deux, qui « traduit » véritablement cette déliaison : la feuille de papier est le lieu bien concret où viennent se coucher sous sa plume ces « ardentes passions », qu’elles soient amoureuses ou théoriques.
Trente-quatre ans plus tard, en janvier 1920 – il y a exactement cent ans –, Freud perdait sa fille Sophie, emportée par la grippe espagnole. Il écrit à son gendre Max Halberstadt : « Je n’ai pas besoin de te dire que ce malheur ne change rien à mes sentiments pour toi […] Pourquoi cette lettre ? Je crois que je ne t’écris que parce que nous ne sommes pas ensemble et, en cette malheureuse époque d’emprisonnement, ne pouvons aller vous voir, de ce que je ne puis te dire les choses que je répète à ta mère, à tes frères et sœurs, à savoir que c’est un coup absurde et cruel du destin qui nous a ravi notre Sophie ».

Martha Bernays
À ses patients qui s’allongent sur le divan, Freud conseille : « Donc, dites tout ce qui vous passe par la tête. Comportez-vous à la manière d’un voyageur qui, assis près de la fenêtre de son compartiment, décrirait le paysage tel qu’il se déroule à une personne placée derrière lui. Enfin, n’oubliez jamais votre promesse d’être tout à fait franc, n’omettez rien de ce qui, pour une raison quelconque, vous paraît désagréable à dire » (« Le début du traitement », 1913). Le documentaire de David Teboul illustre à sa façon l’injonction freudienne de l’association libre, qui n’est possible que lorsque celui qui parle, qui pense, qui rêvasse, est physiquement immobilisé, confiné, dans son « compartiment de chemin de fer », sur le divan. Les images qui défilent viennent-elles du dehors ou du dedans ? Difficile de faire la différence… le rapport complexe que le réalisateur établit entre texte et image n’est pas sans rappeler aussi ce mouvement de dissociation-association, de séparation-retrouvailles entre le mot et la chose, de symbolisation qui est aussi celui de la relation épistolaire.
« De quel lieu nous séparent donc les signes ? », écrit J.-B. Pontalis dans un texte intitulé « L’attrait du rêve » (La force d’attraction, Seuil, 1990), où il évoque un patient, un certain « Peter », dont il avouera un peu plus loin qu’il s’agit en fait du personnage d’un roman de George du Maurier, Peter Ibbetson, dont Henry Hathaway a tiré un film en 1935. « Le héros qui passera finalement le plus clair de ses jours dans une sombre prison […], séparé de la femme aimée, non seulement il la retrouve dans ses rêves, mais il partage avec elle le même rêve. C’est ainsi qu’ils resteront vingt-cinq ans en compagnie l’un de l’autre, sans se quitter. C’est ainsi, mieux encore, qu’il connaîtront l’être intérieur de l’autre […], plus intimement liés que jamais deux mortels l’ont probablement été depuis le commencement du monde. »
Quelle est la « grande et progressive découverte de notre héros » ? se demande Pontalis. « Elle tient tout entière dans ces deux mots : […] Qu’est-ce que rêver vrai ? C’est d’abord obtenir du rêve un sentiment de réalité assez intense pour qu’il cesse – je cite Peter – d’être une simple surface ». Le fantasme du « rêver vrai » est-il celui qui guide le cinéaste ? Dans le film de David Teboul, l’alternance entre noir et blanc et couleur, la colorisation des films d’archive, les pépiements d’oiseaux de la bande-son, signent la condensation onirique de l’image d’archive qui devient, elle aussi, un rêve partagé, un rêve plus vrai que nature, un rêve qui nous rend – le temps d’un rêve – un Freud vivant, souffrant, jouant, aimant. Peut-être la plus belle image est celle qui clôt le documentaire : debout sur la terrasse de la maison de campagne, on voit Freud s’éloigner, quitter le cadre… pour aller où ?