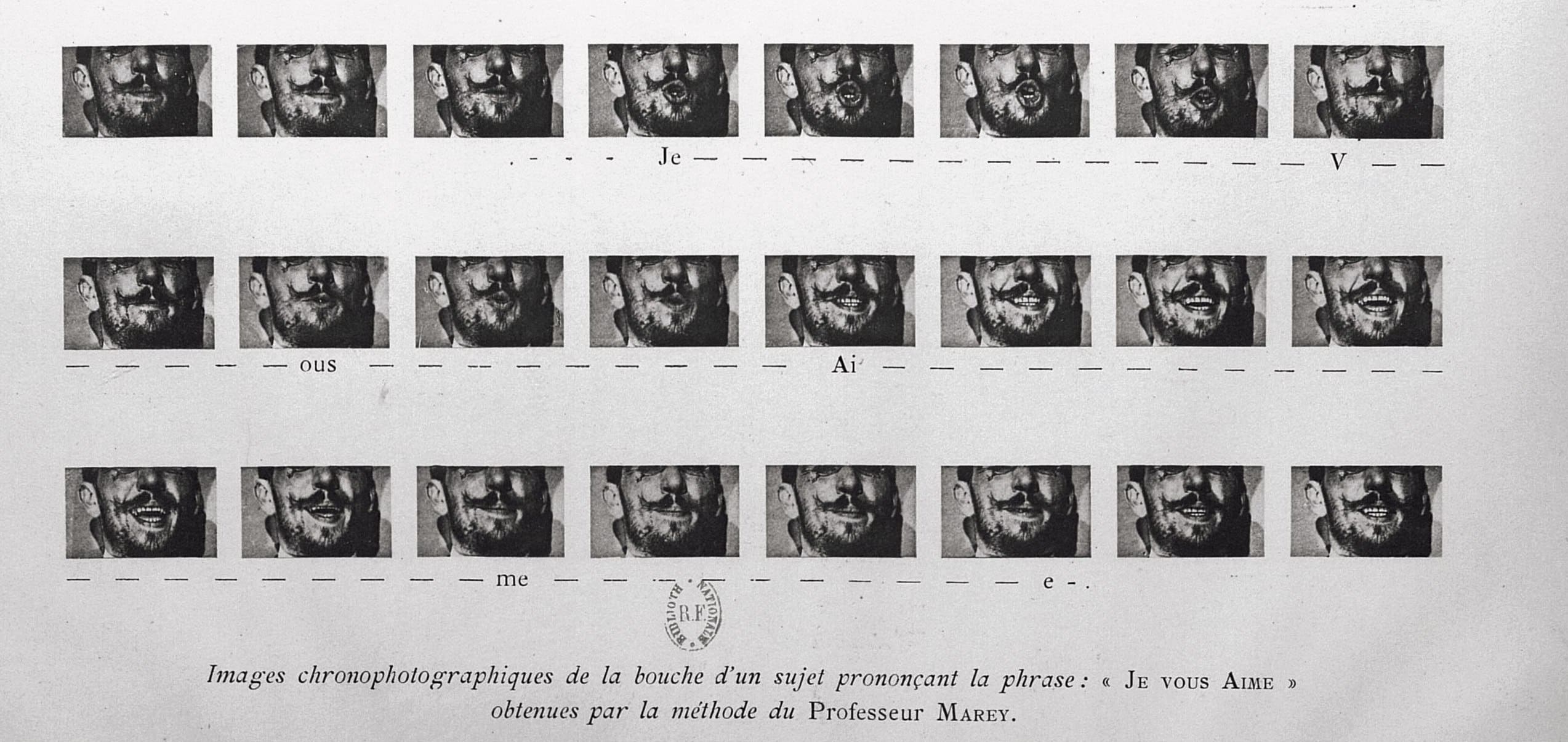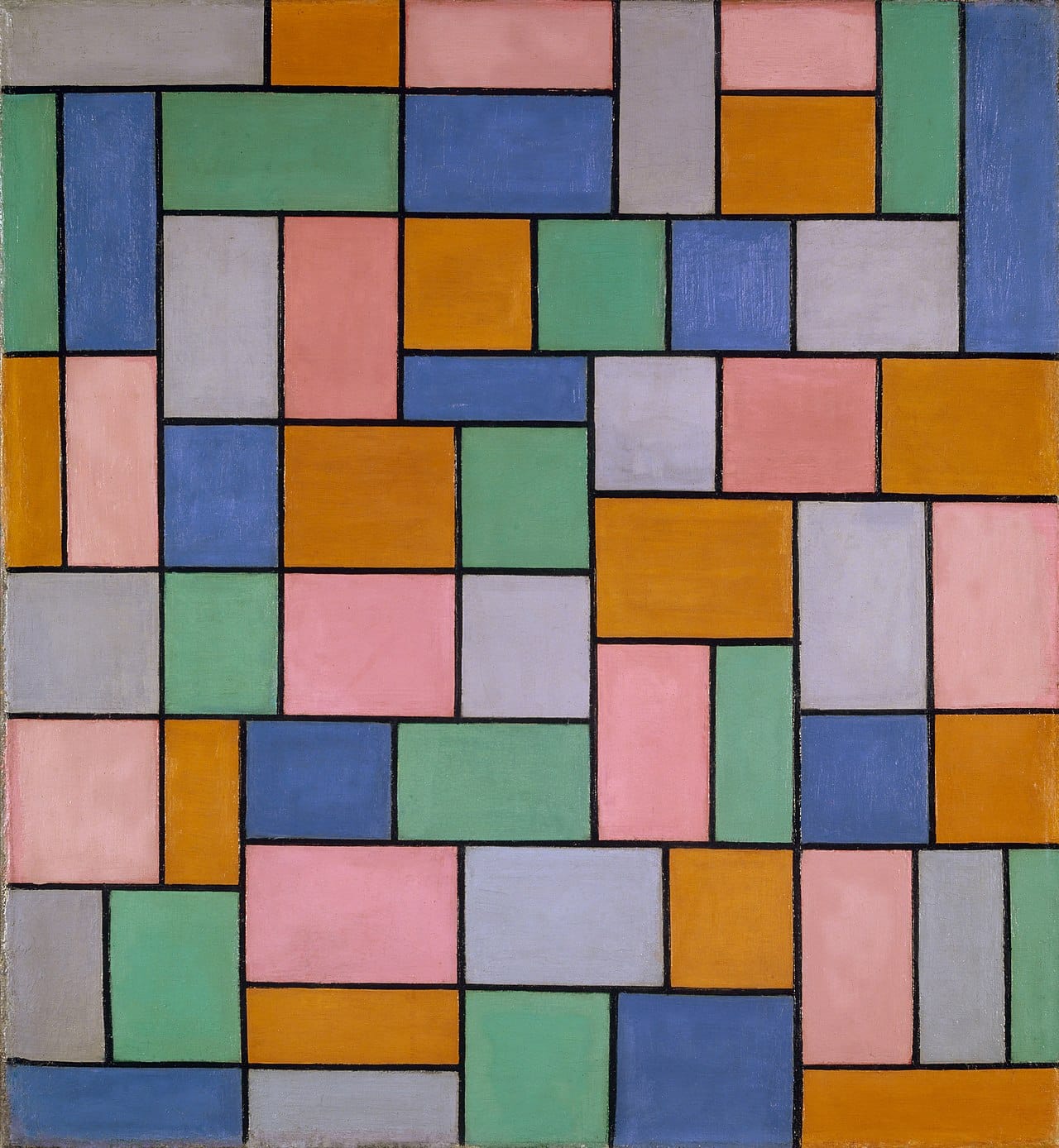Jean-Louis Schefer n’a pas de méthode mais il s’impose une discipline. Le matin, il écrit une sorte de journal de travail dans lequel ne figurent que très peu de dates et pour ainsi dire pas de repères temporels. Nous qui le lisons percevons moins la contrainte du diariste que l’éclat d’un causeur, comme aurait pu être un Diderot. Il parle de peinture et voici que l’on est en pleine théologie médiévale, emportés de Panofsky à Augustin via Poussin et Vico.
Jean-Louis Schefer, Carré de ciel. P.O.L, 160 p., 16,90 €
Le ciel peut attendre. P.O.L, 320 p., 25,90 €
Les aficionados attendent le livre annuel de ce bleu profond qui paraît lui être réservé par les éditions P.O.L, et cette fois en voici deux : un petit essai sur la lumière de la fenêtre dans la peinture, et une épaisse tranche du journal de travail, constituant les morceaux 6 et 7 (entre lesquels la coupure est à peine perceptible) de l’ensemble qui a pour titre Main courante. On ne sait trop si Schefer s’est vu principalement en commissaire tenant registre de son commerce intellectuel, ou comme quelqu’un qui s’appuie à la sorte de rampe d’escalier que serait pour lui sa discipline d’écriture quotidienne. Acceptons l’ambivalence du titre.
D’un côté donc, le fragment du long journal de travail qui se perpétue d’année en année ; de l’autre, un essai sur une question précise touchant la peinture. La distinction n’est pas absolue : les essais de Schefer sur la peinture sont toujours riches de leurs digressions, et le travail dont ce volume retrace les avancées et les piétinements est, bien entendu, consacré à une question picturale, en l’occurrence les danses macabres du XVe siècle. Les titres des deux livres paraissent renvoyer l’un à l’autre : le « carré de ciel » est celui que découpe la fenêtre par laquelle le peintre fait entrer la lumière et, du côté du journal, il nous est dit que « le ciel peut attendre ». S’agit-il du même ciel ? On pense à la maxime de Kant : « le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale au-dedans de nos cœurs » et l’on se dit que celui qui « peut attendre » pourrait être une image de cette discipline de l’écriture quotidienne, morale en ce sens. Ce pourrait aussi bien être le travail sur les fenêtres, dont la conclusion (provisoire peut-être) serait l’autre livre qui paraît en même temps.
Il en va toujours ainsi avec les livres de Jean-Louis Schefer : ils progressent par associations de pensées qui sont principalement des associations de lectures. S’il a « essayé toutes les philosophies », il n’en a « gardé que la démarche et le mouvement, non les catégories ». Ainsi lit-il : en quête de la démarche. Aussi n’y a-t-il pas paradoxe à dire que « l’amour est la seule raison de [s]on travail », à la fois raison d’être et méthode – au sens premier de ce mot grec, celui de « cheminement ». Son « unique méthode, précise-t-il, consiste à savoir écrire de toutes les langues ». Rien là d’une prétention absurde ou des illusions d’une polyglossie qui se croirait généralisée – même si Schefer a aussi publié plusieurs traductions, de l’allemand, de l’espagnol, du latin, et qu’il aurait pu le faire aussi de l’italien et sans doute d’autres langues. Il s’agit plutôt d’une ouverture vers tous les horizons, livresques en particulier, qu’un travail en cours lui suggère.
Il y a quelque temps, il s’était intéressé à un tableau de Poussin, Et in Arcadia ego. Regarder ce qu’en disait Panofsky allait de soi, mais ce ne fut pour lui qu’un point de départ vers de tout autres horizons que ceux de l’iconologie. Remarquant que l’ombre d’un des bergers dessine le hiéroglyphe désignant l’ego, l’homme qui pense, Schefer avait imaginé un rapprochement entre ce tableau peint à Rome en 1640 et les travaux d’égyptologie du jésuite Athanasius Kircher publiés à Rome à ce moment-là, un siècle avant le livre de Warburton sur les hiéroglyphes et presque deux avant Champollion qui allait repartir de ses hypothèses sur la langue démotique. Si Poussin a vraiment pensé dessiner là le hiéroglyphe que l’on doit lire comme « ego », on peut franchir encore un pas, jusqu’à lui attribuer un calembour comme « et, en art, qu’a dit ego ? ». C’est peu dire que les preuves manquent – mais comment contester que ce genre d’hypothèse nourrit l’imaginaire de celui qui regarde le tableau ? En tout cas, Lacan ne dédaignait ni cette sorte de jeu ni de regarder d’assez près ce qu’écrivait Schefer pour lui « piquer un truc dans un texte qu’il avait dit ne pas comprendre ».

Jean-Louis Schefer © John Foley
Écrivant cette fois sur la fenêtre dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, son « heureux patouillage » le mène dans l’Etymologicon linguae latinae de Vossius publié à Amsterdam en 1662. Ce dictionnaire suscite d’autant plus son « affection » que, composé bien avant la découverte (conceptuelle en tout cas) de l’indo-européen, il contient nombre « d’erreurs étymologiques », la principale, qui commande la plupart des autres, tenant à la méthodologie. Mais « ces erreurs-là ont un passé poétique chez Isidore de Séville et offriront leur ressource à la métaphysique poétique de Vico ». Schefer ajoute que Vossius est le contemporain de Descartes et de Huygens, « c’est-à-dire de deux théories, corpusculaire et linéaire, de la lumière ». Écrit en 1633, un des premiers livres, inachevé, de Descartes s’intitulait Le Monde ou traité de la lumière. Et bien sûr Descartes allait devenir un philosophe hollandais… Le travail de l’imagination se poursuit en nommant un autre contemporain de ces trois-là, le peintre Emmanuel de Witte, pour se demander ce « que fait chez lui la lumière, par privilège musical et géométrique, dans sa Jeune femme jouant du virginal, daté de 1665-1670 ». On peut en effet voir dans cette œuvre la musique comme une « métaphore, reprenant heureusement la répartition et les divisions de la lumière au dallage, et commentant spirituellement l’organisation du tableau ».
Ainsi procède sa réflexion, de proche en proche, tel thème appelant la lecture de tel livre, qui en suscite une autre ; on s’éloigne progressivement du point de départ, où l’on revient par moments pour relancer la pensée, à la manière de ces vaisseaux interplanétaires qui, pour aller d’une planète à l’autre du système solaire, effectuent ce qui ressemble à des retours en arrière pour se relancer avec un effet de fronde. Entre la peinture et la lecture, on ne sait trop laquelle aiguillonne l’autre, pour parvenir à ce qui, somme toute, importe : un écrit riche de pensée.
On est parti du lieu commun comparant le tableau à une fenêtre sur le monde, découpant un « carré de ciel » ; regardant Vermeer et les autres, on prend conscience que la fenêtre est aussi voie d’accès pour la lumière venue du monde ; on aboutit à l’idée que la lumière puisse être, comme chez Bonnard, le sujet même de la peinture. Le regard porté sur la peinture s’est enrichi de toute la spiritualité de la lumière.
En 2007, Schefer avait publié un magnifique livre intitulé L’hostie profanée. Histoire d’une fiction théologique. Ce livre était volumineux, somptueux, éblouissant – il semble qu’il ait été dédaigné par les historiens. Peut-être à cause de l’hétérodoxie de la méthode utilisée pour répondre à la question que posait la prédelle de Paolo Uccello, Le Miracle de l’hostie. L’architecture de ce travail s’était faite « par une série de questions théologiques, rituelles et monétaires » et l’on en venait à étudier « l’influence franque sur la théologie romaine ». Une douzaine d’années après, nous vient, avec Le ciel peut attendre, un travail qui se donne certes comme un nouveau morceau de la Main courante, mais dans lequel la basse continue est le travail en cours sur les danses macabres du XVe siècle. C’est un « journal de travail », nous dit-on. Certes, mais le souvenir du livre sur « l’hostie profanée » incite à se demander si paraîtra un jour un livre comparable, un autre chef-d’œuvre au sens compagnonnique, dont le titre serait Les danses macabres. En tout cas, nous le voyons ici se préparer, comme peut-être fut préparé celui sur l’hostie profanée. Nous sommes invités sur le chantier, et cela nous éclaire aussi sur ce que fut peut-être le chantier précédent.
À moins que l’on n’aille sans fin d’un chantier vers un autre, et que se constitue ainsi un genre qui rappelle les Essais de Montaigne, même si, ces années-là, Schefer lit plutôt le Journal de Gide ainsi que les Mémoires secrets de Bachaumont qu’il cite abondamment, sous forme en quelque sorte d’accroche à la réalité, celle de la fin du XVIIIe siècle. Car c’est aussi celle d’un monde, sachant que « les danses macabres ne sont pas un thème religieux et n’ont pas grand-chose à voir avec la peste : elles ont à voir avec l’effondrement du monde et de la société civile à la fin du Moyen Âge ». On est donc, avec ces Mémoires secrets, « au cœur de [s]on travail » – si tant est que sa démarche puisse avoir pour destination de lui faire toucher le cœur de quoi que ce soit – sur les danses macabres. Lire le Journal de Gide relève plutôt de « l’amusement ». Mais comment distinguer entre ce qui relève clairement du travail et ce qui est censé n’être que de l’amusement ? Le charme de cet écrivain tient pour beaucoup à son refus en acte de pareille coupure, à sa volonté de retrouver « la même liberté que les Stromates de Clément d’Alexandrie, c’est-à-dire un livre-tapis se déroulant à partir de détails constituant des motifs, enchevêtrés, sinueux ».