Avec son dernier livre paru en 2009, François Maspero tente de fixer les souvenirs de deux enfances, la sienne et celle de sa fille disparue, en deux maisons, l’une au bord de la Manche, l’autre sur une île bretonne, à vingt ou trente ans d’écart. Il doute d’y parvenir. Les lieux ne sont pas nommés, ni même l’auteur qui apparaît dans le premier texte comme « le garçon », dans le second il est « le père » ; ni la fille dont on ne connaît pas le prénom. Mystère de deux silhouettes qui se répondent, se ressemblent, s’aiment.
Des souvenirs difficiles à traquer, écrit-il : « C’est une opération cruelle, comme fixer un papillon sur une épingle ainsi que le faisait son grand père. » C’est pourtant ce qui fait l’originalité et la force de ce livre né d’une nostalgie multiple des lieux, des êtres aimés, des pleurs et des rires d’un narrateur qui voyage dans un monde disparu, retrouve le nom des arbres, les escarbilles des locomotives, les bonheurs de la petite fille, les fleurs ou les ciels, et ces grands oiseaux de mer qu’on appelle fou de Bassan, avec lesquels il dialogue tout au long du récit.
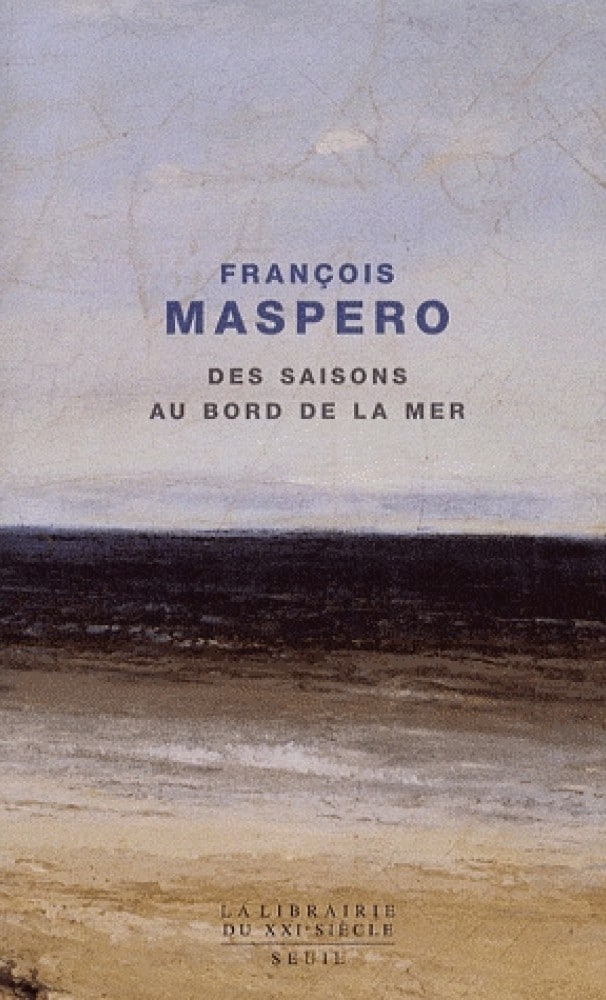
Cela se passe sur fond de guerres. D’abord la Seconde qui rôdait dès sa petite enfance sous le Front populaire, qui emporta son père mort en déportation, un savant : « Il aime être avec son père, c’est toujours rassurant, un père, mais il a trop souvent l’impression confuse que pour celui-ci, il n’est qu’un petit être déconcertant » ; et son grand frère, mort en héros de la Résistance, sa blessure d’adolescent : « La guerre restait inscrite en lui, il la portait dans sa mémoire, non comme de simples cicatrices, mais comme si elle n’en finissait pas d’y agoniser. Et ce frère, dont on avait parfois l’impression qu’il avait du mal à prononcer le nom, il le sentait encore vivre en lui, inséparable, comme si sa mort elle-même faisait partie de son être, de sa chair, de sa vie. »
Suivit la guerre d’Algérie qui éloigna le père de la petite fille. Il partait en reportage, était menacé de mort, passait des heures à taper sur sa machine à écrire Olivetti. Mais quand il revenait sur l’île, rejoignait sa femme et sa fille, quand le bateau approchait la rive, il les apercevait sur le quai, faisant « de grands signaux avec les bras. De plus près il lui sembla que la petite fille sautait à pieds joints. Et de plus près encore, il vit que ce n’était pas des sauts, mais une danse. Rien d’étonnant parce qu’elle dansait à toute heure du jour, et c’était bien pour cela qu’il l’avait surnommée Feu Follet. Sur le quai, quand il embrassa la mère et la fille, il se sentit une fois de plus léger et libéré. Comme si la mort était restée derrière lui, sur le continent. »
La première maison, celle du grand-père, un humaniste et un industriel du Nord, a été remplacée par un lycée technique qui porte son nom. Et la seconde, longtemps habitée par la fille après la séparation des parents, il en conserve des moments « gravés dans sa mémoire en images mouvantes et cependant indélébiles, lumineuses au point d’en être parfois douloureuses, comme trop de lumières sur un écran. Mais l’écran c’est lui-même, et c’est surtout de cela qu’il souffre. » Il n’y est plus retourné, sauf une dernière fois après la disparition de sa fille. Et il s’est demandé « ce qu’il a su vraiment de l’enfance de sa fille dans l’île. Quelle est la part du fantasme et de la réalité dans ses souvenirs de leur vie quotidienne d’alors ? »












