Joyce Carol Oates, la plus prolifique des auteurs américains, vient de publier ses mémoires, Paysage perdu, en même temps que Les Cahiers de L’Herne la consacrent. La candidate au prix Nobel a-t-elle enfin sa juste place dans le paysage littéraire ?
Joyce Carol Oates, Paysage perdu. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Claude Seban. Philippe Rey, 432 p., 24 €
J.C. Oates. Sous la direction de Caroline Marquette et Tanya Tromble-Giraud. Les Cahiers de l’Herne, 328 p., 33 €
Joyce Carol Oates, originaire du Sud ? C’est un mythe répandu, selon un article de ces Cahiers signé Marie-Liénard Yeterian. Qu’est-ce qui fait croire que l’auteure de Bellefleur vient de l’autre côté de la ligne Mason-Dixon ? Cela s’explique en deux mots : gothique et grotesque.
Mieux que personne, Joyce Oates a su s’approprier le langage de Flannery O’Connor et de William Faulkner, créer un univers fictif où la violence primitive sourd au fur et à mesure des récits, avant d’éclater brutalement. On le voit dans les neuf nouvelles inédites faisant partie de ces Cahiers. Quatre d’entre elles viennent du premier livre d’Oates, By the North Gate. Comment est-il possible qu’il n’ait jamais été publié en français ?
« Marais », l’une des nouvelles, n’a rien à voir avec le quartier parisien où les touristes scrutent les traces du passé : chez Oates, la quête des origines passe par les personnages, archétypes liés à la terre, indissociables du paysage. Comme le grand-père de « Marais », qui vit seul dans une cabane en rondins, construite il y a cent ans, qu’il prétend avoir aidé à bâtir, comme s’il existait depuis l’origine. La famille de son fils habite sur la même parcelle, mais celui-ci s’est éloigné de la nature, ayant abandonné l’agriculture pour travailler en ville. Seul le grand-père reste fidèle aux valeurs des pionniers, autosuffisant, pilier de la communauté, pompier volontaire et Bon Samaritain. C’est à ce titre qu’il accueillera dans sa cabane une femme seule, découverte à côté de l’école, où elle restait toute la journée au bord du ruisseau. Il l’aidera à accoucher dans l’étable, au moyen de son couteau de cuisine.
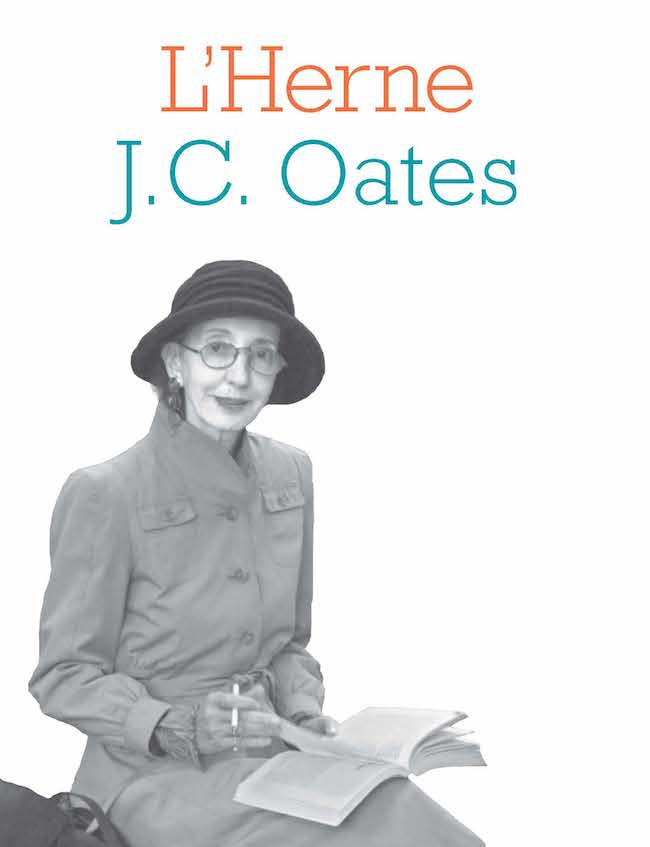
« Le recenseur », une autre nouvelle, donne des allures bibliques à la situation primitive : « Dans le Compté d’Eden, il y a quelque temps, au pied des lointaines collines d’Oriskany, le recenseur de la région – un homme tranquille et souvent bien fatigué de trente-huit ans – parvint au dernier foyer qu’il devait inspecter ce jour-là. » Dans ce foyer, le héros découvrira une famille dont la fille est folle. Elle se moque de son métier, de ses tentatives de rationaliser la vie rurale : « Le recenseur, sous le choc, soutient son regard. Comment avait-elle pu deviner sa peur secrète, le sentiment d’horreur qu’il dissimulait. Il avait souvent été frappé par l’idée, alors qu’il arpentait péniblement les routes de l’impitoyable lumière de l’été au froid cassant de l’hiver, que chaque nouvelle entrée dans son registre venait en annuler une autre, que ces colonnes de noms, de dates et de lieux n’avaient aucun sens… qu’un tel recensement était impossible, que la tâche était trop lourde pour un seul homme, qu’elle finirait par l’épuiser complètement, lui coûter jusqu’à la vie, et ironie ultime, sans jamais parvenir à son terme. » By the North Gate a été publié lorsque l’auteure avait vingt-cinq ans. Prévoyait-elle déjà sa longue carrière d’écrivain, ce projet démesuré de transmuer le paysage primitif en littérature ? « Compter » et « conter » ont la même racine : Joyce Carol Oates s’identifie-t-elle au recenseur ?
Sur la signification de son univers fictif, les interprétations foisonnent. On en trouve quelques-unes dans ce volume des Cahiers de l’Herne. Selon Marie-Liénard Yeterian, la ressemblance avec Faulkner tient d’abord au fait qu’Oates a donné « une dimension mythique » à un endroit précis, le compté d’Érié. Ce dernier, transformé en Compté d’Eden, devient « cosmos » où « fantômes, éléments surnaturels et vampires, et leurs corollaires hybridité, nécrophilie, violences diverses, abondent et surabondent ».

Joyce Carol Oates © Jean-Luc Bertini
Dans « Une écriture à fleur de peau », autre article des Cahiers, Caroline Marquette met en avant l’importance du corps, thème souvent ignoré par les lecteurs de l’œuvre, à cause de l’ambivalence de l’auteure : « Le corps de Joyce Carol Oates, tel qu’il est inscrit dans sa correspondance et son journal, apparaît comme l’objet d’un constant refoulement psychique. Marqueur d’une identité féminine parfois pesante, porteur du sentiment douloureux du temps qui passe, rappel d’une animalité honteuse, le corps est d’abord un ennemi pour cette intellectuelle. »
L’article de Claude Seban évoque certains problèmes de traduction. En 2012, les éditions Stock lui ont demandé de revoir sa traduction de Corky. En relisant son premier travail, Seban a remarqué de nombreuses faiblesses. Par exemple, dans la phrase initiale – « Dieu surgit dans le tonnerre et une explosion de verre » –, il fallait que le lexique et le rythme soulignassent davantage la violence, ce qui donna : « Dieu se déchaîna dans un fracas de tonnerre et de verre brisé ». Claude Seban considère d’autres traductions qu’il a faites, notamment La fille du fossoyeur, où un garçon, de langue maternelle allemande, s’exprime difficilement en anglais, avec un « bégaiement explosif », selon le texte. Avec une humilité admirable, le traducteur reconnaît ses erreurs : « À la relecture, ce qui me frappe, c’est que ma traduction est beaucoup plus policée que l’original. J’ai manifestement préféré une compréhension immédiate du texte au « bégaiement explosif« , et n’ai pas suffisamment bousculé la syntaxe. » Il identifie ainsi un défaut majeur – non seulement pour la fiction de Joyce Carol Oates, mais pour maintes traductions de littérature américaine. Dans ce volume, c’est particulièrement flagrant lors des conversations entre paysans, où les traducteurs « corrigent » l’orthographe et la syntaxe fautives de l’original.
L’original. Si jamais il y a un auteur fasciné par les origines, c’est bien Oates. Exploration poursuivie dans Paysage perdu, situé en grande partie dans le nord de l’État de New York, lieu de l’enfance, de l’adolescence et de la période qui suit immédiatement, ce qu’elle appelle le « ‟paysage” des premiers temps – essentiels – de notre vie ». Mais le mot « paysage » n’est pas qu’une métaphore, il est à prendre aussi au sens propre. Oates traite alors « un véritable paysage rural, dans l’ouest de l’État de New York, au nord de Buffalo, qui a non seulement abondamment nourri mon œuvre d’écrivain, mais qui est à l’origine même de mon désir d’écrire ».

Joyce Carol Oates © Dustin Cohen
Son rapport viscéral aux champs est inscrit dans son patronyme, dont l’homonyme, « oats », signifie « avoine ». Tel un autre habitant d’Éden, le premier homme, dont le nom veut dire « terre ». Songeait-elle à la Genèse lors de l’écriture de Mudwoman ? Se prend-elle pour Dieu, utilisant la terre pour fabriquer des êtres humains ? D’où vient sa vocation de démiurge ?
Le lecteur de Paysage perdu – récit passionnant mais sans fil conducteur – reste perplexe. Un moment charnière a été la découverte de l’œuvre de Lewis Carroll : « Ce beau livre, légèrement hors format, publié par Grosset & Dunlap en 1946, me fut offert par ma grand-mère (juive) Blanche Morgenstern pour mon neuvième anniversaire, en 1947. » Sans réussir à convaincre, Joyce Carol Oates explique l’attrait de l’héroïne de Carroll : « Alice est incontestablement une petite fille, mais elle n’est pas puérile. Elle a quelque chose de mûr et de réfléchi, un regard volontiers sceptique, parfois, sur les adultes qui l’entourent ; une propension à refuser de se laisser donner des ordres ou de céder à l’intimidation. »
Pourtant, on se demande si ce qu’admire Oates n’est pas autant la maturité d’Alice que son absence de maturité. Impression renforcée par Paysage perdu : une voix naïve, tiraillée entre joie et terreur, divorcée du corps. Quel meilleur terreau pour la vision gothique que le regard lucide et émerveillé propre aux êtres soustraits aux exigences du monde adulte, tel l’idiot du Bruit et la fureur ?












