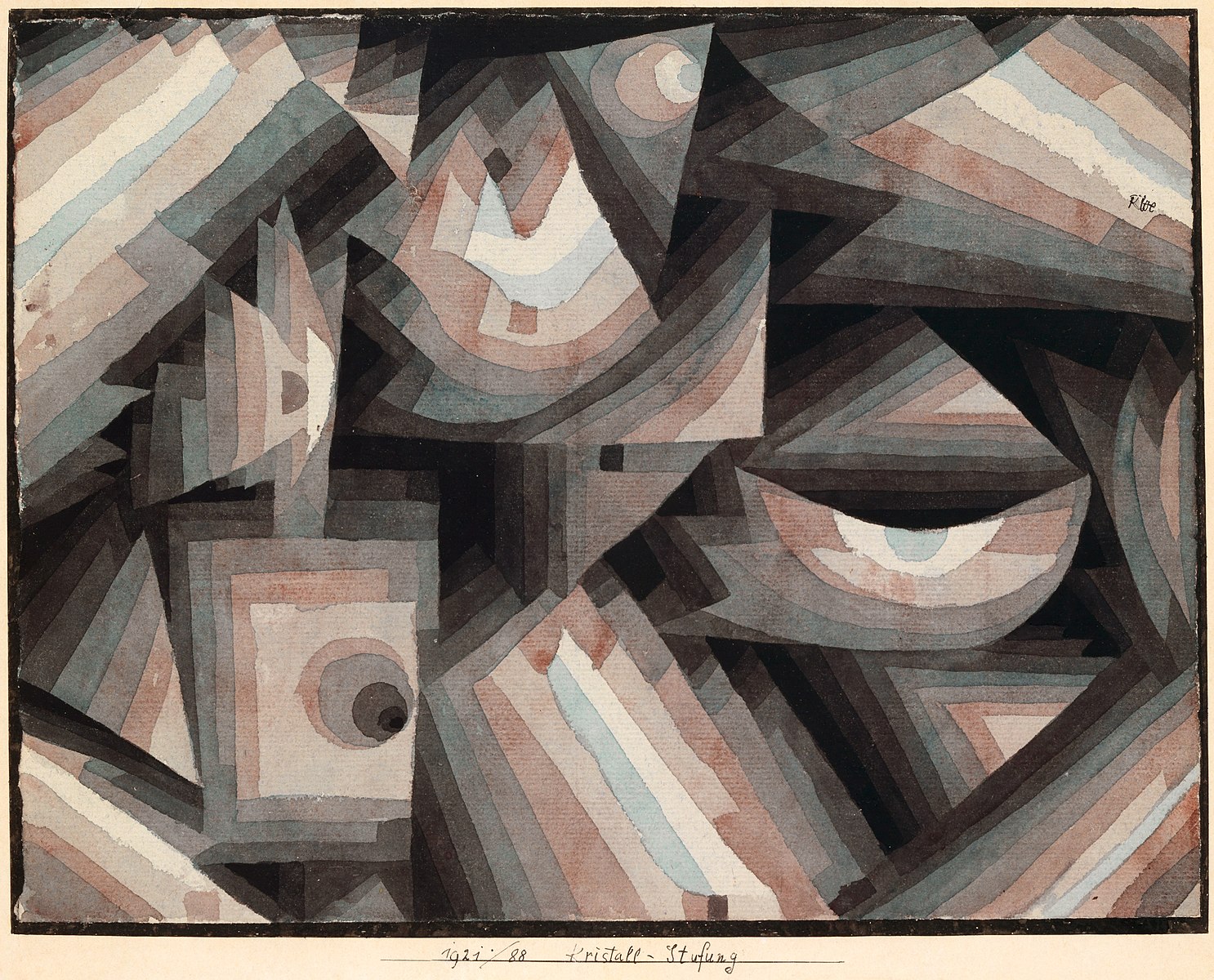Après Saccage (2016), Quentin Leclerc propose de nouveau avec son deuxième roman une littérature non-conventionnelle qui dynamite – ou plutôt qui fait fondre – les habitudes du récit. Le protagoniste, Bram, essayant d’aller jusqu’à la ville voisine, n’y parvient pas. En un inquiétant reset, il ne cesse de revenir à son point de départ et de recommencer. Personnages et espace-temps vacillent autour de lui, parfois fondent. Loin d’être un jeu gratuit, cette narration interrompue fait peser des doutes extrêmes sur le monde, l’identité, la fiction, et arrive à mêler vertige, angoisse et comique.
Quentin Leclerc, La ville fond. L’Ogre, 208 p., 18 €
La vie de Bram excluait tout imprévu. Depuis la mort de sa femme, il n’avait aucune relation proche, montait des maquettes, se promenait autour de sa propriété « s’aventur[ant] parfois jusqu’au bosquet voisin ». « Chaque semaine, le même jour », il prenait le bus pour aller en ville acheter ses médicaments. L’écriture épouse cette vie simple et claire. On suit Bram, sa placidité sereine, le vide que semble contenir le personnage, même s’il reste toujours, et paradoxalement, profondément humain. Mais, un jour, « C’est sous le soleil pourtant rare du mois d’octobre que la ville s’était mise à fondre », et même si Bram ignore cette fonte – du début à la fin, les personnages sauront bien peu de choses – la première conséquence en est que les pneus du bus qu’il prend d’habitude éclatent. Dès lors, le protagoniste, comme K. dans Le Château, va tendre toutes ses forces pour essayer de rejoindre une ville qui lui reste inaccessible.
Celle-ci fondant, l’ordre régulier de la société se défait. On ne vient pas réparer le bus. Il n’y a plus de transports publics. Le dérèglement atteint même la logique. Page 39, « Le chauffeur n’avait aucune chance de retrouver sa famille à présent que la ville fondait », mais, page 44, Bram voit dans le journal « une photographie du chauffeur et de sa famille ». À mesure que le livre avance, l’incohérence s’étend : le bus brûle, puis se retrouve en parfait état, puis de nouveau en cendres, comme si l’état du bus n ‘avait pas grande importance, comme si le problème venait d’ailleurs, de Bram peut-être, de sa conscience du monde qui l’entoure. L’étrangeté gagne le familier : le village dans lequel revient le personnage est à chaque fois semblable et différent. La narration elle-même se trouve contaminée. Quatre chapitres commencent par : « Bram fut réveillé par un coup de téléphone. La femme de l’accueil le prévint qu’on l’attendait dans le hall ».
Le récit repart du même point pour répéter, avec des variantes, le voyage vers la ville, jusqu’à ce qu’il se dissolve dans le sommeil, la violence ou l’absurde. Le doute, la perte de repères frappe autant le lecteur que les personnages. Rien n’est certain. Si la fonte de la ville est assimilée à la lumière blanche et aveuglante, à la chaleur extrême, au « brasier colossal », que peuvent produire une explosion nucléaire, une catastrophe écologique, voire une collision astrale, elle atteint aussi la construction narrative dont la fragilité apparaît clairement : un héros bien pâle, des personnages secondaires réduits à leur fonction – le chauffeur, le fermier, le maire, le chef ; un décor limité – la maison de Bram, le village, la forêt, le mont Palmier. L’effacement ne menace pas seulement les personnages à l’intérieur de la fiction, mais la fiction elle-même. Finalement, seul le protagoniste fait tenir un tant soit peu le monde simplifié au sein duquel il évolue. Hors de sa vue, cadre et personnages semblent perdre toute consistance, se désagréger comme la ville lointaine, ce qui justifie les sauts de la narration, ses reprises.

Quentin Leclerc
Un troupeau de porcs livrés à eux-mêmes passe régulièrement dans le cadre, sur le même plan que les groupes de villageois et de policiers qui s’efforcent de gagner la ville. Seules les femmes paraissent échapper quelque peu à la faiblesse générale. Par son obstination, la veuve, tenancière d’un bistrot, est la seule à arriver à aller et venir jusqu’à la ville. Les villageoises, en se séparant d’avec les hommes, se transforment en « guerrières ». Et quand le récit quitte brièvement le point de vue de Bram, c’est pour adopter celui de ces personnages féminins.
Par la précision et la rigueur de l’écriture, Quentin Leclerc joue avec une grande maîtrise des répétitions et des variations, maintenant l’intérêt du récit malgré ses saccades. Les pérégrinations de Bram et des autres personnages prennent une dimension onirique, notamment parce qu’elles sont souvent nocturnes, et, comme on ne sait jamais quelle voie va emprunter l’intrigue, on s’abandonne au sentiment d’étrangeté qu’elle crée. Le lecteur est aussi ignorant que les personnages quand ils s’engagent au hasard dans la campagne puisqu’ils ne connaissent pas l’itinéraire pour rejoindre la ville.
Certaines conséquences attendues d’une situation apocalyptique adviennent : le maire, puis le chef, confisquent le pouvoir, la violence se répand, un fusil passe de mains en mains et « Bram savait que dans ce fusil il y avait la mort du fermier et qu’elle se répandrait à nouveau ». Mais l’absurde et la répétition, à côté de l’angoisse, créent surtout du comique. L’avalanche de malheurs frappant le bus et son chauffeur, l’équipée à vélo de celui-ci et de Bram dans la campagne obscure – l’un tirant l’autre dans une remorque –, l’incongruité de la présence récurrente des porcs, la naïveté du protagoniste, son inaltérable impassibilité créent du burlesque au cœur d’une inquiétude métaphysique qui reste implicite.
Quentin Leclerc use de la trame du récit apocalyptique – une catastrophe survient, détruisant avec la civilisation tout ordre. Ici, très directement, c’est la cité qui se défait. Le monde s’écroule – mais il étend les dégâts à l’assemblage fictionnel, exprimant, quelque part entre Philip K. Dick et Beckett, un profond sens de l’absurde et le même genre de comique glaçant que ces deux auteurs. Jusqu’à une fin inattendue, qui vient déstabiliser la déstabilisation elle-même.