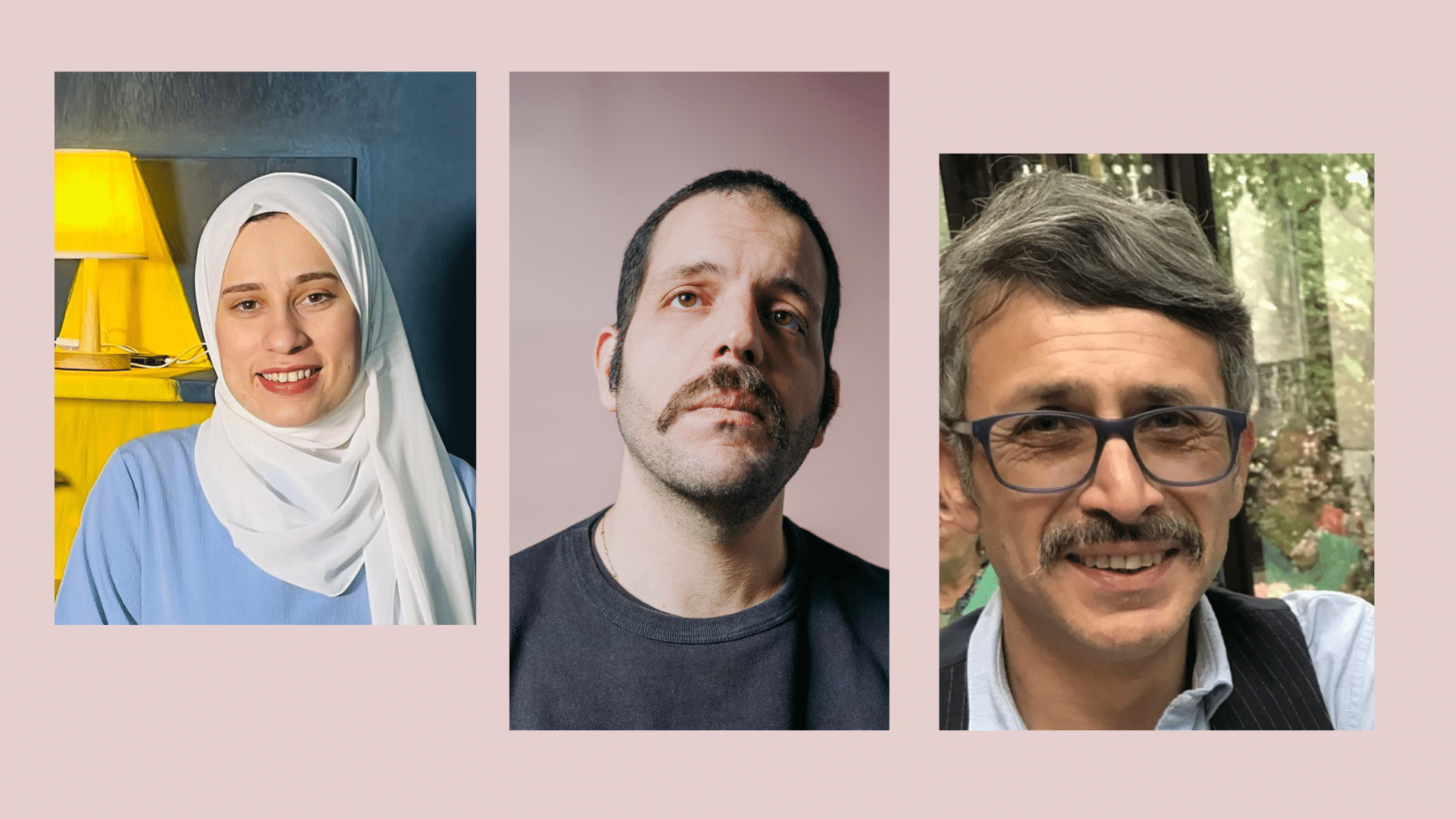Quel lecteur de poésie n’a pas gardé en mémoire le fameux dialogue, devant la cour, à Leningrad, entre le juge et Iossip Brodski, lors de son procès pour « parasitisme » en octobre 1964 ? À la déclaration de Brodski, qui rappela qu’il était « poète, traducteur poète », le juge eut cette répartie : « Et qui t’a reconnu comme poète ? Qui t’a fait entrer dans les rangs des poètes ? » À quoi l’auteur des Collines répondit : « Personne. Et qui m’a fait entrer dans les rangs de l’espèce humaine ? »
Varlam Chalamov, Cahiers de la Kolyma et autres poèmes. Trad. du russe par Christian Mouze. Maurice Nadeau, 147 p., 17 €
C’est aux alentours de ces années où Brodski devait se justifier de faire encore partie des humains que Varlam Chalamov commença à mettre en œuvre les Récits de la Kolyma. Il ne voulait pas seulement écrire les mémoires d’un homme qui avait passé vingt ans de sa vie au Goulag et en relégation, un texte qui eût « l’évidence d’un document », mais un « document transfiguré ».
Dans Tout ou rien, se trouve affirmée avec force l’intention de Chalamov de lancer à la face du monde un « manifeste sur la nouvelle prose » : en ce « siècle loup-garou » que fut le XXe siècle, il n’y avait pas de place, croyait-il, pour le roman, ou alors une certaine forme de roman, le roman brisé, le « roman en pièces » à la Faulkner. Le roman était donc mort, il ne restait plus, pour qui était passé par cette « école de décomposition » qu’était le camp, qu’à léguer au monde un texte qui eût l’authenticité d’un procès-verbal, qui fût « en dehors de l’art », tout en puisant sa force dans l’art. Un De profundis, en quelque sorte, qui fût le prix de la souffrance, qui n’eût rien de « littéraire ». Chalamov, reconnaissant sa dette à l’égard d’Ambrose Bierce par exemple, ne cachait pas combien il était irrité par ce qu’il appelait la « prose artificielle » d’Isaac Babel – elle lui donnait toujours l’envie, avouait-il, de lire avec un crayon à la main pour raturer dans ses livres toutes les enjolivures. Il défendait l’idée qu’une des lois fondamentales des récits doit être le laconisme, accompagné d’une certaine sécheresse : « Je revenais de l’enfer », ainsi s’achève, de façon glaçante, l’un des Récits de la Kolyma, écrit en 1964. Cet enfer, dont Evguénia Guinzbourg avait été aussi l’une des victimes, rendant compte, dans Le vertige, de l’horreur quotidienne des camps, cet enfer, Varlam Chalamov voulait en garder, en tant que témoin, la trace, à la manière d’un prosateur anxieux de laisser à ceux qui y avaient échappé quelque chose de semblable au précis scientifique, mais un précis qui aurait comme exergue cette promesse, exprimée dans les Cahiers de Voronej par Ossip Mandelstam (à qui il est rendu hommage au début des Récits de la Kolyma) : « De tout je réponds, mais je reste indemne, / Car la vie a mille fonds, hors la loi. »
En ces années 1960, Chalamov évoquait aussi sa ville natale dans La quatrième Vologda, la décrivant comme la ville des pogroms et des Cent-Noirs, ces groupes ultraréactionnaires et ultranationalistes déterminés à semer partout la terreur, puis comme un lieu de relégation pour de nombreuses figures de l’opposition. Revenant sur ses lectures et sur ce qui le séparait de sa famille, il se souvient que, autant le frère de sa mère accordait du prix à la poésie, autant son père la méprisait, déconseillant à son fils de suivre cette voie et n’approuvant que ses travaux journalistiques. Sans doute le père aurait-il jeté aussi l’anathème sur les dévoreurs d’in-folio, parmi lesquels Chalamov se rangeait, comme il le confie dans Mes bibliothèques. Si, pendant sa déportation en Sibérie, il était resté des années sans livres, s’il lui était arrivé d’oublier combien dans son enfance il se passionnait pour Alexandre Dumas et Fenimore Cooper, si, au Goulag, quand il entendait parler de littérature, ce n’était que lors des autodafés que Beria, le chef de la NKVD, orchestrait, dès qu’il avait pu recommencer à lire, il s’était découvert une passion pour Ibsen, Hamsun, Andreïev.

Varlam Chalamov
Durant ces années de déportation, Chalamov se gardait bien de céder à la tentation d’écrire de la prose : « Le territoire de la Kolyma était trop dangereux pour de la prose, on pouvait prendre des risques en vers, pas en prose. C’est la raison pour laquelle je n’ai écrit que des vers à la Kolyma. » Chalamov avait alors à l’esprit au moins deux modèles : Boris Pasternak et Ossip Mandelstam, si l’on omet Marina Tsvetaeva à qui il est plusieurs fois fait allusion dans sa correspondance avec l’auteur du Docteur Jivago. Pendant les années où il vivait à Kolyma, Chalamov se consacrait à la poésie parce qu’il était trop risqué d’écrire de la prose, la prose telle qu’il la concevait, celle qui ne masquait rien, celle qui n’était pas faite pour mettre du baume au cœur, plutôt pour rouvrir des plaies. Il écrivait aussi de la poésie parce que c’était plus fort que lui, cette « pression qu’exerce sur l’âme le flux irrésistible de la poésie : on dirait que les mots cherchent à fuir un incendie qui se serait déclaré à l’intérieur, qu’ils se précipitent, se ruent sur le papier », notait-il dans une lettre de 1953 à Boris Pasternak.
Chalamov était persuadé que l’art est l’immortalité de la vie – ce que l’art n’a pas effleuré est condamné à mourir tôt ou tard. Il ne dissimulait pas, parfois (dans Les années vingt par exemple), ses réserves sur « l’idéologie vague et absconse de Pasternak », cette idéologie « nourrie à l’air tiède de Moscou et formée dans l’esprit occidental », il n’en vouait pas moins une grande admiration au poète de Ma sœur, la vie, et c’est avec une déférente impatience qu’en 1952, au moment où Pasternak mettait la dernière main au Docteur Jivago, il lui envoya deux cahiers de poèmes, qui ne seraient « jamais imprimés ni publiés ». Il devait raconter, dans les Récits de la Kolyma, qu’il lui fallut parcourir plus de mille kilomètres pour aller chercher la réponse de Pasternak, le dédicataire de ces poèmes qui parlent, sans pathos ni lyrisme, de la vie « là-bas » (au Goulag) : « Là-bas le jour même était supplice / Et arrangement avec l’enfer. » Ces poèmes allaient lui valoir d’être appelé « le Chantre du Grand Nord ». Il récusa ce qualificatif, trop romantique, et rappela comment le Grand Nord avait anéanti ses rêves et défiguré ses dispositions poétiques. Après des années de camp, alors qu’il travaillait comme aide-médecin, il s’était soudain senti pris d’une grande frénésie d’écriture. Sa poésie s’adressait à quelques-uns de ceux qui, pensait-il, étaient capables de le comprendre et de deviner quelle puissance l’habitait : « La poésie, devait-il relever au cours des années 1960 dans un texte de La quatrième Vologda, c’est avant tout une fatalité, l’aboutissement d’une longue résistance spirituelle, l’aboutissement d’une résistance et en même temps une façon de résister, c’est le feu qui jaillit lors du choc avec les couches les plus solides, les plus profondes. »
Publiés en partie en français chez Maurice Nadeau en 1969, les Récits de la Kolyma ne devaient paraître en Russie qu’à la fin des années 1980. À sa mort, en 1982, dans un asile psychiatrique de Moscou, Chalamov n’était connu que pour quelques poèmes, où s’exprimaient cette force de résistance et une certitude : il n’y a pas de poésie sans que s’y mêle un goût de sang, il n’y a pas de poésie sans un certain effroi, même si, dirait Marina Tsvetaeva, elle peut aussi être une averse de lumière. Les poèmes de Chalamov disent la souffrance toute nue et le besoin d’une littérature où les mots s’immisceraient dans l’âme comme une « meute de loups la nuit », pour faire entendre un hurlement de bête : « Je n’obtiendrai pas la paix, / Ni dans le rêve, ni dans la réalité, / Parce que c’est ce hurlement, / Ce hurlement de loup – qui m’aide à vivre. »