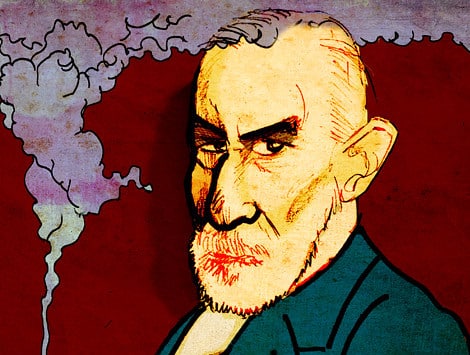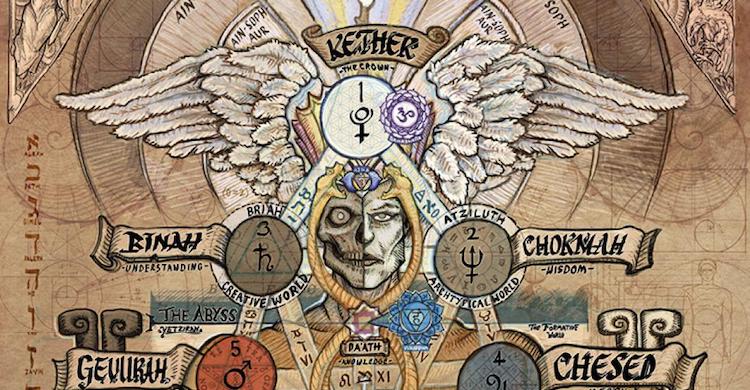Laura Pigozzi, psychanalyste italienne mais aussi chanteuse de jazz et musicologue, fait plus que dépoussiérer ce terme de belle-mère qui désignait prioritairement il y a encore quelques années la deuxième épouse d’un homme dont la première était décédée. Désormais au cœur de cette entité encore récente, la « famille recomposée », la « nouvelle famille » comme disent les Italiens, la deuxième épouse ou compagne doit composer avec la première, la mère des enfants du couple initial, elle est donc, comme le souligne d’entrée de jeu Jean-Pierre Winter qui préface ce livre majeur, « là et pas là ».
Laura Pigozzi, psychanalyste italienne mais aussi chanteuse de jazz et musicologue, fait plus que dépoussiérer ce terme de belle-mère qui désignait prioritairement il y a encore quelques années la deuxième épouse d’un homme dont la première était décédée. Désormais au cœur de cette entité encore récente, la « famille recomposée », la « nouvelle famille » comme disent les Italiens, la deuxième épouse ou compagne doit composer avec la première, la mère des enfants du couple initial, elle est donc, comme le souligne d’entrée de jeu Jean-Pierre Winter qui préface ce livre majeur, « là et pas là ».
Laura Pigozzi, Qui est la plus méchante du royaume ? Mère, fille et belle-mère dans la famille recomposée. Traduit de l’italien par Laura Ceccotti-Stievenard et Mathilde Nobécourt, Albin Michel, 279 p. 20 €.
Sur cette scène haute en couleurs, où s’entendent plus de cris que de chuchotements, où rivalités et jalousies peuvent se donner libre cours, se joue un théâtre de luttes et de traquenards utilisant toutes les armes possibles, montre Laura Pigozzi. On peut y découvrir des données complexes, celles du rapport douloureusement antagoniste entre l’être femme et l’être mère, celles donc de la sexualité féminine et celles, souvent dissimulée bien que capitale, de la question du père, de son rôle et de son efficace, père bien réel et non pas seulement symbolique comme pourrait le laisser croire une certaine vulgate psychanalytique.
C’est donc en tant que psychanalyste mais aussi en tant que belle-mère dans sa vie privée, et elle n’en fait pas mystère, que Laura Pigozzi s’est emparée de cette vaste question en nous préservant de discours abstraits et hermétiques mais en se servant de la théorie analytique et de certains de ses concepts comme d’un instrument à même de desserrer ces nœuds familiaux souvent vipérins et d’accompagner dans la vie quotidienne les acteurs, actrices de cette pièce jamais achevée sans pour autant faire de son propos un recueil de recettes du genre de celles dont raffole la presse dite féminine.
Ceci d’abord, qu’il importe de souligner : la belle-mère n’est pas, ne saurait être considérée comme le duplicata de la mère, que cette dernière soit ou non aimante ; la belle-mère, fonction ingrate et périlleuse, est le plus souvent conduite à s’occuper, dans les détails de la vie quotidienne des week-ends ou de certaines semaines, d’enfants qui ne sont pas les siens et qui ont subi avec plus ou moins de violence les soubresauts de la séparation de leurs parents : d’où ce conseil s’agissant du rapport avec ces enfants : « Lorsque nous, les belles-mères, entrons dans leur vie, même si cela reste inconscient, nous arrivons avec un «chant » nouveau qui les rend curieux. Nous avons intérêt à bien le moduler pour qu’il ne soit trop séduisant ni trop lointain. » Tout un programme qui ne doit pas être vécu comme effrayant à la condition de ne pas l’entendre comme un cahier des charges : « L’étoffe des relations humaines est l’imperfection, et les belles-mères en sont l’éloge ».
Ni tante ni « nounou » mais figure autre que celles du groupe familial, la belle-mère a cette spécificité d’avoir des rapports sexuels avec le père. Ce rappel absolument capital nous conduit au cœur de la question, celle prioritaire du manque en cela que la belle-mère n’étant ni la mère des enfants, ni la première femme, n’ayant pas la place première pour le père, lui-même souvent pris dans les mailles retorses de la culpabilité, elle a du même coup statut d’entraînement au manque, de familiarisation avec ce pas tout ; corollairement et tout aussi centrale, une autre question émerge, celle qui tendrait aujourd’hui, et cela en dépit d’une idéologie contradictoire qui met en avant et conjointement une soit-disant libération sexuelle et la toute puissance du maternel, à estomper sinon à effacer le fait, véritable piège, qu’ « être mère est psychiquement plus simple qu’être femme » et Laura Pigozzi de bien préciser non sans le déplorer que « la reconnaissance sociale est réservée à la mère tandis qu’une femme sans enfants est regardée avec suspicion ». Dans l’absence et l’attente de statut juridique clair, la belle-mère est structurellement en lutte avec la toute-puissance que nos sociétés reconnaissent aux mères.
Cette contradiction, dont la résolution n’est jamais simple entre l’être femme et l’être mère, risque fort, si elle n’est pas clarifiée et vécue pleinement dans sa différence, d’avoir des conséquences sur cette relation à venir, tout aussi périlleuse, dont Lacan a pointé qu’elle relevait souvent d’un « ravage », celle entre la mère et la fille que la présence d’une troisième femme risque bien souvent de rendre encore plus envenimée. Mais pour bien comprendre tout ce qui est là en jeu, pour aller au-delà des idées toutes faites et autres slogans, il faut faire plus qu’une « digression », un retour détaillé et aussi précis que possible sur ce que l’on peut cerner de l’univers féminin, de la sexualité féminine, de l’évolution du corps féminin depuis celui de l’enfant devenant adolescente puis femme, de la jouissance féminine, cette « jouissance Autre », jouissance « hors langage » que Lacan a tenté d’explorer, ce qui conduit l’auteure à souligner avec force que devenir mère et s’en satisfaire constitue souvent un obstacle au devenir femme. Laura Pigozzi consacre plusieurs chapitres à ces questions, elle le fait avec rigueur, faisant notamment retour avec bonheur sur le célèbre texte que Freud avait consacré au « cas Dora » et combattant sans concession les fantasmes contemporains et autres légendes concernant le « bienfait » de l’allaitement prolongé ou celle de l’enfant roi auquel la mère devrait tout sacrifier jusqu’à ignorer, voire à nier sa potentialité de femme.
Tout cela pourra bien en faire hurler certains ou certaines qui n’ont jamais entendu, dans le secret des cabinets d’analystes, les souffrances de femmes non advenues, étouffées par la jouissance délétère de la maternité.
Et les pères et les fils ? Où sont-ils ? En filigrane dans ce remarquable travail et l’auteure en est totalement consciente qui les convoque en fin de parcours pour rappeler que sans père il n’y a pas de femme et annoncer qu’un prochain livre leur sera consacré.
Si les références à Freud, à Lacan et à Dolto sont bien présentes, elles n’étouffent ni ne submergent un propos novateur, et cet ouvrage, qui n’est donc en rien un devoir de disciple appliquée, est une contribution fascinante, à la fois simple et rigoureuse, à la connaissance de liens familiaux encore mal explorés ou si peu.