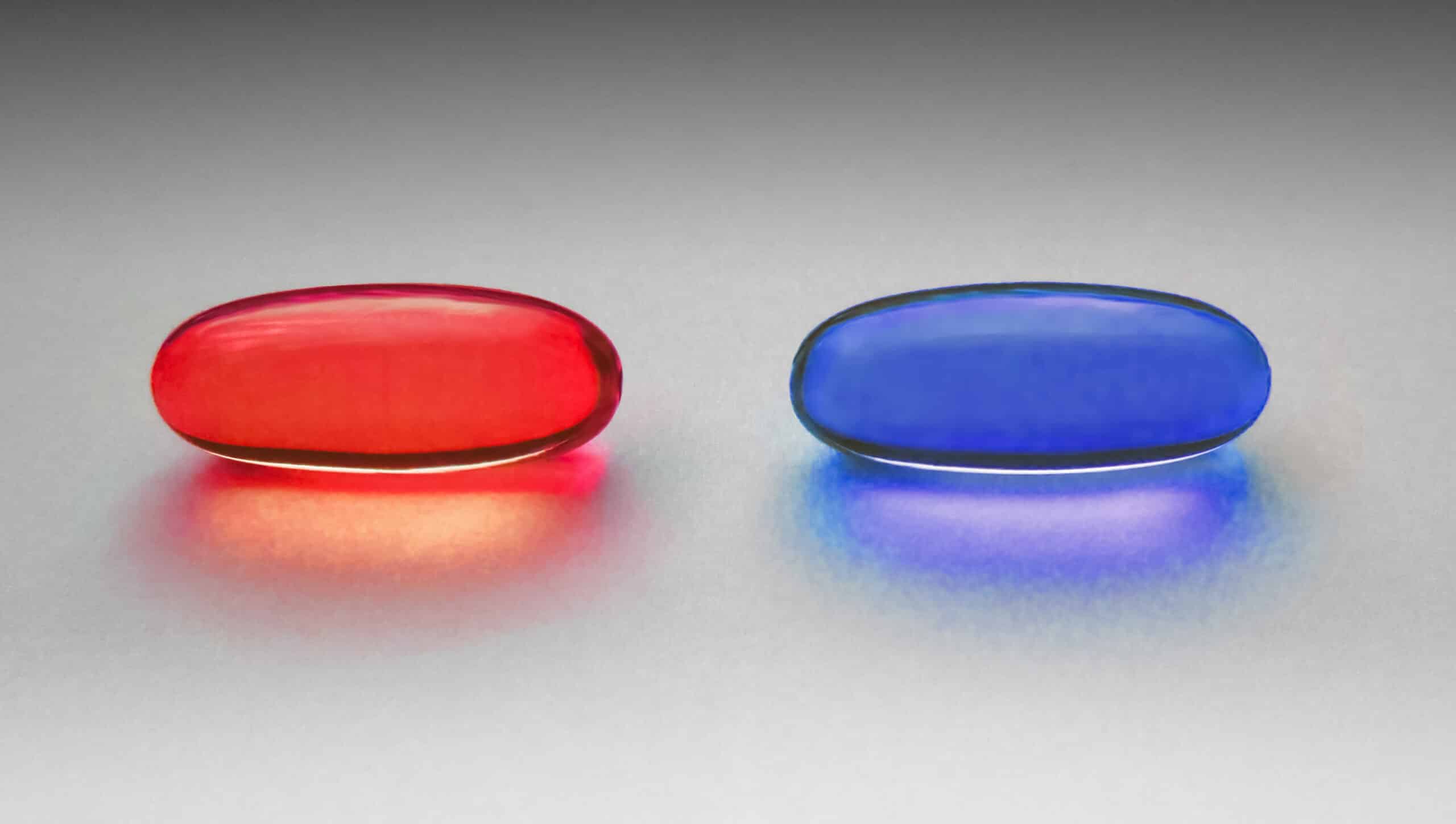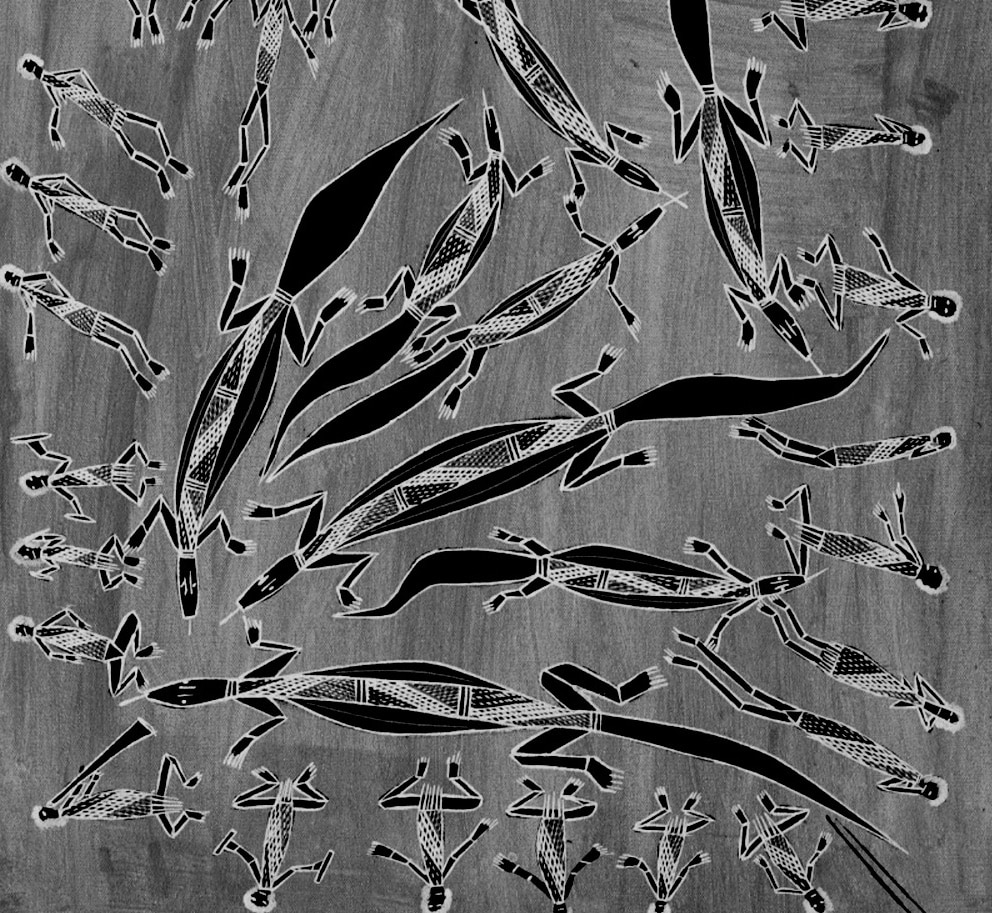James Scott (1936-2024) était un politiste original. Il est parti sur le terrain après avoir signé deux livres théoriques, à quarante ans passés, alors que les chercheurs font souvent le chemin inverse. De cette enquête de terrain méticuleuse, il a tiré Les armes des faibles, qui a contribué à renouveler les travaux sur la résistance à l’oppression. Quatre décennies après sa parution originale, cette somme impressionnante est enfin disponible en français.
James Scott arrive en Malaisie en 1978, en pleine « révolution verte ». L’introduction d’engrais chimiques, de nouvelles semences, d’une agriculture rizicole intensive et de moissonneuses-batteuses est en train d’enrichir une petite classe de propriétaires, d’améliorer les conditions de vie d’une paysannerie moyenne qui reste importante et d’appauvrir tous les autres paysans. Dans le village rizicole du nord-ouest de la Malaisie où Scott s’installe pendant près de deux ans, le mécontentement couve mais n’éclate pas. À ceux qui leur soutirent labeur, nourriture, impôts, loyers et intérêts, les paysans malais opposent une autre stratégie que la révolte violente : la résistance de basse intensité.
Comme l’observe Scott, les paysans modestes ou pauvres n’hésitent pas à tirer au flanc, tricher, exécuter les ordres à moitié, colporter des ragots, calomnier, feindre l’ignorance ou le malentendu, commettre de petits larcins, saboter des machines, voire abattre le bétail des grands propriétaires terriens qui saccage régulièrement leurs pépinières, leurs rizières et leurs petits jardins. À la fois quotidienne, permanente et informelle, souvent clandestine et visant surtout des gains immédiats et concrets, cette forme de résistance nécessite peu de coordination et de planification. Elle présente aussi l’avantage d’échapper à la répression policière et d’être bien adaptée à des communautés éparpillées souvent dépourvues de chefs.

À travers l’histoire, la plupart des dominés ont recouru à de telles tactiques, écrit Scott, qui y ajoute la désertion et la fuite. Malgré eux, rois, seigneurs, souverains, grands propriétaires, contremaîtres et autres gouvernants poussent leurs subalternes à la dissimulation. Mieux vaut la désertion que la mutinerie. Mieux vaut squatter au coup par coup qu’occuper les terres. Mieux vaut le chapardage que le raid organisé sur les greniers à grains. Ces tactiques de résistance sont moins risquées que l’insubordination ouverte, car elles ne menacent pas les classes dirigeantes, qui les tolèrent ou feignent de les ignorer. Les pauvres évitent ainsi d’être punis, et les riches de perdre la face en admettant que leur pouvoir est contesté.
Ces désobéissances quotidiennes étaient mal connues avant que cet ouvrage ne les mette en lumière. Elles ne laissent guère de trace dans les archives officielles, où flamboie au contraire l’éclat des révoltes organisées. D’autant que les dominés se sont eux-mêmes efforcés de rester en dehors des archives, notamment pour échapper aux impôts, à la conscription et aux corvées, comme l’écrit Scott dans Petit éloge de l’anarchisme (Lux, 2019). Quant aux chercheurs et aux intellectuels, qui ont défini la notion de « résistance » en référence aux partis politiques et aux groupuscules dont ils sont familiers, ils sont mal outillés pour comprendre la désobéissance populaire. Et pourtant, une myriade de petites insubordinations peut, bien mieux que le travail organisé de révolutionnaires professionnels, priver de ressources les classes possédantes, limiter leurs desseins conquérants et déboucher sur une révolution. Que l’on songe aux désertions qui ont affaibli l’armée russe lors de l’été 1917 et dont s’est nourrie la révolution d’Octobre.
Les chercheurs et les intellectuels ont cédé à un autre biais : ils ont étudié la désobéissance à partir des archives officielles. Depuis Hérodote, les historiens reproduisent souvent l’autoportrait de l’État que l’on trouve dans ses registres, tandis que les paysans, les nomades et les barbares n’ont droit qu’à de petites aquarelles floues, simplement parce qu’ils n’ont guère laissé de traces écrites. Toute l’œuvre de Scott s’emploie à rectifier ce déséquilibre.
Si Les armes des faibles est un ouvrage plein de vie et d’intelligence, très bien écrit et très bien traduit, il risque de décourager les novices par sa profusion de détails ethnographiques et de données. Si vous n’avez jamais lu Scott, vous préférerez sans doute entrer dans cette œuvre passionnante par d’autres portes, même si vous ne lisez pas l’anglais. Les éditeurs francophones ont mis du temps à traduire son œuvre, mais le mal est aujourd’hui largement réparé.

Son livre suivant, La domination et les arts de la résistance (Amsterdam, 2008), plus bref et plus théorique, prolonge ses réflexions sur les résistances subalternes et le « texte caché ». Cette expression, esquissée dans Les armes des faibles, désigne ce que les dominés disent et font en coulisse, comme le braconnage, le vol ou l’évasion fiscale. La plupart du temps, ce texte caché se joue en secret, à l’écart du « texte public » ânonné par les classes dirigeantes à longueur de parades, de cérémonies et de grands discours. Dans certains cas, néanmoins, le texte caché se joue en public, de façon anonyme ou ironique, sous la forme de rumeurs, de ragots, de contes populaires, de plaisanteries, de chansons et de rituels codés, dont le carnaval est un bon exemple. Tous les actes politiques du peuple reposent, selon Scott, sur le fondement souterrain de cette « infrapolitique ».
Dans ses livres suivants, Scott approfondit ses réflexions sur la résistance en étudiant l’histoire de l’État. L’œil de l’État (La Découverte, 2021) montre ainsi comment cette institution a toujours essayé, au mépris des écosystèmes et des coutumes, de standardiser la nature et les peuples pour les rendre plus faciles à surveiller, compter et gouverner. Cette « mentalité planificatrice », que Scott voit à l’œuvre dans les projets coloniaux, les fermes collectives, les villes nouvelles et les programmes de développement, a cependant toujours échoué face à des résistances quotidiennes.
Son livre suivant, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné (Seuil, 2013), est consacré à une vaste zone montagneuse d’Asie du Sud-Est où ont trouvé refuge des populations fuyant l’État et ses taxes, sa conscription et ses travaux forcés. De tout temps, les communautés réfractaires à l’État se sont installées dans des zones difficiles d’accès, comme les montagnes, les déserts, les marais, les deltas et les marécages, à l’abri des raids esclavagistes et des percepteurs. L’État n’est pas l’aboutissement de l’histoire humaine, écrit Scott dans ce récit passionnant et très accessible, mais une option que les peuples ont longtemps pu refuser.
Retraçant l’histoire plurimillénaire de l’État dans une synthèse tout aussi stimulante, Homo domesticus (La Découverte, 2019) dépeint les premiers États comme des entreprises fragiles et temporaires ne pouvant survivre sans asservir des populations à la monoculture de céréales. Ces États ont longtemps échoué face aux épidémies, aux mauvaises récoltes, aux raids des peuples nomades et à la fuite des paysans – Scott rappelle que la muraille de Chine visait autant à stopper les envahisseurs qu’à retenir la population soumise à l’empereur. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, nombre d’États se dissolvaient périodiquement en bandes nomades et en communautés villageoises libres. Depuis, au contraire, les États n’ont cessé de consolider leur assise. Au point que tous les territoires habitables de la planète sont aujourd’hui sous leur coupe, donnant à deux cents souverains des pouvoirs exorbitants sur huit milliards de sujets.