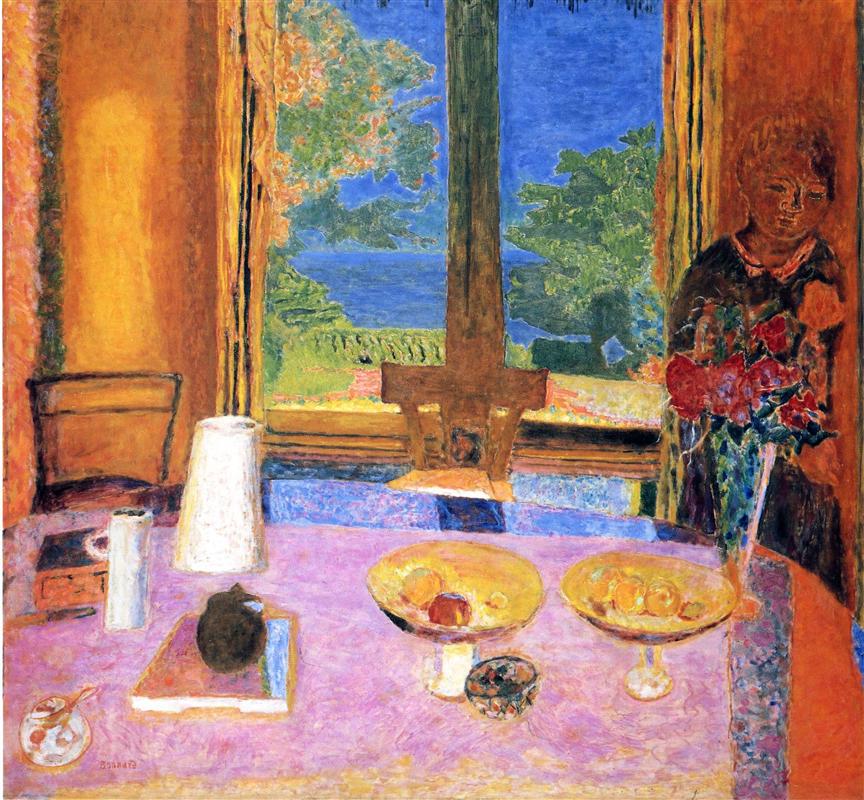« Mon Slonim », comme l’auteure aurait aimé l’intituler, est une œuvre vivante et dynamique, profondément émouvante, qu’on lit avec enthousiasme sans jamais lâcher le fil de l’histoire. Élise Marienstras nous y invite à une immense traversée, celle d’une longue vie, campée sur le XXe et le XXIe siècle, riche de celles de plusieurs générations dont elle est issue, de familles qu’a détruites la Shoah par balles (le khurbn en yiddish) dans le shtetl de Slonim, alors en Biélorussie, pendant et autour de l’année 1941.
De là le titre Mémoires sans mémoire, car, après un bref séjour à Slonim après sa naissance à Paris et de retour dans la capitale avant-guerre, elle n’a pas connu les atrocités dont il est question au cœur du livre : l’anéantissement d’une communauté entière de près de 28 000 Juifs slonimiens et quelque 800 Tsiganes, au cours de l’été 1941. Les souvenirs des survivants du génocide et des vivants en diaspora sont aussi peu volumineux que le joli sucrier en argent, seul objet arrivé jusqu’à Paris. Mais il reste l’histoire orale transmise par ses parents et une trace mémorielle très puissante, un album d’environ quatre-vingts photos de famille, mises en annexe, qui couvrent en gros les années 1920 à 1958, plus quelques-unes qui appartiennent à notre siècle. Leur présence rapproche le lecteur et donne un caractère encore plus fort et plus poignant au témoignage.
La mémoire d’autres témoignages venant ainsi combler sa propre mémoire, Élise Marienstras remonte à l’enfance de ses parents à Slonim et clôt son récit par la mort de son mari et compagnon de vie de soixante ans, Richard. Elle retrace ses identités diverses, de ses deux ou trois premières années passées à Slonim avec sa grand-mère – « mémoires sans mémoire » de sa langue grand-maternelle, le yiddish, sa première langue vite oubliée car il fallait s‘assimiler une fois de retour à Paris – à sa vie d’enfant cachée pendant la Seconde Guerre mondiale : des mémoires bien ancrées celles-là dans son souvenir, comme la traversée à dix ans de la ligne de démarcation, seule au milieu d’un champ de boue, l’œil rivé sur le garde armé qui se tient tantôt de face, tantôt le dos tourné ; puis, au sortir de la guerre, son sentiment très vif d’appartenance au peuple juif, ashkénaze et litvak, son engagement dans un kibboutz au lendemain de la création d’Israël. Ce kaléidoscope d’identités, tantôt subies, tantôt assumées, est un des fils directeurs de ces mémoires.

Une première partie du livre est donc consacrée à la ville de Slonim, à la matrice slonimienne familiale, aux temps heureux de la jeunesse dorée dont faisait partie sa mère, la Jewish Princess, puis aux exilés, et, pour eux comme pour tous, la nécessaire assimilation. Une deuxième partie s’engage dans l’autobiographie, celle d’une petite fille douée qui saute des classes en cachant son âge, avant, bientôt, de cacher son nom et son identité sous l’Occupation. Elle en aura au moins quatre, pendant l’errance et des hébergements où parfois la France pétainiste menace directement l’enfant lucide. À la Libération, Élise sera saisie d’un mal étrange, frappée d’un sentiment d’imposture qui ne la quitte plus. Les atteintes psychiques de la clandestinité chez une petite fille d’une dizaine d’années donneront en 1946 à la sortie de la guerre une révolte adolescente volcanique, due à la colère et au ressentiment d’une enfance traquée. Suivront, après une période d’émancipation, des années lumineuses, heureuses même, les premières amours et surtout la rencontre avec Richard Marienstras dont le berceau est la Pologne, un être éblouissant, dont le parcours fut exemplaire, adolescent porteur d’armes aux partisans du Vercors, poète et shakespearien inspiré, porteur de l’héritage du bundisme.
Élise Marienstras livre des éléments de sa vie sans fausse pudeur, mais sans étalage, sa vie intérieure comme ses rêves, son quotidien et ses rencontres. Dans le récit de sa vie de femme, outre ce bonheur immense qu’elle ressentit à la naissance de sa première fille, l’auteure se souvient de ses années passées dans les bibliothèques des États-Unis comme des meilleures de sa vie. Son intérêt pour les concepts de nation et de fédéralisme, ses recherches sur les autochtones et leur résistance face à la colonisation allochtone – s’articulant autour d’une condamnation de l’approche exceptionnaliste de l’histoire des États-Unis – lui ont apporté une très grande notoriété, bien au-delà des cercles universitaires. Pourtant, le livre ne fait pas état de son immense carrière d’historienne ; elle l’inclut avec générosité dans le cadre d’une communauté savante très innovante et solidaire, celle de l’Institut Charles V au lendemain de mai 1968 et de la réorganisation des universités parisiennes. Ce n’est pas nécessaire. Mémoires sans mémoire témoigne de son savoir-faire historien, évoqué dès les premières pages où la mémoire est déroulée au fil des vies. Mémorialiste, historienne, Élise Marienstras ? Les deux.
Rarement on aura éprouvé à ce point dans un livre, loin des rites, du folklore, et d’une religion ancestrale, ce que veut dire appartenir à une minorité en terre étrangère, pour tous les siens, la lignée paternelle des Lichtensztejn, maternelle des Svereszweski, comme pour l’entourage et pour elle-même. L’enjeu du livre est donc de transmettre cette histoire, dans une relation au passé jamais hypostasiée tout en contenant tant de force, de courage et de drames, à ceux qui vivent aujourd’hui. La fin ressemble beaucoup à une sonnerie aux morts, parents (dont son admirable père) et amis, rassemblés pour nous dans le finale d’un livre-tombeau. Et pourtant, combien on y célèbre la vie !