Tout est poésie, et de haute qualité, chez Tristan Felix, artiste protéiforme qui s’illustre également dans l’écriture, le théâtre et l’expérimentation tous azimuts (photographie, chant, dessin à l’encre de Chine et plus récemment peinture où vibrent les couleurs issues de mélanges aussi improbables que ceux de Victor Hugo et de quelques autres).
Tristan Felix, Rêve ou crève. Poésie spectraculaire. Tinbad, 118 p., 15 €
Tristan Felix, Les Hauts du Bouc et autres nouvelles. Aethalidès, coll. « Freaks » 122 p., 17 €
Tristan Felix, La forêt, une pensée brûlante. PhB éditions, 179 p., 15 €
Ses observateurs attentifs, dont je suis, craignent en permanence que la multiplicité même de ses dons, vraiment spectaculaire, ne conduise Tristan Felix à des travaux un peu moins inventifs que dans la série mémorable des « contelets » d’Ovaine La Saga (Tinbad, 2019), à ce jour son œuvre la plus accomplie. Mais c’est une crainte vaine. L’invention sauvage, la spontanéité, ne manquent jamais chez cette assoiffée de l’examen et de la mise en scène du vivant sous la plupart de ses formes, y compris les inertes, qu’elle accueille volontiers dans son zoo intime, comme Nerval.
Naturellement, sa frénésie manufacturière, qui s’étend au besoin de publier sans trêve – après, il faut le noter, comme pour tous les vrais poètes, des années de rétention forcée de recueils prêts mais n’ayant pas trouvé immédiatement d’éditeur –, explique que la cohérence esthétique ne soit pas toujours parfaite dans lesdits recueils enfin venus au jour, mais ce qui est certain, en revanche, c’est que le niveau de l’œuvre s’enlève très nettement au-dessus de la majorité de ce qui pullule aujourd’hui sous le nom abusif de poésie.
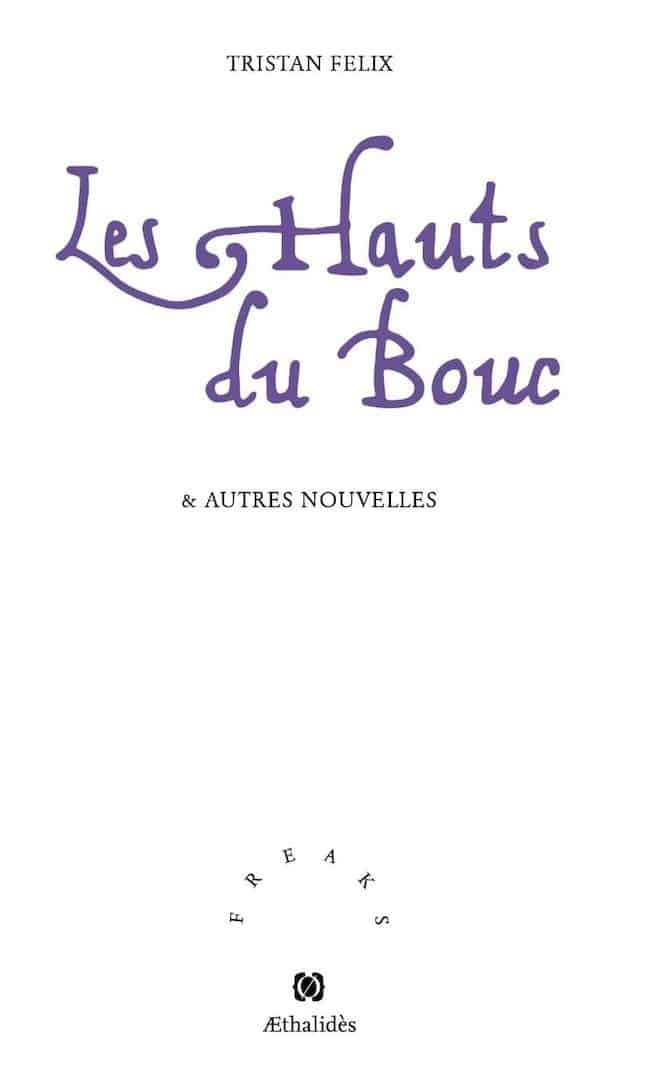
Prenez Les Hauts du Bouc (éd. Aethalidès), un ensemble de vingt-cinq textes distribués en trois sections, la première consacrée à des instantanés d’un voyage en Irlande, la seconde à des portraits ou évocations d’animaux (le singe, la cane, le chien), la troisième à des souvenirs de paysages ou d’histoires du Finistère. À la première lecture, j’avais trouvé certaines de ces pages un peu trop « artistes » au sens des Goncourt, un peu trop léchées et sophistiquées pour être vraiment « authentiques ». Mais les relectures indispensables en poésie m’ont prouvé que j’avais tort, mon goût étant, malgré moi, influencé par le laxisme et la surenchère de fausse simplicité de tant de poèmes actuels (trois mots se regardant en chiens de faïence au milieu d’une page) ou tout simplement par l’absence de maîtrise de la langue qui sévit aujourd’hui quasi universellement.
Alors oui, j’ai des préférences, dans ce très beau recueil, pour les histoires un peu longues où se donne à lire une sensibilité aux gens ordinaires (l’admirable vieille Lucie qui enterre son chien, dans « Le gland »). On y retrouve, mais portées à une sorte de rêverie extatique, la force et la justesse de certaines des Histoires naturelles de Jules Renard. Mais je citerai aussi ce conte tragique (« Une dent contre la mort ») où l’inspiration se mêle si étroitement à l’observation que l’auteure y rappelle telle réussite de Prévert (« Drôle d’immeuble », par exemple).
Si mes choix peuvent ou doivent presque nécessairement ne pas rencontrer ceux d’autres lecteurs, je veux au moins affirmer que l’écriture de Tristan Felix ne cesse d’être un français de la plus belle facture, cette attention constante au matériau de notre langue, maltraité par inculture en tant de lieux, étant un préalable non négligeable au plaisir que nous prenons à lire des textes par ailleurs fort et bien « engagés », en particulier dans une forme souvent véhémente d’amour envers les êtres, hommes et bêtes, végétaux et cailloux, qui tentent de subsister en dépit de nos dérives meurtrières.
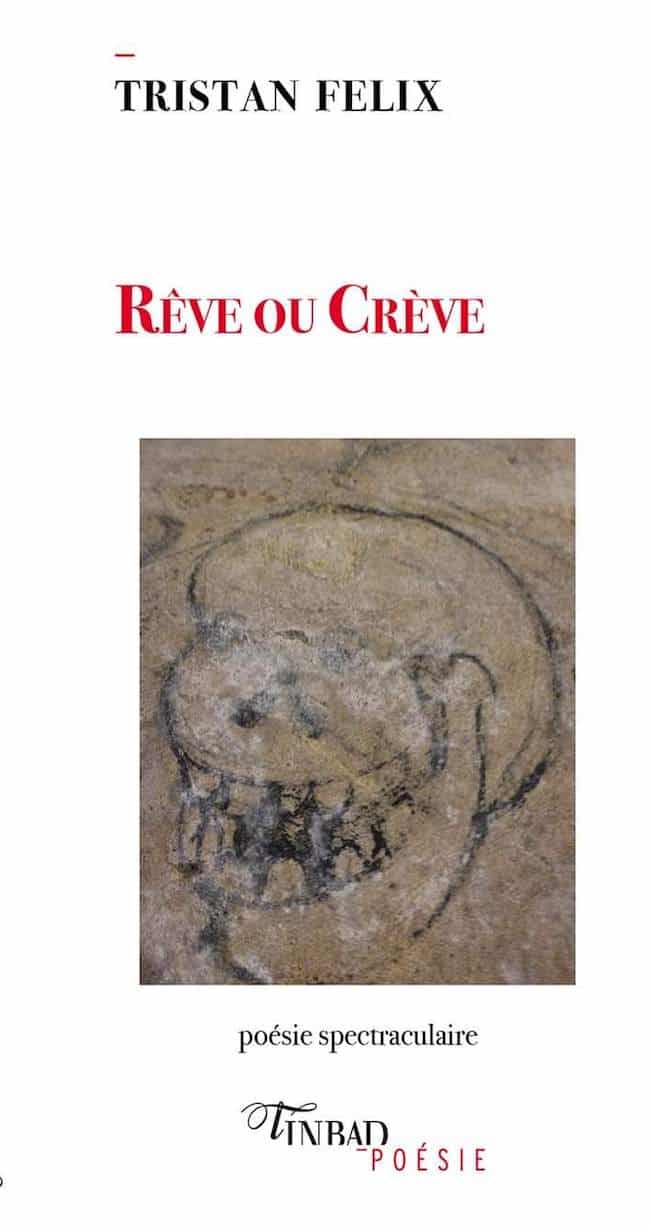
Rêve ou crève, dont la dernière partie (« Monstre-toi ») prolonge la problématique faussement morbide du formidable Observatoire des extrémités du vivant (Tinbad également, 2017), où se laissait reconnaître déjà une fascination/tendresse à l’endroit du monstre au sens tératologique du terme (les avortons du musée Dupuytrein), offre un ensemble plus inégal. La faute en incombe à ce qu’une partie du livre est consacrée (en particulier « Crâneries », premier volet) à des textes qui relèvent plus spécifiquement des spectacles donnés depuis ses débuts par Tristan Felix dans le cadre de ses activités scéniques, tant pour la compagnie défunte du « Pergonicaspop » que pour l’actuel « Petit Théâtre des Pendus ».
Ceux qui ont assisté à ces performances, souvent très réussies (à la Halle Saint-Pierre à Montmartre, notamment) n’auront aucun mal à restituer l’univers sonore et visuel singulier créé par l’actrice/chanteuse/diseuse de langues inventées/danseuse/clown trash, univers souvent fixé par la caméra de l’excellent Nic’Amy, et ce retour sur des moments rares et quelquefois jubilatoires les enchantera. Mais le lecteur réduit au seul texte risque une déception, dont il se remettra en prenant connaissance des méditations, plutôt funèbres que joyeuses, mais riches de fureur rentrée, qu’a inspirées au poète la visite clandestine d’un « jardin d’essai colonial » datant de la fin du XIXe siècle, installé dans l’est parisien – j’en ignorais jusqu’à l’existence. De coloration très sombre sont aussi les « Trois visions nucléaires » qu’elle essaye un peu vainement de rédimer grâce à l’injonction finale du livre : « T’es pas crevée si tu rêves / Alors crève pas ». En dépit de l’énergie prophylactique déployée par la voix poétique, la période des lendemains qui chantent paraît lointaine.

Au moins Tristan Felix, dont le pseudonyme dit bien la double postulation de son art, la tristesse foncière et l’aspiration au bonheur, a-t-elle la chance d’être enseignante dans le secondaire au collège Marie-Curie du XVIIIe arrondissement de Paris. Elle y fait profiter la population métissée de ses élèves de français de sixième et cinquième de son incroyable capacité d’attention à l’autre et de son talent pour construire des expériences collectives originales et enrichissantes. Ce sont ces expériences, à la fois littéraires et graphiques (écrire des aphorismes sur des notions aussi complexes et problématiques que « le Temps », « le labyrinthe », « la Beauté », « l’Infini » ; créer sur papier des dessins, individuels ou collectifs, sur les thèmes de « la Forêt », « la Pensée », « le Monstre en soi », dont certains suscitent aussi des calligrammes), qui constituent l’unique matière, saisissante, du remarquable ouvrage, remarquablement introduit par l’enseignante, que vient de publier Philippe Barrot.
On s’y étonnera, on s’y extasiera. Le sérieux de l’approche du sujet, souvent la profondeur de la réflexion des enfants, parfois le frémissement des situations personnelles sous-jacentes (dans la périlleuse tentative « le Monstre en soi »), mais toujours l’extrême précision du pilotage par la « maîtresse » de la psychologie fragile de ses élèves, tout cela force l’admiration.
Tristan Felix ne serait pas le poète qu’elle est sans une empathie (« humanisme » est trop galvaudé et du reste restrictif) à la fois viscérale et philosophiquement fondée qui englobe la totalité du vivant jusqu’au Ciron et au-delà. On le savait déjà, cette publication le confirme. Elle mérite de grands éloges et sa lecture devrait être recommandée, sinon imposée, à tous les pédagogues et chefs d’établissement soucieux de la santé mentale des professeurs et de leurs ouailles.












