Servi par une excellente connaissance de la société américaine, l’ouvrage d’Alex Mahoudeau propose une analyse convaincante de ce qu’il nomme La panique woke (peut-être aurait-il fallu, pour plus de clarté, parler de la « panique anti-woke »). Son travail vise avant tout à dégager la signification politique de l’engouement pour le « wokisme . Il montre que nous avons affaire à une opération idéologique d’appropriation d’un mot pour le transformer en instrument d’occultation de la réalité des discriminations fondées sur la couleur de peau. Cette offensive est un indice consistant de la guerre culturelle que mène la pensée réactionnaire contre tous ceux qui établissent un lien entre notre passé colonial et/ou esclavagiste et la persistance de la stigmatisation ethno-raciale.
Alex Mahoudeau, La panique woke. Anatomie d’une offensive réactionnaire. Textuel, 160 p., 16,90 €
On sait que « woke » est un mot qui circule dès l’abolition de l’esclavage pour décrire l’expérience des Noirs dans une société marquée par le racisme et la ségrégation. L’idée d’un nécessaire réveil des Noirs est développée dans un texte de Booker T. Washington en 1896, Awakening of the Negro. L’expression « being woke » s’est popularisée aux États-Unis dans la communauté afro-américaine tout au long du XXe siècle (elle apparait en 1943 dans un article de The Atlantic qui cite un syndicaliste noir appelant au combat contre l’exploitation économique) pour désigner une nécessité : celle de rester attentif aux injustices, alors principalement de nature socio-économique. C’est à partir de 2008 que le mot connait une certaine notoriété grâce au morceau Master Teacher : « I stay woke », y chante Erykah Badu. Il dit l’importance de rester en alerte devant les menaces que subit quotidiennement un Noir (mais pas seulement : l’expression est aussi un appel à la vigilance dans les rapports amoureux).

© Jean-Luc Bertini
Le slogan, repris par le mouvement Black Lives Matter, après la mort de Michael Brown, abattu par un policier blanc à Ferguson en 2014, gagne en popularité avant d’être récupéré par les conservateurs américains pour le dénigrer et, plus généralement, pour disqualifier ceux qui en font usage. C’est ainsi que s’impose le terme « wokisme », qui suggère l’existence d’un mouvement politique homogène chargé de propager l’idéologie « woke ». On est ainsi passé d’un adjectif à un substantif que, notons-le, les Anglo-Saxons n’utilisent pas. Il est d’ailleurs assez cocasse que la dénonciation, récurrente en France, de l’américanisation du débat s’accommode de l’utilisation (fautive) de mots américains.
Désormais, le « wokisme » désigne péjorativement ceux qui sont engagés dans les luttes antiracistes, féministes, LGBT ou même écologistes. C’est un mot qui, comme le note Valentin Denis, « ne se caractérise pas par son contenu, mais par sa fonction : stigmatiser des courants politiques souvent incommensurables tout en évitant de se demander ce qu’ils ont à dire ». Il est, en France, considéré comme le nouveau danger qui menacerait l’école républicaine. Dans la rhétorique réactionnaire des nouveaux inquisiteurs, on pratique une stratégie d’éradication lexicale visant à éliminer du vocabulaire des sciences sociales des termes tels que « racisme systémique », « privilège blanc », « racisation », « intersectionnalité », « décolonialisme », « cancel culture », etc., supposés dénués de toute rationalité. À de nombreux égards, la querelle ressemble à celle de la « political correctness » du début des années 1990.
Alex Mahoudeau rappelle opportunément que George H. W. Bush avait pris position contre le « politiquement correct » et que le polémiste Pat Buchanan décrivait (en 1992) l’élection présidentielle comme une guerre culturelle « aussi critique pour l’identité de notre nation que la guerre froide, car l’enjeu de cette guerre sera l’âme de l’Amérique ». La political correctness est la conséquence de l’offensive des conservateurs, dès les années 1980, contre le pouvoir supposé des minorités. On réactive alors la notion de « backlash », laquelle décrit la façon dont les progrès sur le plan de l’égalité des droits et des statuts sont suivis de régressions : ainsi, le féminisme des années 1970 aurait eu, selon ses contempteurs, des effets négatifs sur la vie des femmes et, au-delà, aurait ruiné la vie familiale en général. Une « rhétorique des effets pervers » qui vient justifier la diminution des aides sociales et la criminalisation de la pauvreté en même temps que les attaques contre les centres médicaux pratiquant l’avortement au profit d’une politique familialiste et régressive sur le plan des mœurs.
Le même phénomène s’observe à propos de l’antiracisme, et ses effets restent particulièrement vifs comme le montrent les fréquentes attaques contre la Critical Race Theory : plutôt que de dénoncer le racisme, on va s’inquiéter des supposés excès de l’antiracisme ! On ne s’étonnera pas que l’Université, accusée de sacrifier la « haute culture occidentale » et de succomber à la nouvelle pensée diversitaire, soit la cible privilégiée des attaques conservatrices. Il conviendrait donc, devant la crainte d’une atteinte aux libertés académiques, de la purger idéologiquement. Et le champ de l’épuration est large : marxistes, multiculturalistes, féministes, postmodernistes, etc., tous accusés, entre autres vices, de puritanisme, de censure, de dictature des minorités. En fait, comme le montre Christopher Newfield, les guerres culturelles à l’Université ont accompagné les politiques de privatisation, de managérialisation et de coupes budgétaires [1].
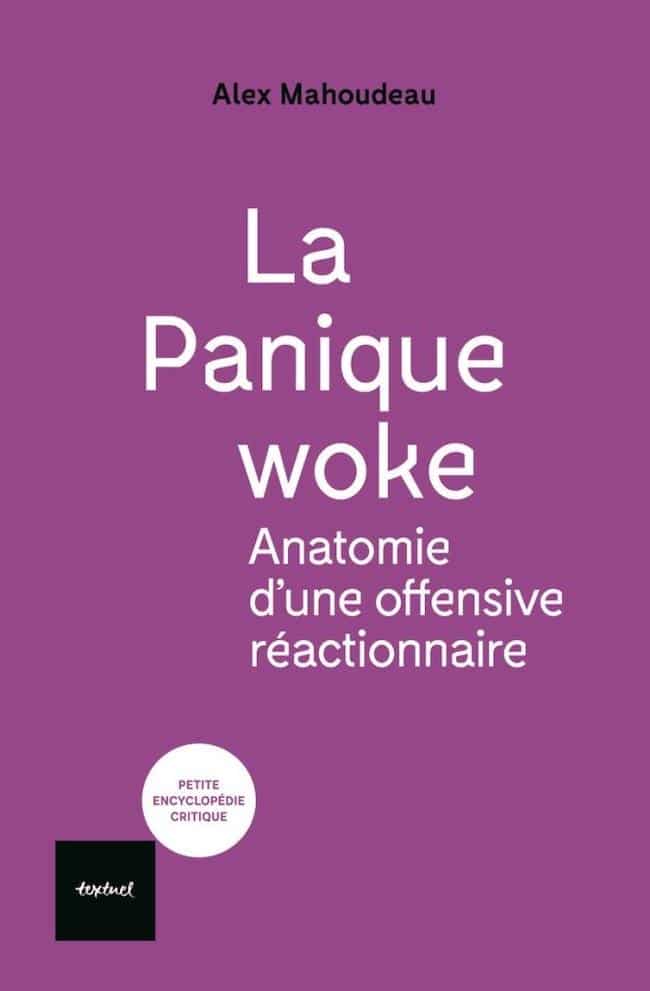
Les accusations de « wokisme » sont portées contre les intellectuels soucieux d’analyser les inégalités sociales, les violences policières et sexuelles et, surtout, attentifs au sort des minorités. On présuppose ainsi l’existence d’une idéologie racialiste anti-blanche et l’on inverse les termes victimaires en faisant de la culture dominante une culture assiégée. La « culture de la victimisation » serait désormais dominante dans les universités (mais aussi dans les entreprises, les médias ou encore l’administration). Pourtant, comme l’a montré Albin Wagener, la recherche et l’enseignement en sciences humaines et sociales ne s’engagent que bien peu sur la voie du « wokisme ». En revanche, on ne compte plus les officines qui se donnent pour objectif de le combattre. Parmi celles-ci, l’Observatoire du décolonialisme et ses obsessions républicanistes, mais aussi des pans non négligeables du pouvoir – ministres, figures politiques de l’ancienne gauche hyper-républicaine, de la droite, de l’extrême droite, sans oublier universitaires et journalistes. Comme le remarque Michel Wieviorka, « avec eux, il n’y a pas de nuance, de sens de la complexité, ils rejettent aux extrêmes ceux qui ne sont pas sur leur ligne [2] ». On trouve un exemple de cette simplification dans la création par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer d’un « Laboratoire de la République », présenté comme une arme « universaliste » contre le « wokisme ». En son sein, des républicains de papier proclament défendre le véritable féminisme ou l’antiracisme authentique.
Il s’agit, pour Alex Mahoudeau, de comprendre les mécanismes de cette « panique morale », expression forgée par Stanley Cohen en 1972 : « Une forte préoccupation de l’opinion publique […] vis-à-vis d’un groupe dont le comportement est perçu comme une menace pour les valeurs de la société ou pour l’existence même de cette société ». Qualifier un discours de « panique morale » ne signifie pas qu’il s’agisse d’une fiction. Mais les éléments qui sont mobilisés sont « présentés d’une façon spécifique, destinée à conforter l’ambiance de dramatisation et de diabolisation dans laquelle la panique s’insère ». Nécessairement disproportionnées, et souvent volatiles, les paniques morales, tout particulièrement la panique « woke », impliquent une certaine représentation du politique dans laquelle les situations de stigmatisation et de discrimination sont réduites à des postures victimaires.
Le discours « anti-woke » se fonde ainsi sur une opposition artificielle entre une gauche identitaire, déconstructionniste, postmoderne, ou encore néomarxiste (qui développerait des thèses irrationnelles ou absurdes), et des gens « normaux » qui défendraient la liberté de penser, la rationalité, le courage intellectuel. Qui ne s’en réclamerait ? Quelle est donc la valeur d’une position qui rassemble tout le monde et qui chasse des fantômes ? Nous sommes confrontés à ce qu’Albin Wagener a judicieusement décrit comme une figure de l’épouvantail. Celle-ci fait référence à « la stratégie d’argumentation fallacieuse de l’homme de paille, qui consiste à créer un avatar déformé d’un individu ou d’un groupe d’individus, puis de mettre en scène le combat contre cet avatar ». Comme le résume Alex Mahoudeau, la panique woke n’adhère pas nécessairement à une idéologie bien claire : « C’est tout l’intérêt d’un discours reposant sur la caricature » qui tend à faire croire qu’il n’existe qu’une seule politique possible, la « politique de l’apathie », telle qu’elle s’observe dans le monde de l’entreprise où la publicité est recouverte d’une « fine couche de vernis prétendument progressiste pour continuer de vendre », transformant « les sentiments complexes autour de la question de la justice sociale pour les traiter comme un combat de fans autour de leur marque préférée ».
Une politique émancipatrice implique, à l’opposé, de prendre conscience que la « wokeness » n’est pas autre chose qu’une dynamique inhérente à la démocratie et, au-delà, l’indice des manquements de celle-ci à ses principes fondamentaux. Aujourd’hui, tous ceux qui remettent en question l’ordre social et politique, qui sont attentifs à la justice sociale, à la condition féminine et à celle des minorités racisées, sont susceptibles d’être accusés de « woke ». Il est important de ne pas se laisser abuser par une stratégie visant à disqualifier les militants progressistes en s’appropriant leur vocabulaire pour le vider de son sens.
-
Christopher Newfield, Unmaking the Public University. The Forty-Year Assault on the Middle Class, Harvard University Press, 2011.
-
Michel Wieviorka, « Wokisme » in Alain Policar, Nonna Mayer et Philippe Corcuff (dir.), Les mots qui fâchent, L’Aube, 2022.












