Peut-on dire que Tonino Benacquista est plus connu comme scénariste que comme écrivain, que son goût des images a éclipsé son goût des mots ? Ce serait contredire sa biographie. Car ce sont les mots qui l’ont sauvé de sa condition de « rital », né dans une famille quasiment analphabète. C’est le sujet de son nouveau livre, Porca miseria.
Tonino Benacquista, Porca miseria. Gallimard, 208 p., 17 €
Mais on pourrait tout aussi bien affirmer le contraire : les mots, il avait du mal à les lire, c’est peu de dire que les livres qui lui étaient proposés à l’école lui tombaient des mains. Et pourtant l’œuvre littéraire de Tonino Benacquista est très abondante. Oui, mais sa production scénaristique l’est au moins autant.
On pourrait poursuivre : les mots lui ont permis d’obtenir cinq prix littéraires, un César du meilleur scénario pour Sur mes lèvres de Jacques Audiard et un César de la meilleure adaptation pour De battre mon cœur s’est arrêté du même cinéaste, des prix pour ses bandes dessinées.
Tonino Benacquista est inclassable. Est-ce un touche-à-tout ? Le mot est péjoratif. Un inquiet, un instable, qui passe d’un genre artistique à un autre ? Si c’est le cas, il le fait avec un talent reconnu. Comme ça, sans crier gare, comme en se jouant ? Pas vraiment. C’est ce qu’il nous raconte dans Porca miseria, le juron que son père se plaisait à beugler, éructer, soupirer… sur tous les registres. En réalité, il paie cher sa sortie du malheur migratoire, et même le moyen de locomotion qu’il a adopté pour en sortir : remplacer la réalité par le rêve, le songe, l’imagination. En court-circuitant tous les modèles d’intégration qui lui étaient proposés. En faisant des pieds-de-nez aux institutions, à commencer par l’école. Et cela sans agressivité, humblement, en douce et avec douceur.

Tonino Benacquista © Jean-Luc Bertini
Par quoi commencer pour décrire son parcours ? Lui-même ne commence pas vraiment. Il semble tourner en rond, se répéter et tout autant se contredire. Il dit la réalité et son contraire, sa rêverie sur elle. Il relate le vrai et s’en console par le faux. Mais le faux l’est-il tant que ça ? Lui prétend que non. On le croit volontiers tant il possède l’art de nous attirer dans chacune de ses histoires.
Car c’est ce qu’il propose, des histoires, pareilles à de courtes nouvelles, et non un bon vieux gros roman. Ce sont les nouvelles qu’il préfère. Chacun de ses brefs chapitres, donc, pareils à des nouvelles, en ce sens qu’ils pourraient se lire de manière autonome, qu’ils sont compréhensibles à eux seuls et se terminent, la plupart du temps, par une chute qui en fait tout le sel, qui en ramasse le sens, ou la morale.
Sens ou morale, dans le sens d’« éthique » : les textes de Tonino Benacquista en sont pétris, ils donnent, presque à chaque ligne, à penser, la jovialité, la légèreté apparente du ton n’excluant pas, loin de là, la profondeur du propos. Sans chercher jamais à donner de leçon. À se prétendre supérieur. À ratatiner son interlocuteur ou son adversaire. Rageur (contre certains) et bienveillant vis-à-vis du genre humain. Par exemple vis-à-vis de ses géniteurs dont il dit pourtant pis que pendre. Oui, tout cela est possible avec lui. Et même davantage.
Tenons-le-nous pour dit : Tonino Benacquista a décidé de nous enchanter en nous perdant. On est toutefois sûrs de quelques faits, on possède un socle, qui ne change pas trop, ou du moins qu’on peut vérifier par recoupements. Son père est un buveur invétéré, sa mère une dépressive chronique, il a un frère et trois sœurs. Lui est le petit dernier. Celui qui devrait être protégé. À qui on devrait tenir la main. Or c’est lui qui tient la main de sa mère quand elle doit se rendre chez le médecin. Quant à ses sœurs, que le père vouait aux cours Pigier comme on voue ceux qu’on hait aux gémonies, elles semblent avoir choisi leur propre voie mais on ne sait pas bien laquelle tant l’auteur paraît la réinventer à chaque nouveau chapitre. Nous voilà donc embarqués avec lui dans sa fragile nacelle, capable cependant de nous envoler loin des noirceurs terrestres et de nous consoler à la fraîcheur des rêves.
Au passage, il nous donne accès à sa méthode : voler à la réalité un trait de caractère, un détail physique, une situation et les agréger selon sa volonté ; parsemer ses chapitres de sentences bien senties, dotées de gouaille et de sagesse comme on en trouve dans les dictons ou dans les répliques de Michel Audiard. Tout Tonino me paraît là. Dans cette ferveur intime qui lui permet d’écrire, à propos de son père : « Le plus beau cadeau d’un père à sa fille : un jour entier de lucidité » ; à propos de sa mère : « Pour elle, l’attente n’est pas du temps, c’est un état » ; à son propos à lui : « Pour ma part, je sais dater le jour où j’ai perdu confiance en ma mère » ; « Ma culture à moi, je la puise où je peux, et pas à l’école, où les objets d’étude sont objets de tourments, jamais de plaisir. »
Enfant, il se délecte de Cavanna, autre rital, de René Goscinny, Marcel Gotlib. « Pour un enfant en quête de repères, l’œuvre de Gotlib est une chance » ; « Et c’est sans doute en lisant ses albums que, pour la première fois, l’idée d’humanisme prend à mes yeux un sens », alors que son père ne lui transmet rien. Pourtant, il se serait contenté de peu, « même un proverbe napolitain aurait fait l’affaire ». Ou alors ce qu’il lui transmet sont des valeurs inversées, inspirées de la comédie italienne, où s’épanouissent des personnages « rois du Système D, dénués de tout sens du devoir, experts en esquive, pacifistes par pragmatisme, couards jusqu’au génie », où la lâcheté devient vertu puisqu’elle s’oppose à l’absurdité meurtrière de la guerre.
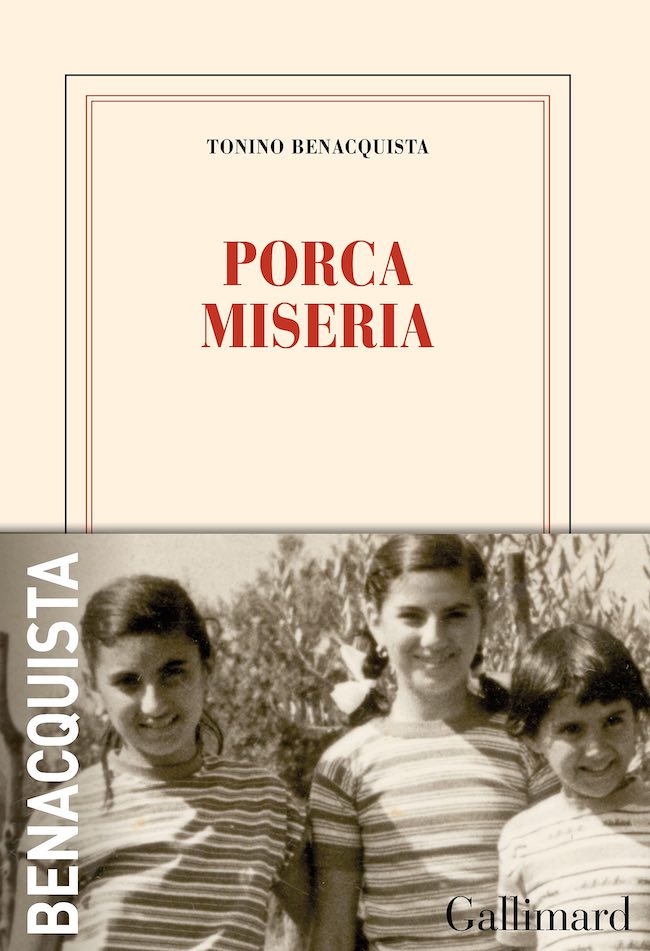
De la même manière, ou presque, son fils Tonino conteste violemment la légitimité des écrivains établis dans la notoriété, enseignés à l’école, parce qu’il ne parvient pas à s’y intéresser : La guerre du feu le laisse de glace, et l’enferme dans l’ennui, qui consiste à « dilapider dès le premier âge tout le temps qui nous manquera plus tard » ; le bon Boileau le rend nerveux quand il affirme : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement », ce qui revient à donner son « blanc-seing à tous les enfumeurs » et à mettre « la honte à tous les bafouilleurs ». Le lisant, on éprouve avec lui, l’émigré, à quel point le programme officiel de l’école a pu être, est sûrement encore, humiliant, parce qu’il renvoie l’élève, quand il ne l’y enferme pas, à sa propre ignorance.
La fêlure initiale commence à apparaître, on la partage, on la comprend, on l’a peut-être en soi aussi, on ne sera jamais le héros, l’héroïne dont on rêve, à moins d’en fabriquer soi-même à son image, ou de reprendre à Cyrano la superbe de son style : « La vie n’a qu’à bien se tenir » ; à moins d’obtenir le respect par le verbe, comme lui.
On accepte de perdre, d’être accusé à tort, à condition d’écrire, d’être soi dans ses livres et de s’y expliquer. « Ah si notre héros [il s’agit toujours de Cyrano] avait déboulé en personne dans Andromaque, il aurait ouvert les yeux d’Hermione sur les sentiments d’Oreste, il aurait rabattu le caquet de Pyrrhus en trois passes d’armes, il aurait délivré Andromaque de son deuil » ! Avec lui, Tonino, et avec Cyrano et tous les d’Artagnan du monde on vainc en rêve, par l’imagination, on renverse le cours normal des choses, on transforme la défaite en victoire.
Plaisir toujours vivace d’assister au triomphe du faible sur le fort, du juste sur l’affreux, du naïf empêtré sur le roi de la magouille. «Écrire, c’est se venger » ; et s’en donner l’autorisation, c’est devenir un autre, pas seulement en rêve. Dans la réalité. Qui du coup devient torse et se corse.
Choisir la voie de garage qui consiste à entrer dans « un joyeux club de losers », à s’éveiller chaque matin en prononçant le sésame « Il était une fois », bref, à perdre son temps en esthète, n’est pas sans risque. On peut y laisser non seulement les quelques sous qu’on avait dans son matelas, mais aussi sa santé tant mentale que physique, c’est-à-dire tomber dans le réel où « le pire nous surprendra toujours ». Ce n’est que dans les vingt dernières pages que Tonino Benacquista nous convie à entrer dans l’envers de son décor. Après avoir longuement plastronné en perdant heureux, en loser gagnant, il passe aux aveux : un jour, peu avant de prendre un train, il se fige, ne tient plus sur ses jambes. Et, à partir de là, entre dans un état d’« anxiété lancinante entrecoupée de tachycardie », ne parvient que difficilement à sortir de chez lui, est atteint d’agoraphobie, devient incapable de partir en voyage (« les seules destinations atteignables sont celles d’où je peux revenir à pied »), se met à craindre la complexité des vestiaires dans les piscines et les salles de sport, et bien sûr fuit par-dessus tout les ascenseurs. Un état peu compatible avec sa notoriété grandissante. Alors, que se passe-t-il ? Lui qui a souffert, avec son frère et ses sœurs, toute son enfance, d’un père trop alcoolisé, le voilà qui à son tour se met à boire : « On pense à tort que le buveur cherche l’ivresse. Il veut simplement retrouver un état normal. » Le jour où il est invité à la remise des Césars du cinéma, Tonino Benacquista pense à son père : « J’ai entendu prononcer son nom toute la soirée ». D’une certaine manière, il l’a rejoint.
Le lecteur se prend d’amitié pour ce fervent des mots qui se maintient dans leur bénédiction à la force du poignet, ce qui fait qu’il tient, en haut de la falaise, accroché sur le vide, tel Cary Grant dans La mort aux trousses. Et s’il écrit lui-même, il pense qu’il lui ressemble, émigré comme lui sur la terre, en pays d’Utopie.












