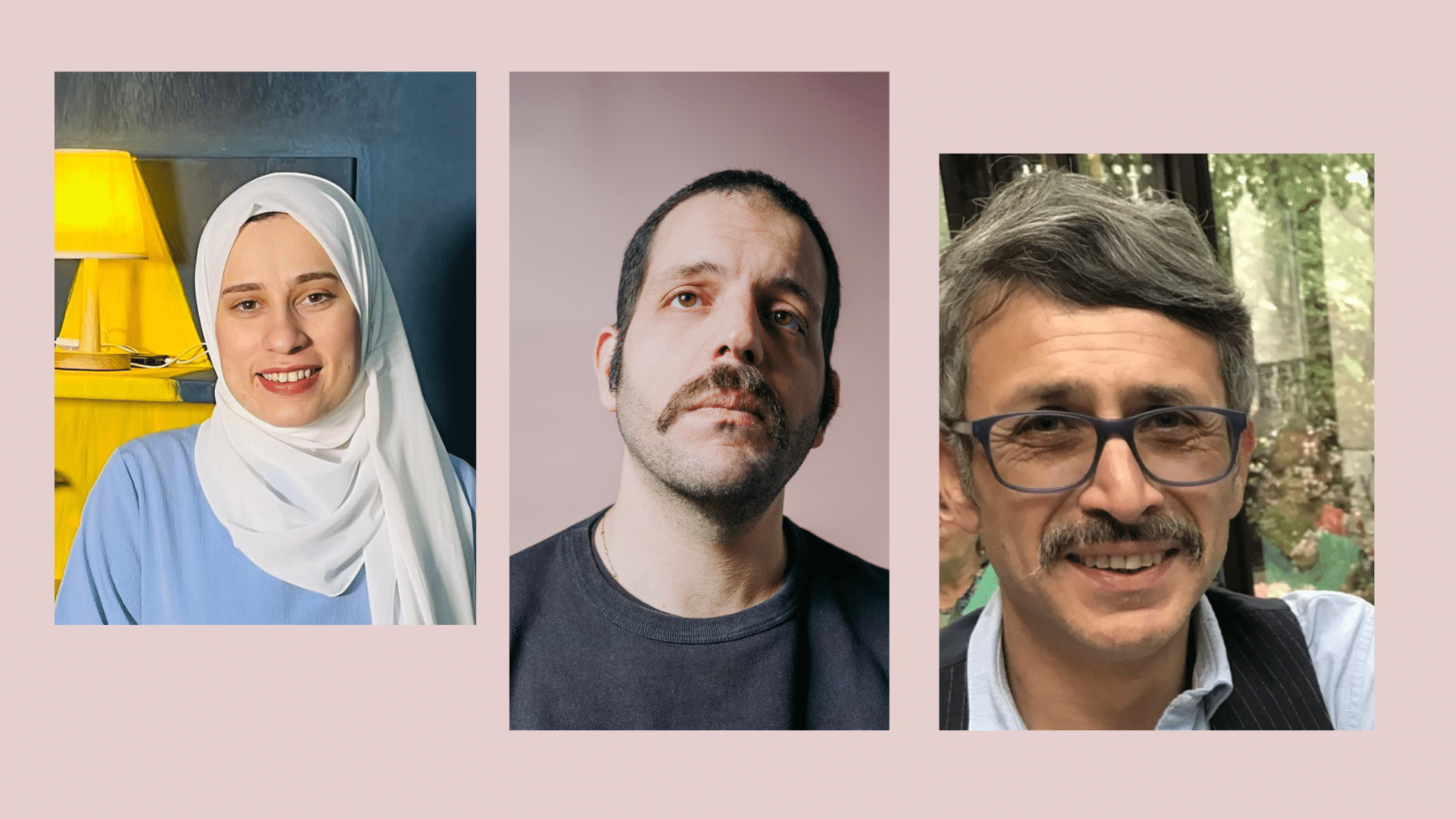De tous les prix reçus par Anise Koltz au Luxembourg, en Belgique et en France, le plus émouvant, à défaut d’être le plus prestigieux, est certainement le prix des Découvreurs [1]. Décerné par un jury de lycéens répartis sur une académie, il est la preuve que cette poésie [2], aussi déroutante qu’elle puisse paraître, est accessible à ceux et celles qui formeront les nouvelles générations de lecteurs. À condition qu’on leur ait appris à repérer ce qui se manifeste dans une œuvre d’art et à écouter ce qui parle [3].
« Quand je te parle
tous me répondent
tous se redressent
Je ne t’entends presque pas
Le soleil se détourne
quand vous ouvrez vos tombes
pour respirer un peu
Il y a des paroles
qu’on ne peut prononcer
Sur les lignes tendues de nos vies
elles montent et descendent
comme des saltimbanques
des somnambules
qui tombent
quand on les appelle »
1. Cet hommage en dix touches tente de montrer comment Anise Koltz nous aide, comme Miró en peinture, dans des dimensions de l’expérience humaine insoupçonnables avant elle. Je voudrais le commencer par des aveux.
D’abord, j’avoue que je n’ai pas lu l’intégralité de l’œuvre d’Anise Koltz. J’ignore les livres écrits en langue allemande. Je ne crois pourtant pas que cette ignorance fausse ma lecture. Somnambule du jour, d’où j’ai tiré tous les poèmes que je vais citer, m’apporte la conviction que l’essentiel est là dès le départ et il qu’il n’y a pas plus d’élaboration continuelle que de préalable à connaître obligatoirement. Dans un feu d’artifice, seules comptent les explosions.
Ensuite, je reconnais que mon intervention n’offre aucune garantie de fiabilité. Je suis comme Arsène Lupin qui, devant un coffre-fort, se frotte le bout des doigts au papier de verre pour mieux sentir les déclics. La fréquentation quotidienne des écritures de ce temps a affiné ma sensibilité à la spécificité des langages, au point que j’accorde autant d’importance à la qualité du rythme et des silences qu’à la signification globale.
Enfin, j’avoue que je suis jaloux d’Anise Koltz. Pas de la notoriété qui est la sienne aujourd’hui. Au contraire. Je me réjouis de son succès qui est un point de résistance face à l’inculture. Je suis jaloux de la façon dont l’impossible lui vient, car les poètes ne font pas ce qu’ils veulent mais comme ils peuvent avec les mots qui s’imposent à eux. Pour risquer une métaphore sportive, disons que seuls quelques-uns, du fait de prédispositions liées à l’intime, passent 2,40 m quand les autres, intelligents, sensibles et méritants, en restent à 2,35 m.
2.
« Si seulement il m’était donné
de me regarder
de me comprendre
de me posséder
Ce n’est pas mon existence
que je vis
Je suis différente de moi
Fondamentalement »
QUI ÉCRIT ?
« Toxicomane de la parole
je m’endors sous son poids
Est-ce moi qui écris le poème ?
est-ce le poème qui m’écrit ? »
« Ma vie est un livre
que je n’ai pas écrit
Je l’accomplis malgré moi
page par page
ignorant
ce que je vis
ce qui m’attend
Je suis le cauchemar d’un Dieu fou»
«Tout poème est à double sens
Celui qui lit est lu lui-même
par le poème »
Parmi les notions qui se veulent explicatives du fait poétique, celle développée par Henri Meschonnic d’un « sujet de l’écriture », différent du sujet biographique, du sujet social et du sujet de la psychanalyse, est une des plus pertinentes. J’y ai pensé à de nombreuses reprises pendant que je lisais Somnambule du jour. En effet, cette idée éclaire la volonté constante d’Anise Koltz, de la première phrase de la préface à l’un des derniers textes via les poèmes que je viens de citer, de dissocier celle qui écrit de celle qui vit, au point que cette dissociation est, avec la mère, la mort, le compagnon disparu et l’iconographie chrétienne, un des noyaux irradiant tout au long des dix-huit séquences de l’anthologie. Le poème inaugural, extrait du Cirque du soleil…
« Enterrer le jour
dans une taupinière
et oublier
dans laquelle »
… est emblématique d’une écriture indépendante – je ne dis pas coupée – de l’existence de l’auteur, de ses options philosophiques et de sa culture. Au fil des pages, il est évident que le je qui prend la parole a sa propre légitimité, ses propres évènements, sa propre échelle de temps.
3. La seconde notion à laquelle je recourrai est celle du langage profond, c’est-à-dire de ces phrases venues d’on ne sait où qui subvertissent le langage voulu en lui imposant des rapprochements inattendus, des modifications de lieux communs, des expressions détournées. Lié le plus souvent à des chocs ayant perturbé le psychisme, ne pouvant être confondu avec l’écriture automatique, le langage profond, dont Aragon parle à sa façon dans Les chroniques du bel canto, n’est pas sans me faire penser à ces parcelles que convoitent les chercheurs d’or qui passent au tamis l’eau d’une rivière. Ce qui compte, ce n’est le nombre de mètres cubes filtrés, mais le nombre de pépites trouvées. Ce qui compte, ce n’est pas le nombre de pages écrites par Anise Koltz, mais ce qu’elle en prélève.
4. C’est la présence non préméditée de ce surcroît de richesse qui fait d’Anise Koltz un grand poète de l’inconnu ou du non-connaissable ou du Grand Réel. Peut-on affirmer que, sans lui, le poème manque d’une dimension ? En tout cas, c’est lui qui fait que Robert Lorho devient Lionel Ray, que Quelque chose noir de Jacques Roubaud est une octave plus haut que le reste de sa bibliographie, que Claude Esteban prend son envol avec Élégie de la mort violente après vingt ans d’activité éditoriale… On peut appréhender différemment le phénomène en mesurant les effets de sa disparition, car cette richesse imméritée, impossible à fabriquer, se perd. Sa disparition explique à mes yeux pourquoi le Jacques Dupin de Gravir élabore à partir d’un moment son esthétique de la négativité, pourquoi le Jacques Réda d’Amen, La Tourne et Récitatif est supérieur au Jacques Réda de Retour au calme… Les poétiques qui en relèvent comptent parmi celles que je mets le plus haut.
Les livres d’Anise Koltz ont leur place dans cette admiration, et particulièrement Somnambule du jour. Des prélèvements opérés dans le recueil publié en 1966 à ceux tirés d’Un monde de pierres qui date de 2015, ses poèmes sont régulièrement déterminés par des surgissements, des cristallisations qui échappent au rationnel et au sens mais, en fin de compte, les font réapparaître, enrichis, sous d’autres formulations qui repoussent les limites de l’expérience humaine. Anise Koltz est un des rares poètes chez qui le minerai ne s’est pas épuisé et qui a su l’extraire puis le traiter grâce à une inventivité exigeante qui doit certainement beaucoup à la richesse linguistique de son milieu d’origine et à la fréquentation des meilleurs auteurs. Car, bien sûr, la poésie ne peut être ramenée au seul langage et encore moins au seul langage brut. Il ne suffit pas au comédien d’avoir de la présence sur scène, au chanteur d’avoir du gospel dans la voix. Tout au long de son existence, Anise Koltz a su à chaque fois découvrir quelque part en elle les moyens de tirer parti de ce qui faisait irruption sous sa plume. Attentive aux différences d’intensité de ses mots, ouverte aux associations virtuelles, elle a su trouver les coupes, les silences, les accentuations, les titres et les temps de vibration propres à convertir en poème ce que d’autres auraient raturé.
5. Il ne faut pas s’y tromper : il n’est pas donné à tous ceux qui bénéficient du langage profond et savent le détecter de parvenir à le traiter. Ses oxymores, ses formulations closes sur elles-mêmes, sont inconciliables avec le décompte des syllabes et l’emploi de la rime. Ils ne permettent pas non plus de se laisser emporter par l’élan lyrique, par la provocation surréaliste, et de développer une pensée, une émotion, un imaginaire. Que faire de formulations fondamentalement (et je reprends à dessin cet adverbe) obscures ou excluant la possibilité de donner une suite, à l’inverse de la phrase narrative qui appelle des compléments. Avec le langage profond, on n’écrit plus clairement ce qui se conçoit bien, on ne joue plus avec le non-sens. Plus écrite qu’écrivant (j’emprunte à nouveau ce renversement), Anise Koltz est sommée par ses brouillons de faire advenir l’inconcevable. Son poème est bien, comme l’a défini Tzara, un objet dérobé au futur, dont on ignore le fonctionnement. Si aucune difficulté n’apparaît dans l’art d’Anise Koltz, si tout semble évident, si « rien ne sent la sueur », c’est qu’elle a su poursuivre son travail d’élaboration jusqu’à ce que les traces en disparaissent.
AU CIMETIÈRE
« Tant de morts
autour de toi
Quand je te parle
tous me répondent
tous se redressent
Je ne t’entends presque pas
Le soleil se détourne
quand vous ouvrez vos tombes
pour respirer un peu »
6 À mes yeux, le poète est plus celui qui sait se relire que celui qui sait écrire, celui qui, au fait des apports de son époque, sait mobiliser ce qui est nécessaire pour libérer l’énergie de sa parole. En lisant Somnambule du jour, on s’aperçoit qu’à partir de sa singularité Anise Koltz a élaboré trois types de poèmes. Conscient de risquer d’être un éléphant dans un magasin de porcelaine, je distingue :
- Premièrement, les poèmes constitués par un surgissement. Le travail a consisté alors à trouver une mise en vers assurant une durée de vibration compensant la brièveté du paradoxe ou de l’image.
« Je vais
je viens
je sors du temps
Mon poids
alourdit l’univers »
« Chaque jour je mange
mon père et ma mère
avec du pain chaud
Je crache des touffes
de leurs cheveux »
« Béni soit le serpent
qui m’apprit la désobéissance
Je me purifie
je ne prie plus
J’allume le feu de mon enfer
et je chante »
LE JOUR ET LA NUIT
« Le jour
ton effigie change
avec la lumière
La nuit
ta chair blanche
brille dans l’obscurité
comme un glacier »
- Deuxièmement, les poèmes où le langage profond, limité à des traces, vient enrichir des textes où le creusement du thème, du sens et de la sensation, puis la chute, relèvent d’une impulsion et d’une manière de faire lyriques.
« Je rentre de plus en plus profondément
dans le paysage des autres
je possède en moi
toutes les directions
Je marche sur la terre rêche
Au loin j’entends des paroles
prononcées des siècles plus tôt
Leurs échos ayant traîné
dans l’univers
avant de m’atteindre »
- Troisièmement, les poèmes qui ne relèvent pas du langage profond mais d’intuitions provoquées par une situation concrète.
« La vieille d’en face
ne semblait pas savoir
que le temps était aboli
que le monde avait changé
Éblouie de soleil
elle se tenait devant la porte
et nouait son tablier »
7 L’art d’Anise Koltz ne se limite pas à l’écriture de poèmes. Elle s’est dotée d’une forme de recueil adapté à ses déflagrations silencieuses, capable de faire en sorte que leur lecture ne soit jamais saturée. Les différents types de poèmes s’y enchainent avec des variantes et des récurrences qui, au fur et à mesure des parutions, étendent le domaine poétique et finissent par donner un nouveau statut à l’existence et à ses vérités possibles. Tel livre est plus nourri par la réflexion sur le langage, tel autre explore davantage les rapports à la religion ou à la mère ou à l’histoire. Somnambule du jour est un condensé de cette trajectoire. Un condensé qui opère des prélèvements dans les recueils mais refuse obstinément qu’un texte soit coupé, soit réparti sur deux pages, et donc revendique l’unité de temps.
8 Ma première lecture d’Anise Koltz date de la fin des années 1960. Elle se situe au commencement de mon parcours de lecteur farfouilleur et éclectique. Dans une librairie d’un Quartier latin mal remis des fracas de Mai 68, je suis tombé par hasard sur la collection de Pierre Seghers « Autour du Monde », et sur une plaquette, Le cirque du soleil, dont les poèmes traduits m’ont décontenancé et fait ressentir des sensations qui n’avaient pas de nom. J’ai perçu d’instinct qu’au-delà des fausses parentés ils ne relevaient pas du surréalisme pour lequel je me passionnais mais que celui-ci rendait possible leur compréhension en dégageant la poésie du fatras des vieilles assignations. Le nom d’Anise Koltz s’est immédiatement inscrit dans les constellations que mon enthousiasme dessinait à grands traits. Si par la suite j’ai fait un détour par les formalismes, je me souviens d’avoir eu, en 1982, une conversation avec Guy Goffette durant laquelle nous nous sommes aperçus que nous la considérions comme l’un des auteurs qu’un véritable amateur de poésie devait défendre. Guy, dont je m’apprêtais à publier Solo d’ombres, m’avait invité à Harnoncourt. Nous avons fait connaissance en échangeant nos trésors, convaincus qu’une faute de goût serait fatale à notre amitié naissante. À l’époque, l’esprit d’avant-garde et ses ostracismes refluaient, sans que la pertinence de certaines de ses objections puisse être niée. Il fallait trouver des solutions aux impasses du lyrisme, de l’engagement politique. Notre génération cherchait ses voies et ses voix. Jusque tard dans la nuit, nous avons avancé des noms que nous savions ne pouvoir être aimés que par de vrais lecteurs. Saluer Frénaud, Bonnefoy, Guillevic et Follain, mettre l’accent sur la collection des « Cahiers du Chemin », distinguer Réda, Salabreuil, Stéfan, était déjà une preuve de maturité critique. Mais tirer de l’oubli Max Elskamp et Jean-Marie Levet, s’enthousiasmer pour des auteurs comme Dadelsen, Lucien Becker, Anise Koltz, Vargaftig, cachés derrière l’agitation littéraire, tout cela a donné à chacun une pleine confiance en l’autre.
9 J’aimerais avancer une dernière notion liée à une anecdote… C’était en 2000. Je venais d’achever dans une classe de primaire un atelier d’écriture de plusieurs mois durant lequel j’avais familiarisé les enfants avec quelques potentialités du langage. Nous avions exploré la force visuelle, la force sonore et la force de transgression. Au journaliste condescendant qui l’interrogeait, une petite fille répondit : « Non Monsieur, la poésie ce n’est pas les rimes. C’est quand il y a des mots et qu’on lève les yeux en disant « Ah oui ! » » Cette définition naïve a continué de cheminer en moi et de s’enrichir en croisant les aphorismes de Char, le « couteau sans lame auquel manque le manche » de Lichtenberg, et pas mal de pages de Bachelard, de Reverdy… Elle résume bien ce que j’ai vécu en lisant Somnambule du jour car je n’ai pas cessé d’avoir de brusques renversements de la tête traduisant mon besoin de regarder vers ce qui n’était plus le plafond mais un espace mental où la charge poétique pouvait éclater et se propager.
SOUS LE LIT
« Je serai seule
à mourir
avec sous le lit
mes soulier déroutés »
10 Anise Koltz sort grandie de la comparaison avec le voisinage hors norme que lui impose son entrée dans la collection « Poésie/Gallimard ». Car, avec ses plus de 500 titres, cette collection qui rassemble, notamment, les chefs-d’œuvre de la poésie de langue française est un panthéon où apparaissent vite les dieux secondaires. Être choisi apporte une reconnaissance éditoriale sans équivalent au poète – élu – mais le pousse en première ligne. L’expose. Le met face à des lecteurs qui ne jugent plus en fonction de l’actualité mais dans l’absolu. Il faut que le livre distingué par un directeur de collection averti, sorti de la pénombre, soutienne la comparaison avec des œuvres abouties, indépassables, et se distingue par ses qualités propres. Il faut qu’il ne ressemble pas. Il faut qu’il apporte. Il faut qu’il provoque des « Ah oui ! » et fasse se lever les yeux de l’être. Somnambule du jour satisfait pleinement à ces exigences. Pour peu que les nihilismes dans leurs différentes versions, économiques, religieuses, politiques, technologiques, soient repoussés, c’est là qu’Anise Koltz a rendez-vous avec ses futurs lecteurs. Ceux qui refuseront que l’on condamne l’art à se soumettre à la mimèsis et à reproduire les conditions de son inféodation. Ceux qui continueront, selon les mots de Ricœur, d’avoir l’ambition « de restructurer les représentations de l’univers ».
« …des impulsions ou percées du subconscient venant du fond des âges fusionnent avec le conscient. Elles confèrent au poème des perspectives inattendues, ouvrant des possibilités de transgression aux sens et à l’esprit. Le poète s’abandonnant à ses forces créatrices peut redécouvrir ses racines profondément enfouies qui le relient au grand TOUT. Le poème pourra donc contenir une projection d’une réalité qui n’existe pas encore et qui n’existera peut-être jamais ; dans notre monde intérieur, nous sommes libres. Il n’y a ni contrainte ni obstacles. Notre poème peut donc se situer avant notre naissance comme après notre mort. »
-
Récemment, à l’université de Strasbourg.
-
Essentiellement aux éditions Phi au Luxembourg et Arfuyen en France. Anise Koltz a d’abord écrit en allemand. Son mari étant mort prématurément suite aux tortures que lui infligèrent les nazis, elle a décidé au début des années 1980 d’abandonner la langue des bourreaux.
-
Avec son mari, René Koltz, elle a notamment animé les Biennales de Mondorf, qui avaient pour ambition la construction d’une société multiculturelle.