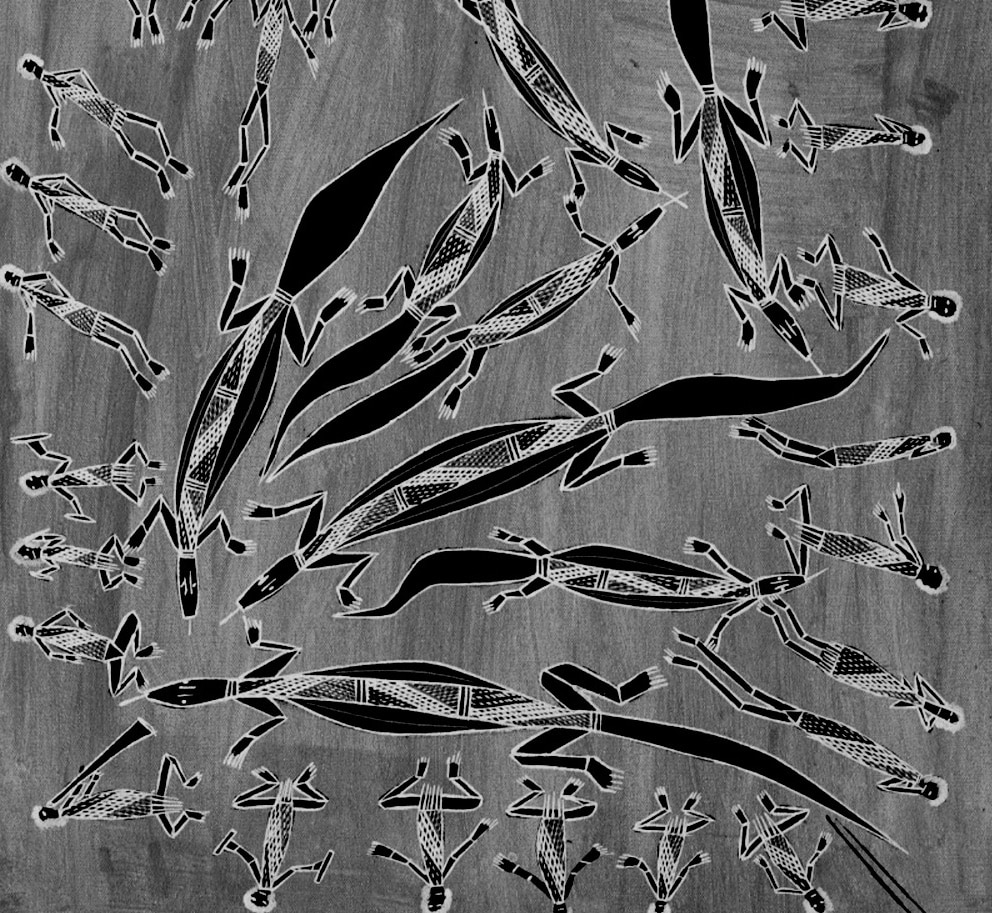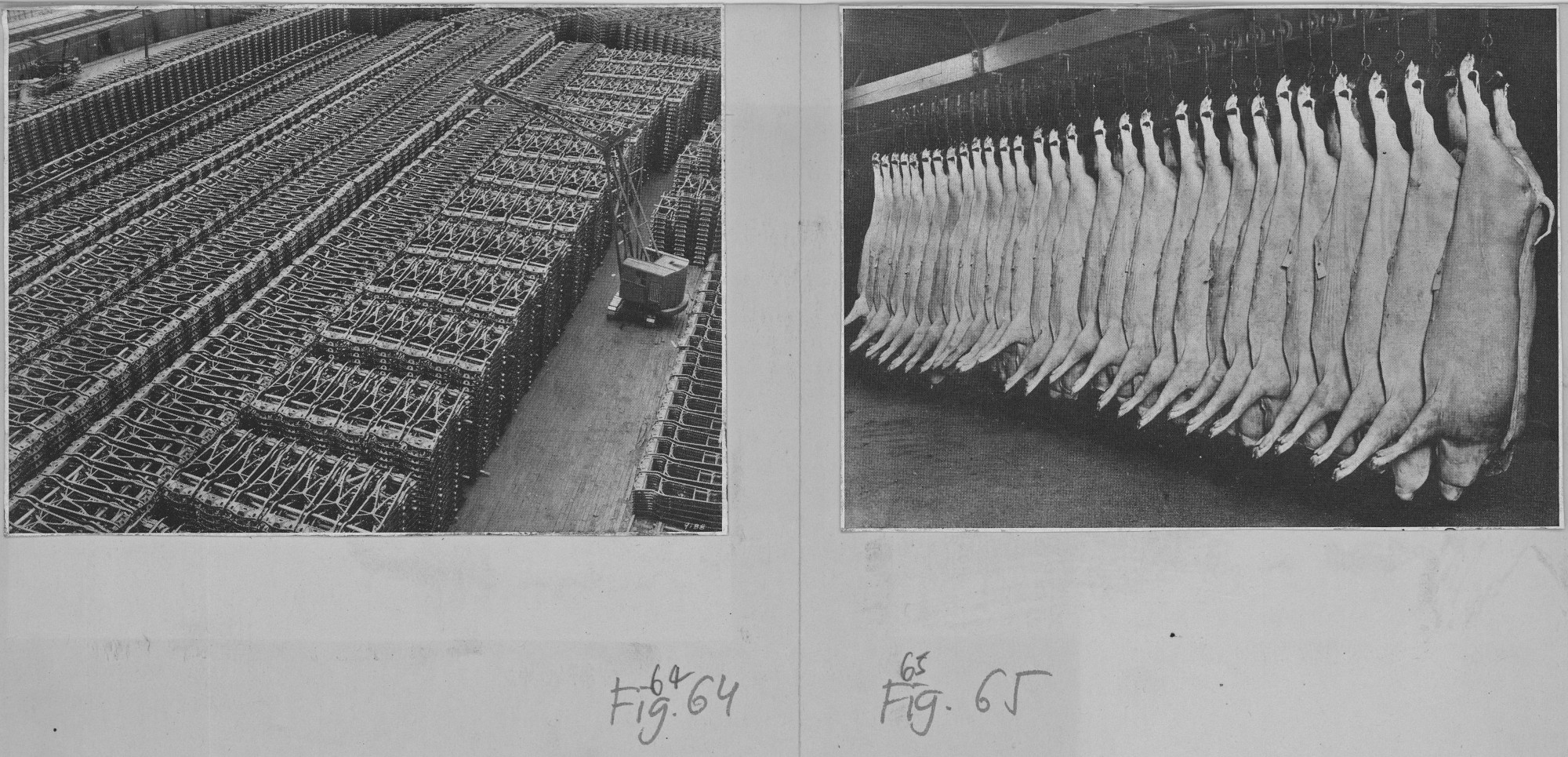Le réel, on l’embrasse, on lui résiste, on s’en évade ou on le reçoit en pleine figure. Mais que devient-il quand on essaie de le transformer par les technologies numériques ? Gérald Bronner s’attache à décrire les dérégulations que celles-ci produisent quand elles rencontrent notre tendance à prendre nos désirs pour des réalités. Mais son anthropologie et sa sociologie manquent elles-mêmes de sens du réel.
Dans de nombreux travaux, Gérald Bronner a entrepris de montrer quelles transformations les technologies du numérique imposent à nos croyances et à nos habitudes mentales. Il poursuit ici cette enquête en s’intéressant aux multiples manières dont les humains, principalement dans nos sociétés contemporaines d’information, partent « à l’assaut du réel ». Par quoi il ne désigne pas seulement les manières dont on invente des mondes imaginaires par la fiction et les œuvres d’art, mais aussi les tentatives de plier le monde à nos désirs, au risque de l’abolir complètement.
Toute son enquête repose sur une thèse anthropologique de base : les humains ont une tendance irrépressible, inscrite dans leur biologie et leur équipement cognitif, à prendre leurs désirs pour des réalités, tels des enfants impatients de saisir tous les objets qui les entourent. Comme le monde ne s’y prête pas toujours, et qu’il faut aussi explorer l’espace des possibles pour agir, ils essaient de changer l’ordre du monde plutôt que leurs désirs et adoptent des comportements magiques. Nous sommes, nous dit Bronner, des « singes magiciens ».
Il nous rappelle, à partir des travaux de psychologie cognitive qui ont depuis plusieurs décennies répertorié les jugements irrationnels et les décisions absurdes, comment nous sommes victimes de biais (comme celui de confirmation), comment nous évaluons faussement les probabilités des événements et avons l’illusion de les contrôler ou de pouvoir influer même sur le passé. Il voit la traduction de cette « pensée désirante » dans des phénomènes sociaux comme celui qui entendait porter en 1968 « l’imagination au pouvoir », comme les modes de l’éducation positive et du développement personnel, ou comme celle de la recherche du bonheur à tout prix, qui ne peuvent produire que des frustrations, selon le fameux paradoxe de Tocqueville : plus les inégalités diminuent, plus elles paraissent intolérables, plus le niveau de vie augmente, moins on se dit heureux, qui illustre, selon Bronner, « l’effet Tantale », qu’il aurait pu nommer « effet Polyeucte » : le désir s’accroît quand l’effet se recule.
Dans la deuxième partie de son livre, Bronner fait défiler tout un carnaval de freaks, dignes d’un cirque Barnum contemporain, qui cherchent à contourner et souvent à s’approprier le réel par des stratagèmes de plus en plus en plus sophistiqués quand la réalité résiste aux désirs : les hikikomori japonais qui s’enferment pour ne pas affronter le réel, leurs équivalents italiens (bamboccioni) ou français (les « Tanguy »), les shifters qui pensent, par des techniques apparentées à l’hypnose, changer de réalité en se projetant dans des mondes virtuels, les adeptes du « metavers » qui proposent la même chose, via les services de Mark Zuckerberg, les constructeurs de mondes imaginaires ou impossibles (rencontrer des morts, se marier avec une poupée gonflable, une table, ou avec son Doppelgänger).
Ici les limites entre la pensée désirante et la pensée délirante s’effacent. Dans la dernière partie du livre, Bronner étend son diagnostic à ce qu’il appelle les « ductilisateurs du réel », qui le corrompent par des théories fumeuses visant à montrer que la réalité n’existe pas : on soutient, comme les postmodernes, qu’elle est « construite », ou il se présente des campagnes prêtes à créer, comme les partisans de Trump, des « faits alternatifs », ou, chez ses adversaires wokes, à proposer des programmes de cancel culture de manière à gommer les réalités désagréables et à raconter l’histoire et la société autrement. Il y a là toute une culture et une économie, avec ses héros, ses entrepreneurs et ses martyrs, qui rappelle le mouvement spiritiste. À cette nuance près qu’au lieu de faire tourner les tables, ce sont les technologies de l’internet qui servent à conquérir le virtuel, et qu’elles sont bien plus inquiétantes que des folies douces nourries à la méthode Coué. Les tentatives pour réduire le monde au virtuel et les projets des transhumanistes nous replacent devant le choix de Winston dans 1984 : croire que deux et deux font cinq ou subir d’atroces tortures.

Le style de Gérald Bronner est pétulant, truffé d’anecdotes tirées de la psychologie et de la littérature, sur lesquelles il s’étend souvent au détriment de l’explication, et un peu trop porté sur l’autopromotion et l’ego-sociologie. Son hypothèse de base – notre pensée est gouvernée par le wishful thinking – a le mérite de la simplicité, mais elle prouve trop et pas assez. Elle prouve trop parce que, si un certain nombre de comportements peuvent s’expliquer par la tendance humaine à prendre ses désirs pour des réalités, il est loin d’être évident que ce soit la source de toute la pensée humaine et que cela explique, comme il le suggère, toutes les formes d’enchantement du monde. Bronner étend bien trop la catégorie de magie. Curieusement, s’il cite des anthropologues comme Malinowski, il ne discute pas la théorie de la magie de Marcel Mauss. Or ce dernier montre qu’elle opère dans des conditions particulières, avec des rituels et des contextes sociaux spécifiques.
Mais où sont donc les contextes sociaux et les rituels dans les analyses du sociologue Bronner ? Mauss lui-même mettait en garde contre l’idée que la magie est la forme première de la pensée humaine. Comment d’autres formes de pensée ont-elles pu se former si c’est la pensée désirante qui domine nécessairement ?Les humains n’ont-ils pas aussi des facultés cognitives? Si ces facultés cognitives coexistent avec le wishful thinking comment cela se produit-il ? La technologie, c’est le mana, la force qui rend les choses efficaces, mais il faut plus pour cela que le fait de prendre ses désirs pour des réalités.
L’idée que les humains croient ce qu’ils veulent bien croire ne prouve pas assez. On n’a pas attendu la psychologie cognitive pour s’en rendre compte, car, disait le poète : « Le malheureux donne facile créance à ce qu’il veut » (Arioste, Orlando furioso I. 56), et la littérature romantique et surréaliste n’a pas cessé de célébrer l’intrusion du rêve dans la vie réelle. Freud soutenait que le rêve est la réalisation d’un désir. Mais comment la croyance motivée opère-t-elle chez des individus ordinaires, qui ne sont pas nécessairement des poètes, des rêveurs ou des manipulateurs du réel ? Les sujets sautent-ils directement, tout comme Roland, à la croyance conforme à leurs désirs ou font-ils des raisonnements pratiques en vertu desquels ils concluent qu’ils ont avantage à acquérir cette croyance ? Ne balancent-ils pas entre plusieurs options, et n’éprouvent-ils pas des résistances à la force de leur désir ?
Bronner décrit nombre de cas comme si les agents, guidés par les technologies numériques, plongeaient spontanément dans leurs illusions. Mais il semble ignorer une distinction classique entre le wishful thinking et la self-deception (duperie de soi). Dans le premier, le désir (par exemple d’être aimé) produit directement la croyance correspondante (qu’on est aimé). Dans le second, la croyance (par exemple que ma femme me trompe) conduit, avec le désir (qu’elle ne me trompe pas), à la croyance qu’elle ne me trompe pas. Le cheminement est plus complexe, et suppose de la part du sujet une réflexion dynamique sur sa croyance. La distinction est bien analysée par Donald Davidson (Paradoxes de l’irrationalité) et Jon Elster (L’irrationalité) mais Bronner semble supposer que ces deux formes d’irrationalité sont les mêmes [1].
Alors qu’il avait consacré plusieurs ouvrages à ce sujet, il ne discute pas dans ce livre la notion de rationalité. Il regroupe ici sous le même chef toutes les dérogations au réel. Mais ce n’est pas la même chose de se livrer à une technologie qui vous entraîne hors du réel et de s’aveugler volontairement malgré la conscience que l’on prend de la résistance de ce réel. Et pourtant certains des cas qu’il décrit semblent bien relever de la duperie de soi plutôt que du wishful thinking. Il s’en approche quand il discute le double bind et les conduites dépressives, mais ne va pas plus loin. La conception que Bronner a de la pensée irrationnelle désirante est qu’elle prend possession entièrement des esprits, comme une sorcellerie. Les moi de ses sujets semblent ne pas être divisés. La plupart sont décrits comme succombant à un biais ou à un « effet » qui fonctionne comme une loi causale. Leur irrationalité est mécanique. Sans nier l’existence des cas qu’il rapporte, on aimerait une psychologie moins élémentaire. Il semble surtout que les assaillants du réel de Bronner soient aussi des entrepreneurs, qui ne perdent pas le nord, et qui savent gérer leurs comptes en banque.

Quand les protagonistes de ses récits montent à l’assaut du réel, de quel réel s’agit-il ? De celui que leurs désirs créent, qui n’a rien de réel, ou de celui qui résiste à ces désirs, lequel est on ne peut plus réel ? Seulement voilà : Bronner refuse de définir le « réel » : trop compliqué, trop vaste, nous dit-il, avec le culot du sociologue sûr de lui, laissant la question aux spéculations fumeuses des philosophes. Mais la philosophie se venge, notamment quand il prétend décrire un mouvement différent de celui qu’on a appelé la « post-vérité », qu’il nomme « post-post-vérité » et « post-réalité ». On mécomprend, nous dit-il, l’ère Trump et le rapport à la vérité qu’elle introduit quand on dit qu’elle consacre l’« indifférence à la vérité » et un « nouveau régime épistémique », car Trump comme ses partisans sont en fait parfaitement conscients de la vérité, et savent bien qu’il ment : le discours hyperbolique qu’ils utilisent n’est qu’un signe de connivence pour s’autoriser à corrompre le réel. Mais c’est parfaitement compatible avec une indifférence générale vis-à-vis de la vérité comme valeur.
Bronner confond ici deux sens de « indifférence au vrai » : non-reconnaissance de la différence entre le vrai et le faux et refus de tenir le vrai pour une valeur. Bronner néglige la distinction élémentaire entre la vérité comme propriété des énoncés ou des croyances, le concept de vérité, et la valeur qu’on donne au vrai et à sa recherche. Ce qui est en cause dans le complexe de phénomènes qu’on appelle « post-vérité », et particulièrement dans l’exploitation médiatico-politique qu’en font Trump et son public, c’est la valeur du vrai. Comme l’a bien montré Harry Frankfurt (On Bullshit, 1982), la foutaise ambiante tient à l’indifférence à la vérité comme valeur. Trump n’a pas inventé l’ère de la post-vérité, mais il en a exploité les possibilités, aidé en cela par un nouveau régime médiatique.
Bronner a parfaitement raison de voir dans le succès du constructionnisme et du relativisme post-modernes le couronnement contemporain de cette déréalisation du réel que consacre l’ère technologique et digitale, et il a des analyses très justes des contradictions dans lesquelles s’enferrent ceux qui veulent « ductiliser » le réel pour le conformer à leurs désirs (notamment celui de préserver leurs identités). Mais je ne vois pas en quoi cela autorise à parler de « post-réalité » : on prend des vessies pour des lanternes ou on essaie de créer des mondes virtuels, mais la réalité est toujours là, comme la vérité. Aristote ne disait-il pas : « Ce n’est pas parce que nous pensons d’une manière vraie que tu es blanc que tu es blanc, mais parce que tu es blanc qu’en disant que tu l’es nous disons vrai » (Métaphysique Θ1051 b6) ?
Bronner fait ici curieusement la même erreur que celle qu’il reproche aux relativistes : ce n’est pas parce que ceux qui inventent des réalités « alternatives » tendent à les prendre pour la réalité qu’elles deviennent des réalités, et ce n’est pas parce qu’ils inventent de fausses réalités que la réalité devient post-réalité. Je vois encore moins en quoi le scepticisme radical que Bronner attribue à Descartes (!) et celui qu’il prête à l’idéalisme philosophique d’un Berkeley (esse est percipi) seraient des manifestations de la « pensée désirante ». Selon lui, ce sont de simples « curiosités intellectuelles », qui ne posent que de manière très indirecte le vrai problème, celui de savoir si nous vivons ou non dans « la Matrice ». On se frotte les yeux à lire ça. Je crois au contraire que personne n’a mieux posé la question de la nature du réel que George Berkeley.
Les phénomènes que décrit Bronner ne sont pas des fictions, et ils font froid dans le dos. Il parvient quelquefois à déployer une galerie de grotesques digne de romans catastrophistes comme L’inassouvissement de Witkiewicz (1930), et ses personnages semblent eux aussi avoir avalé la pilule Murti-Bing qui permet d’échapper à la réalité. Mais ce n’est pas avec les pilules du rationalisme simpliste de Gérald Bronner qu’on en guérira.
[1] Voir aussi Vasco Correia, La duperie de soi, Éditions universitaires, 2008 et https://encyclo-philo.fr/duperie-de-soi-a.