Le mouvement Tea Party, l’élection de Donald Trump et les manifestations violentes de Charlottesville en 2017 ont mis en avant l’« alt-right » américaine. Mais cette droite « alternative » n’est pas seulement américaine. Elle étend ses ramifications dans le monde entier. Philippe-Joseph Salazar, qui a jadis étudié en rhétoricien les discours des jihadistes, a repris ses enquêtes pour donner, à travers les portraits de quelques-uns des principaux idéologues de ce courant, une analyse qui se révèle, à la lumière de l’assaut récent contre le Capitole, bien prémonitoire.
Philippe-Joseph Salazar, Suprémacistes. L’enquête mondiale chez les gourous de la droite identitaire. Plon, 304 p., 21 €
On aimerait, au moment où le président Trump et son écœurant sillage s’apprêtent à quitter la Maison-Blanche, que ce livre soit une nécrologie de l’alt-right. Mais il est au contraire la préfiguration de ce qui nous attend. Philippe-Joseph Salazar est rhétoricien, philosophe et historien. Professeur à la faculté de droit de l’université du Cap, il a écrit sur les questions raciales depuis la fin des années 1980, et participé à la commission sud-africaine Vérité et réconciliation (dont il a tiré, avec Barbara Cassin et Olivier Cayla, Dire la vérité, faire la réconciliation, manquer la réparation, Seuil, 2004). Nombre de ses travaux portent sur la parole politique, et sont, selon ses termes, des « enquêtes critiques sur les opinions qui ont du pouvoir par le seul fait qu’on les dise et qui se solidifient en une idéologie ». Son ouvrage Paroles armées (Lemieux, 2015) analysait la rhétorique de la terreur des jihadistes. En une enquête de trois ans, à travers une série d’entretiens avec des leaders de la droite « alternative », il nous donne aujourd’hui un portrait ironique et glaçant.
L’alt-right est encombrée de clichés : ses tenants seraient des néonazis, des conservateurs et des néo-conservateurs, des antisémites, des racistes, des terroristes, des identitaires, et toute la panoplie du fascisme. Que des courants comme le Tea Party, les partisans les plus radicaux de Trump, l’extrême droite européenne, du Rassemblement national français et de la droite autrichienne à certains mouvements populistes, combinent toutes ces caractéristiques, ou en illustrent certaines, n’est pas niable. Le monde des idéologies politiques est une vaste volière, où s’ébattent méchamment les oiseaux. Certains sont purement légendaires, ou ont disparu, comme les ptérodactyles ou les dodos, d’autres n’existent, comme les dahus, que par ce qu’on en dit ou par les insultes qu’on leur envoie. Mais beaucoup d’autres sont bien réels, qui font l’objet de ce livre.
Philippe-Joseph Salazar a mené son enquête pendant trois ans. Il commence par rendre visite à l’une des icônes de la sanglante marche aux flambeaux de Charlottesville et animateur du mouvement Identity Evropa, Peter Cvjetanovic, qui fit la une des journaux à l’époque. Vêtu BCBG, il dit n’avoir rien d’un néonazi, car il ne voulait que célébrer le général Lee. On rencontre un autre membre du même mouvement, Matt, expert en campagnes Internet. Trump déclara à leur sujet après les émeutes : « Il y a des gens bien des deux côtés ».
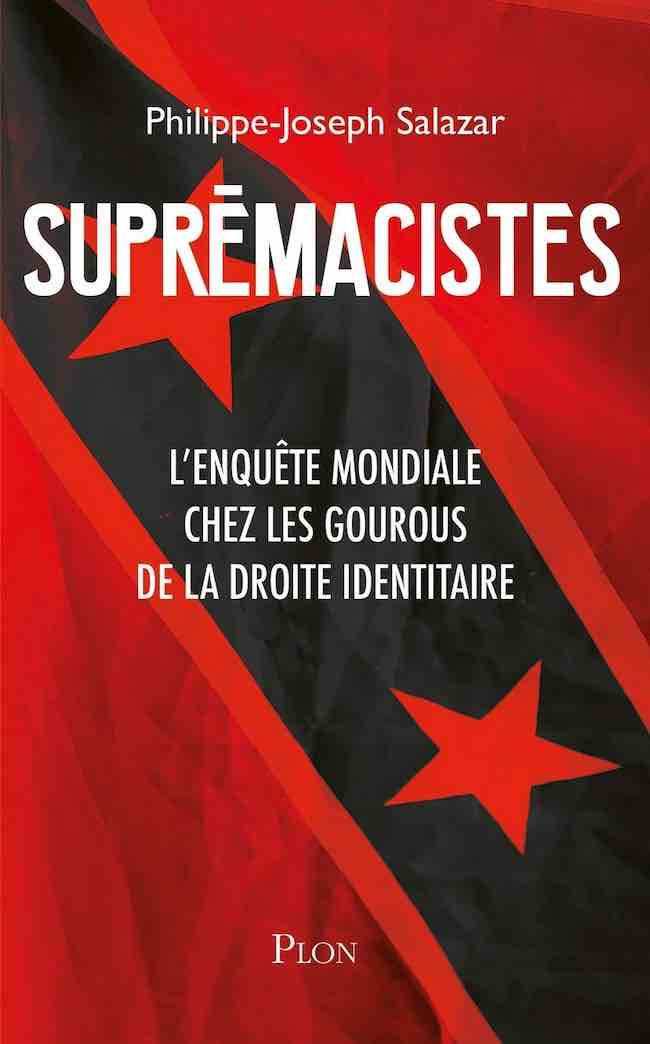
Notre enquêteur, après s’être mis dans l’ambiance en visitant le musée de la National Rifle Association dans l’Indiana, rend ensuite visite à Jared Taylor, auteur de White Identity (2011), un homme cultivé qui se présente lui-même comme un « dissident » de l’alt-right, mais dont le credo semble assez conforme : « Ma race est ma famille, et tout le monde, gauche ou droite, libertaires, gays, pauvres et riches font partie de ma famille. » On rencontre ensuite un mathématicien amateur de kung-fu, John Derbyshire, auteur à succès de We Are Doomed : Reclaiming Conservative Pessimism, Random House, 2009), littéralement : « On est fichus » (nous les Blancs). Traversant l’Atlantique, Philippe-Joseph Salazar s’en va chez un théoricien de la droite identitaire autrichienne, le Viennois Martin Lichtmesz, qui édite un journal portant le même nom que le courant artistique autrichien Sezession, mais qui prône le Heimat blanc et influence PEGIDA en Allemagne. Qu’aurait pensé le juif viennois et anti-nazi Karl Kraus de ce détournement ? Et qu’aurait pensé Kant de sa soi-disant disciple droitière Caroline Sommerfeld, qui recycle l’impératif catégorique dans le contexte d’une idéologie völkisch ?
La boussole de l’enquêteur le fait ensuite aller vers la Scandinavie, vers Copenhague, pour une réunion du Scandza Forum, où il rencontre deux personnalités de l’alt-right internationale, l’Américain Greg Johnson, auteur du White Nationalist Manifesto en 2019, puis le Croate Tomislav Sunić. Son périple continue en Irlande, où il rencontre Keith Woods, un génie du web identitaire aux lectures éclectiques (Nietzsche, Lacan, de Maistre, Ellul, Guénon). Il se termine, en France, où il rencontre François Bousquet, directeur, après Alain de Benoist, de la revue Éléments, relookée jusqu’à publier Michel Onfray, et dont la librairie est installée rue de Médicis à l’ancienne adresse de l’Action française, à côté des éditions José Corti. Aux livres de Julien Gracq se sont substitués ceux de Drieu, Morand, Chardonne ou Jünger, mais aussi de Clément Rosset, Chantal Mouffe, Julien Freund, Michel Foucault et l’inévitable Carl Schmitt. On a déjà noté l’éclectisme de la Nouvelle Droite française, difficile à comprendre pour les Anglo-Saxons. Cette droite apprécie la cinéaste Cheyenne-Marie Carron pour son film La morsure des dieux qui célèbre l’identité blanche. Mais, prudente, Carron refuse de se laisser interviewer par le chasseur de gourous. Le livre se termine, à tout seigneur tout honneur, par une entrevue avec le théoricien du « grand remplacement », Renaud Camus, qui broie du noir, tel un baron ou un chevalier d’Italo Calvino, dans son château du Gers, et y cultive un racisme racé.
Qu’y a-t-il de commun entre ces différents défenseurs de la race blanche ? On les qualifie de « suprémacistes ». Mais, à part cette proposition raciale, qui est à la fois une assertion et un idéal, ils ne partagent pas les articles de base de la vieille droite. Ils ne sont pas conservateurs au sens politique du terme, à la manière des disciples de Burke comme Roger Scruton. Ils ne sont pas nazis, au sens où ils entendraient s’appuyer sur une politique d’extermination raciale. Ils ne sont pas explicitement antisémites, même s’ils trouvent les juifs « sur-représentés ». Ils n’ont pas – au moins pas pour le moment – le projet de fonder un parti politique, ni de mener des actions terroristes. Enfin, leur champ d’action est inséparable, tout comme le succès de Trump, de la montée en puissance des GAFA et des réseaux sociaux.
Selon Philippe Salazar, l’idéologie suprémaciste qui est en train de se cristalliser est bien distincte des mouvements fascistes du passé, axés sur la classe ou la nation autant que sur la race. Mais cette thèse n’est qu’à demi convaincante. Certes, les leaders ici interviewés prennent soin de se démarquer des formes historiques du racisme blanc, et ils n’éprouvent aucun désir de s’appuyer sur Mein Kampf. Mais ils vénèrent Nietzsche, Evola, Céline, ou Renaud Camus. Ils n’achètent pas de colifichets néonazis ni ne jouent aux fachos que les « antifa » aiment à voir en eux. Pourtant, quand ils retrouvent les thèmes du paganisme anti-chrétien ils ne sont pas loin d’un locus communis nazi ni des théoriciens du GRECE, Alain de Benoist, Guillaume Faye, ou Louis Rougier. Ils ne sont pas racistes au sens où ils croiraient à la race au sens biologique, car ils insistent plus, même quand ils sont américains, sur l’identité européenne et culturelle (et non pas indo-européenne) des Blancs. Mais cela ne les empêche pas de ressasser les thèmes racistes ordinaires, ou de lire The Bell Curve (1994), célèbre ouvrage de Richard Herrnstein et Charles Murray prétendant montrer l’infériorité intellectuelle des Noirs sur des bases génétiques (ses confusions ont été montrées par Ned Block, « How heritability misleads about race », Cognition, 1995).
La thèse de Philippe-Joseph Salazar est que les suprémacistes forment une « internationale blanche » qui se décline, comme le montre son enquête, sur des modes assez différents selon les pays (en ce sens, la nation n’a pas disparu), mais qui, du fait des réseaux sociaux qui leur offrent les coudées franches, promet de se répandre au niveau global et d’allumer toutes sortes de barils de poudre. L’épisode Trump, les tueries d’Utoya et de Christchurch, les divers populismes européens et, last but not least, l’assaut du Capitole donnent beaucoup de plausibilité à cette thèse. Si Philippe Salazar a raison, le diagnostic d’auteurs comme Jason Stanley, qui a vu dans la présidence de Trump la renaissance du fascisme des années 1930 (How Fascism Works, Random House, 2018), est obsolète. Mais, à part le fait que le livre de Stanley est d’une grande naïveté sur le plan historique (on lui préfèrera celui dirigé par Cass Sunstein, Can It Happen Here? Authoritarianism in America, Harper Collins, 2017), les idéologues alt-droitiers livrent-ils vraiment une version alternative par rapport aux formes antérieures de fascisme ?

Atlanta (2011) © Jean-Luc Bertini
Pour répondre à cette question, sur laquelle l’article classique d’Umberto Eco reste toujours pertinent (Reconnaître le fascisme, Grasset, 2017), il aurait fallu que le livre de Philippe-Joseph Salazar répondît à deux autres. La première est, aux États-Unis, la relation de ces courants à Trump. La plupart des suprémacistes interviewés ici ne se sentent pas trumpistes, soit qu’ils trouvent le 45e président des États-Unis vulgaire et affairiste, soient qu’ils entendent se démarquer de son populisme. Trump fut pourtant pour eux une divine surprise, et la question est de savoir si leur désir utopique d’une Amérique « à 90 % » blanche peut vraiment se réaliser sans un projet politique de dictature autoritaire. Leur idéal n’est pas d’établir une république blanche au Paraguay !
La seconde question porte sur la relation de l’alt-right aux chrétiens conservateurs, surtout aux États-Unis. Officiellement, ils professent souvent le paganisme, à l’instar des nazis et des fascistes italiens. Mais beaucoup d’entre eux ont des liens avec le christianisme, et refusent, par exemple, le parti pris anticlérical et anticatholique de la Nouvelle Droite française. N’est pas païen et viking qui veut, si l’on se réclame de l’identité européenne blanche et si l’on vénère l’auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg. On me dira que la droite alternative est intellectuellement un bric-à-brac et que ses représentants ne sont pas à une contradiction près. Par exemple, quand leurs aînés américains se réunissent sous l’égide de H. L. Mencken [1] dans un Mencken Club à Baltimore, on ne sait pas si ce qu’ils vénèrent chez Mencken est sa critique de la démocratie ou sa lutte contre les fondamentalistes religieux et le Klu Klux Klan, alors même que leurs marches aux flambeaux rappellent les rituels de ce dernier.
Il fallait bien un spécialiste de rhétorique pour passer en revue ces discours, car ce qui frappe à la lecture de ces interviews, c’est l’usage maîtrisé dans leurs discours de l’euphémisme et de la litote pour couvrir leur racisme. Mais l’avènement de la cybersphère est aussi celui de la post-vérité et de la foutaise, et à lire ce livre il semble bien que l’alt-right n’y échappe pas. Une chose est sûre : à partir du moment où la race et l’identité deviennent les seuls marqueurs et les seuls repères, à droite comme à gauche, chez les fa comme chez les antifa, on est fichus, we are doomed.
La moralité de tout cela est encore aux États-Unis, dans le Sud, non pas à Charlottesville, mais à Atlanta, où l’on vient pour la première fois d’élire un sénateur noir, Raphael Warnock. Dans ce qu’elle considérait comme sa meilleure nouvelle, « The artificial Nigger », Flannery O’Connor raconte l’histoire de Mr Head et de son petit-fils Nelson, qui voyagent de leur trou campagnard de Géorgie vers la grande ville, Atlanta. Ils se perdent dans le quartier noir. Nelson a peur des « nègres » : « C’est ici qu’ t’es né ! », lui réplique son grand-père. Nelson renverse une vieille femme, qui glapit qu’elle va appeler la police. Mr Head renie son petit-fils : « C’est pas mon fils, j’l’ai jamais vu. » Ils décident de rentrer chez eux, quand ils voient dans un jardin un nègre factice « à peu près de la taille de Nelson », au regard figé et malheureux. Par l’intermédiaire de cette statue dérisoire, ils se trouvent rassemblés, et par là même les Blancs et les Noirs dans leur destinée commune, face à la Miséricorde. Cette nouvelle est l’exact contrepied du racisme sudiste blanc. Mais on pourrait parier que, si elle était connue des tenants de la woke culture, elle serait immédiatement débaptisée, tout comme Dix petits nègres d’Agatha Christie. Mais l’ironie de l’histoire est que cela a déjà eu lieu : Flannery O’Connor a été récemment accusée de racisme et une université catholique a débaptisé un dortoir à son nom.
-
Sur Mencken, je me permets de renvoyer à mon article, « Julien Benda and H. L. Mencken : a parallel », in Martin Rueff et Julien Zanetta, Hommage à Patrizia Lombardo, Université de Genève, 2017.












