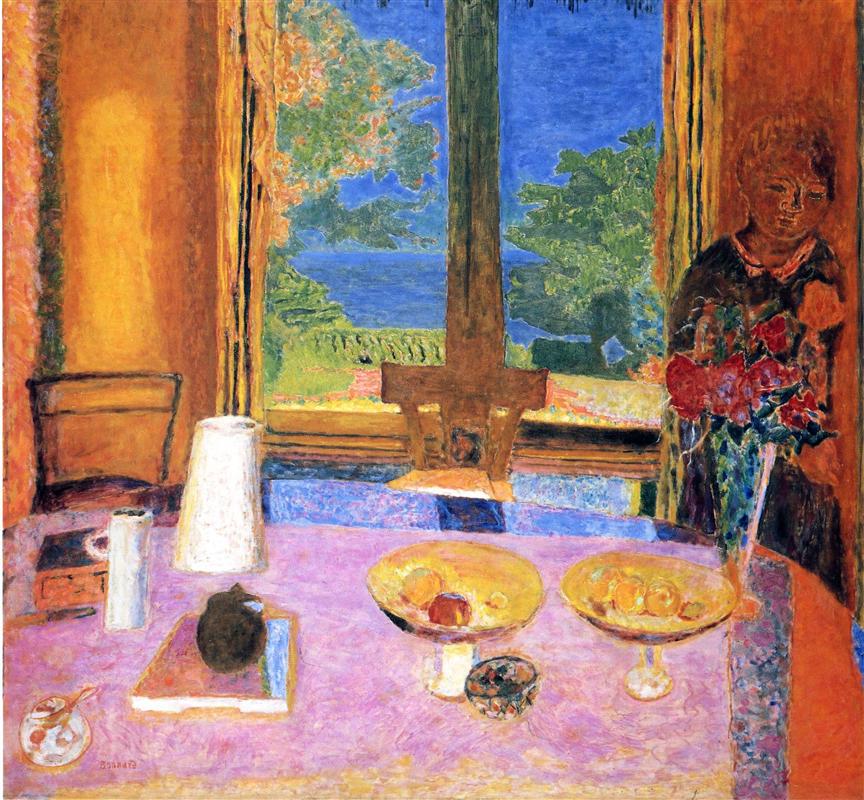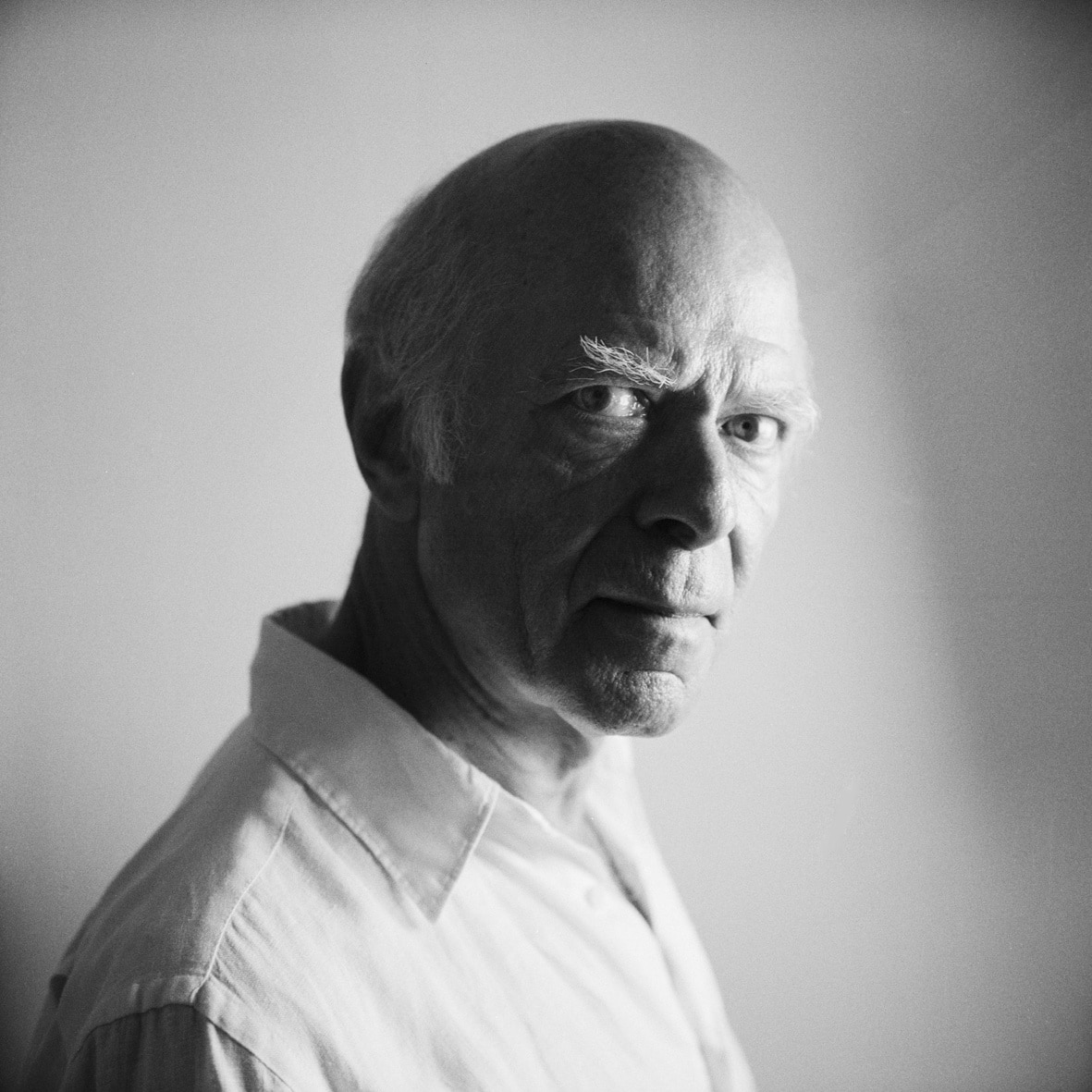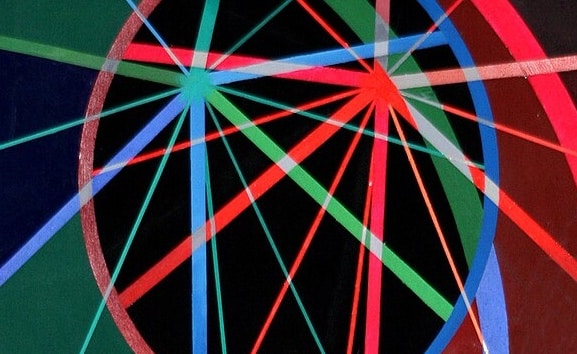« En Lorraine, une part de quiche. En Alsace, une tarte flambée », à mi-chemin entre les deux, un lotissement, une famille et un suicide. Celui d’Élizabeth Witz, une Alsacienne mariée à Éric Richard, un lorrain. Mère de trois filles qui resteront sans nom : l’étudiante, la lycéenne et l’écolière. À la fois grave et légère, Justine Arnal exhibe dans Rêve d’une pomme acide la laideur de la vie ordinaire qui met au monde des orphelins.
Albert Camus s’interrogeait sur ce qui pousse un individu à commettre « l’impensable ». De son côté, Justine Arnal refuse de gober tout rond l’expression. Son récit déplace la question, car derrière les mots d’un proche annonçant qu’Une telle a « commis l’impensable », il y a le déni, la cécité volontaire de toute une famille, plus épais qu’un brouillard lorrain. Elle met l’écriture à l’exercice pour restituer le détournement des discussions. Le brouhaha entretenu par les hommes sur le coût de la vie sature les réunions de famille, les bonnes affaires, les manques à gagner, les « couilles en or » sur lesquelles chacun glose avec sérieux. Tout ce qui permet en fin de compte de camoufler le silence d’Élizabeth Witz.
Puis la date tombe : « 22 avril lequel ? dix fois déjà 22 avril depuis 22 avril dix fois mais toujours un seul ». Le suicide de la mère surgit au milieu de la lecture. C’est l’un des passages les plus émouvants du récit. Les mots se font plus rares, épars comme si les phrases, sidérées, étaient incapables de tenir la ligne. La narration adopte le point de vue de la fille aînée, désemparée, qui confie son chagrin et ses incertitudes, loin du ton ironique des premières pages. Derrière la parole de l’étudiante, celle d’une enfant endeuillée, qui fouille sans conviction dans sa mémoire de quoi comprendre le geste de sa mère. Elle reconnaît pourtant que « tout a déjà eu lieu. Rien de nouveau n’arrivera dans ce qui aura encore lieu. Demain, dimanche ». Paradoxalement, l’ainée comprend vite que le drame, la fatalité de la mort de sa mère, n’avait en fait rien d’inévitable. Chaque membre de la famille l’a laissée disparaître tranquillement, dans l’ordinaire d’une vie bordée d’ennui. Mais tous les éléments étaient déjà là, « l’impensable » est un fruit cueilli à l’arbre du déni.
Une autre réussite de ce livre tient à ce qu’il parvient à décortiquer la période qui succède au suicide. Intégrer l’information, admettre la disparition irrémédiable, ouvrir l’enquête pour savoir pourquoi, à la recherche du moindre signal d’alarme que l’on aurait manqué. Avec plus ou moins de volonté, les trois filles, le mari, les oncles et tantes, les grands-mères prospectent dans les souvenirs encore frais, ensuite révisés, mille fois répétés, pour sentir tout ce qui aurait pu porter l’odeur de la mort. La voix de l’étudiante exprime la discordance entre les tentatives de mises en récit du suicide, de ses motifs, et l’absence de certitudes lors de la recomposition macabre des faits. « Avec quelle facilité j’affirme qu’elle était enfermée / Avec quelle arrogance ombrée d’amertume. / Puis avec quel regret cela se défait et se perd, l’illusion de / savoir ce qu’il en a été. / Pour cela il me faut céder à la vitesse aux raccourcis bredouiller balbutier bégayer / entrer dans la lenteur et les phrases en guenilles. / Les affirmations délitées, j’amasse le silence. » Les morts se font cruellement absents lorsque les vivants cherchent à établir cette vérité.

L’une des trames du roman se bâtit sur une critique de la famille. Le foyer, c’est tout ce qui compte, ou plutôt tous ceux qui comptent. Chez les Witz comme chez les Richard, « compter était le moyen par lequel se scellaient les alliances ». L’idée d’opposer les hommes qui comptent aux femmes qui pleurent donne de belles pages caustiques. Avec une ironie la plupart du temps bien dosée, on se délecte des conseils avisés de l’oncle Léon. Pour bien choisir une femme, analysez donc sa découpe de la croûte du formage. Trop loin du bord, elle est dépensière, trop près, ses poches sont pleines d’oursins. Entre les deux, glissez-lui la bague au doigt. Et à l’étudiante de se demander « pourquoi il avait épousé Joséphine, qui ne mangeait que du fromage frais et mou, sans croûte (le seul qu’elle pouvait avaler sans enfiler le sabot [titre honorifique de son dentier]) ».
Isolés dans leurs chapitres respectifs, « Les larmes » et « L’Argent », les pôles genrés de la famille bénéficieraient cependant d’une articulation plus fine dans leurs rapports. Ils virent parfois à la caricature : l’écrasante domination des hommes, la soumission des femmes, contraintes de tourner en rond avec le tambour de leur machine, sans jamais se rebeller. Certes, elles se transmettent des traumatismes et se tirent volontiers dans les pattes, mais leur résignation face au quotidien atone les pétrifie dans des profils aux traits trop épais. C’est à l’image de la mère, la seule Alsacienne qui « n’aime pas les géraniums, [car] plus ils s’épanouissent, plus ils ressemblent à des fleurs en plastique ».
Imaginez Sisyphe sous les traits d’un minuscule scarabée qui pousse sa boule dans un coin du jardin et vous aurez un aperçu d’Elizabeth Witz. Ce jardin, qui ouvre et ferme le roman, annonce la fin de la mère et la fin de l’enfance. Dans la cuisine, la fenêtre donne sur le pommier, la balançoire, le bac à sable bleu en forme de coquille, puis l’œil de la mère percute la palissade des voisins, « le périmètre délimitant le paysage de la femme face à son évier ». À contrecœur, elle se prêtait à l’exercice de Perec, une fois son horizon épuisé, il n’y avait plus qu’à arrêter l’histoire. À la fin du livre, le jardin réunit pour la première fois du récit les trois sœurs. Justine Arnal fait de cet espace l’ultime scène d’une pièce de théâtre. Aussi accablante que magnifique, la durée y est suspendue. On assiste alors, selon les trois unités de lieu, de temps et d’action, au crépuscule de l’enfance.
Comme dans un tableau de De Chirico, dans le jardin désertique circule le silence autour de silhouettes figées. L’étudiante, la lycéenne et l’écolière se rejoignent dans ce dernier chapitre, une scène que l’on pense observer depuis la fenêtre de la cuisine. La parole se glisse enfin entre elles, les trois sœurs qu’aucun dialogue n’a liées depuis le début du récit. La narration externe ne laisse apparaître aucune possibilité d’accès à leurs pensées. On n’entendra, les sœurs n’entendront que ce qu’elles s’autorisent à dire tout haut. Les trois voix, en de brefs échanges, forment un faisceau polyphonique, chaotique, d’où sourdent les derniers sons de l’enfance. On la sent forte, l’influence de Marguerite Duras, citée en tête du chapitre, pour qui l’écriture colmate la vie ordinaire : « c’était dans les états d’absence que l’écrit s’engouffrait pour ne remplacer rien de ce qui avait été vécu ou supposé l’avoir été, mais pour en consigner le désert par lui laissé ».
Au comble de l’ironie, le chapitre s’intitule « Jezt get los », que l’on peut peut traduire par « En avant maintenant ». Tout·e Alsacien·ne y entend aussi la devise du Racing Club de Strasbourg et la musique incontournable de toute fin de soirée « picon bière ». Pour les trois sœurs, aller de l’avant commence par quitter le jardin, qui se pétrifie déjà sous leurs yeux lorsque l’écolière ramasse une pomme et croque dans du plastique. Le soleil est déjà bas, au deuil de la mère s’ajoute celui de l’enfance. Une voix venue d’ailleurs, rugissante, sort de la bouche de l’ainée : « Je suis la jambe prisonnière du sexe mort de la jument ». Tout aura été dit entre les filles, l’ouverture totale et la fermeture du dialogue dans la même scène. La nuit tombe, le décor disparaît et avec lui les trois sœurs. C’était Juste la fin de l’enfance, nous dirait Jean-Luc Lagarce.
Le charme de Rêve d’une pomme acide, sa vocation enchanteresse, doit aussi à l’alsacien. La présence du dialecte dans le récit donne une bouffée de légèreté bienvenue. Alors on blasphème à coup de « Verdammi » (qu’on me damne) puis on se rattrape en surenchérissant par un « Verdannewald » (forêt de sapin), histoire d’être dans les clous pour respecter la croix. Le dialecte transporte l’imaginaire du pays, donne sa verve au récit. Dans son travail d’écriture, Justine Arnal explique qu’elle s’intéresse aux langues qui nous habitent. Les personnages de son livre cohabitent sans rechigner avec leur dialecte. Ils parlent en se reposant sur les images souvent absurdes, exagérées et très prosaïques des expressions alsaciennes. Aussi interprètent-ils leur quotidien à travers le monde fantastique du bassin rhénan qui fascinait Apollinaire. Le roman se clôt sur une comptine alsacienne qu’aucune des filles ne comprend. Peut-être est-ce un pansement pour traverser les deuils de la mère et de l’enfance : « Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Aucune des trois sœurs ne le sait. Mais cette langue-là se dit en elles. »