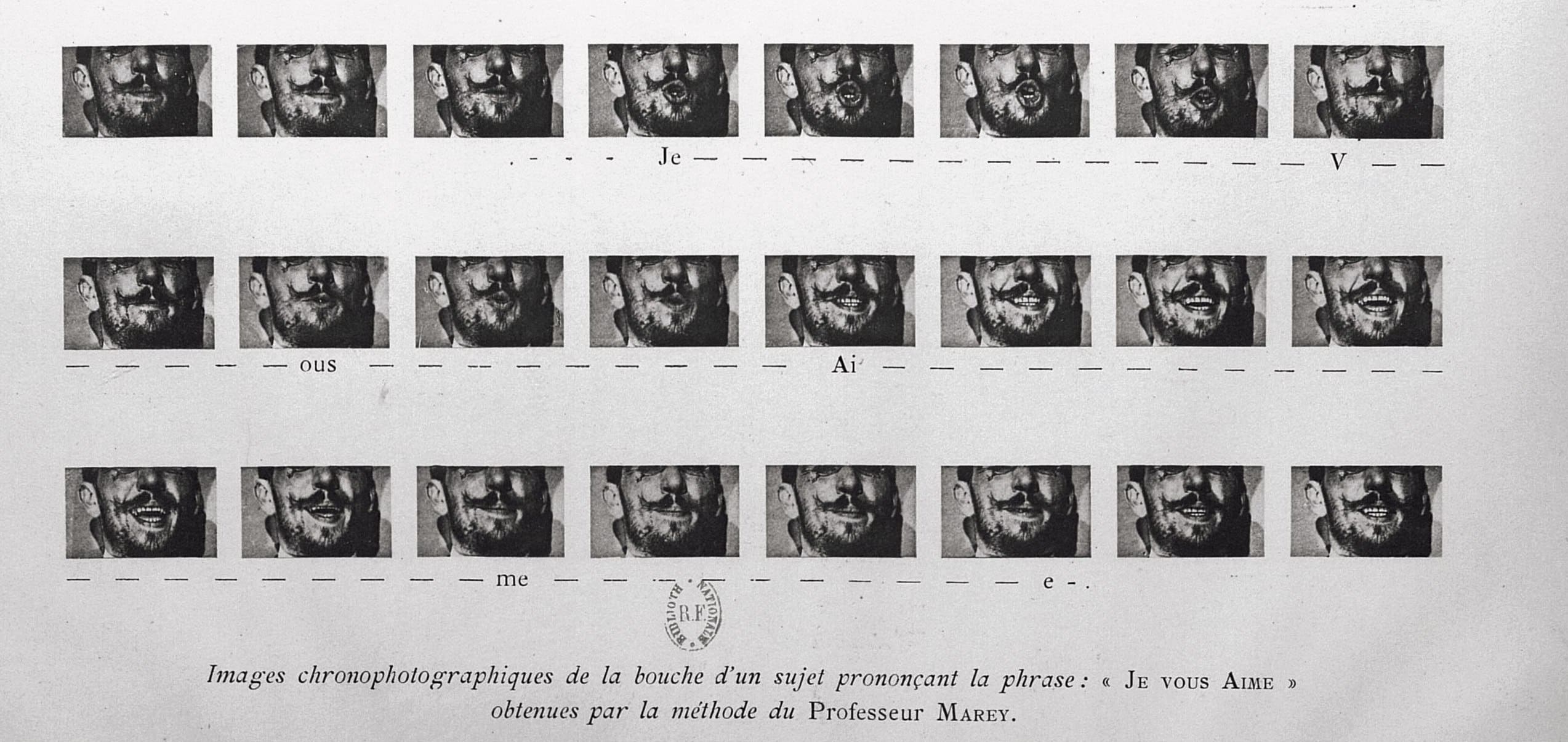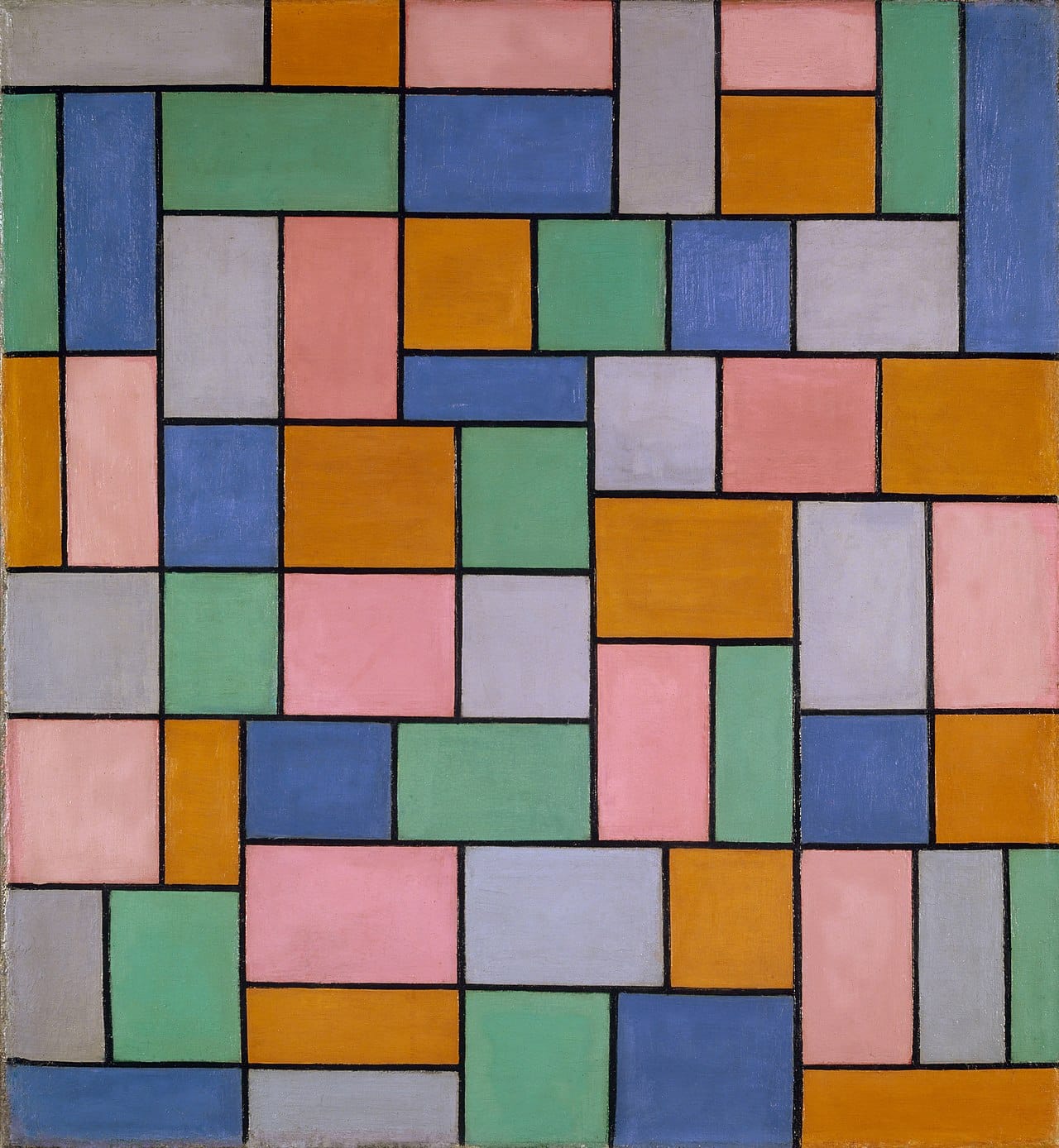« Il n’est pas rare qu’on me demande si je comprends le yiddish et si je cuisine la carpe farcie », ironise Sonia Dayan-Herzbrun, avec ce mélange d’humour mordant et d’esprit critique qui colore son magnifique essai autobiographique, Rien qu’une vie. La professeure émérite en sociologie politique et en études féministes à l’université de Paris-Cité (et membre du comité de rédaction d’EaN) raconte les innombrables combats, intellectuels, politiques et personnels, par lesquels se sont forgées une pensée et une trajectoire singulières et inventives, irréductibles à tous les stéréotypes et cadrages attendus. Petite fille, c’est l’allemand et le hongrois et non pas le yiddish qu’elle entendait parler à la maison, car telles étaient les langues parlées par les familles juives de l’Empire austro-hongrois d’où étaient originaires ses parents. Quant à la carpe farcie, elle confesse ne l’avoir goûtée « que comme un mets exotique, chez les Goldenberg, rue des Rosiers » où elle allait parfois avec ses parents.
Sonia Dayan-Herzbrun, Rien qu’une vie. Préface de Souleymane Bachir Diagne. Maisonneuve et Larose/Hémisphères, 270 p., 18 €
La succession de combats, de rencontres, de transformations et d’accomplissements que relate le livre semble en décalage avec l’humilité et la générosité teintées d’autodérision qu’exprime le titre. Rien qu’une vie est moins un témoignage qui devrait servir de modèle édifiant qu’une prise de parole offrant aux lecteurs et lectrices une série d’indices pour éclairer et encourager leur propre quête. Ce récit d’une enfance passée dans les Cévennes, où la famille a vécue cachée pendant la Seconde Guerre mondiale, suivie de l’installation familiale à Paris dans l’appartement de l’avenue Beaumarchais et de la découverte des plaisirs de la capitale, ce récit des engagements politiques, de la carrière académique de Nanterre à Jussieu, des multiples visages de la lutte féministe, fait apparaître une vie mue par la passion d’apprendre et d’être libre.
Le livre évoque le récit des péripéties de Jakob Frank, ce juif hérétique qui se convertit à l’islam puis au christianisme, et qui traversa toute l’Europe des Lumières en luttant pour la liberté et l’égalité. Le récit formidable qu’a fait Olga Tocarczuk de ce personnage mêle les tragédies historiques les plus cruelles aux plaisirs de la vie quotidienne (la famille, la cuisine, la culture). De façon analogue, Rien qu’une vie tisse ensemble le récit poignant des souffrances et blessures d’une femme chercheuse en butte au patriarcat et au machisme du monde académique, d’une épouse aux prises avec un époux jaloux, et d’une mère ayant perdu deux de ses fils, et les traits d’humour, les souvenirs du plaisir immense des sorties culturelles avec le père tant aimé, et le récit des rencontres amoureuses et amicales. Dans les deux ouvrages, l’unité naît du tissage de formes et d’expériences contingentes, et souvent vécues comme inachevées. « Aujourd’hui je vois enfin l’unité de ce que j’ai entrepris et à quoi je m’active encore, comme si l’entrecroisement de tous ces fils laissait apparaître le dessin d’un tapis », écrit Sonia Dayan-Herzbrun. La recherche de l’unité de l’œuvre et de la trajectoire est un processus toujours en travail. L’auteure n’a pas pour ambition de contempler ses combats passés et en cours à partir d’un point de vue de Sirius. Car il s’agit toujours et encore d’apprendre à partir de lieux et de situations spécifiques. L’apprentissage par les lectures, l’écriture, les recherches, les combats politiques, est une expérience éthique qui permet de se rapprocher du divin, conformément à la tradition talmudique du lernen, que lui a transmise son père.

La pensée qui se déploie dans ces pages, à travers les combats politico-intellectuels autour du féminisme, du colonial, ou de la Palestine, est une pensée exilique, inspirée par Edward Saïd, dont Sonia Dayan-Herzbrun fut très proche. « C’est sans doute le fait de venir d’un monde qui n’existe plus, que je ne peux me représenter, et qui ne m’apparaît que comme manque, qui m’a jetée dans cette quête permanente, cette impossibilité de m’établir à l’intérieur d’un espace clos. Je qualifierais volontiers d’inquiétude, au sens étymologique, cette soif que j’ai de toujours apprendre, mais aussi cette impulsion à ne jamais rester purement spectatrice, et à intervenir dans le monde, si possible avec les autres ». Cette tension structurante entre la recherche de l’unité et la conscience « d’avoir été déplacée, d’être loin », mais de ne pas savoir d’où on est éloigné, fait écho à un autre type de variation, entre le récit des événements et des transformations internes – comme jeune femme, mère, épouse, amante, amie – et celui des engagements intellectuels et politiques. Les réflexions théoriques sur le féminisme, la race, l’islam, le décolonial, s’ancrent dans la vie et l’expérience et ne les surplombent pas.
L’un des fils rouges de ce récit est le combat féministe. « J’avais été élevée à la fois comme un garçon, sans initiation aucune aux tâches ménagères, et comme un pot de fleurs », se souvient l’auteure. Sonia Dayan-Herzbrun analyse comment cette double injonction à être aussi performante qu’un homme tout en gardant sa place de femme a affecté sa carrière universitaire, mais a également pu être une ressource pour une compréhension fine de la dialectique entre aliénation et liberté. Le livre s’ouvre sur le récit de l’occupation de la maison maternelle du Plessis-Robinson en 1971, lorsqu’elle a rejoint une mobilisation menée par Liliane Kandel contre ces institutions où l’on enfermait les mères adolescentes. Depuis cet engagement inaugural, où le féminisme était vécu de manière univoque comme une lutte contre le patriarcat, l’auteure raconte comment elle s’est heurtée à certaines conceptions étriquées des féministes. Elle évoque les multiples clivages au sein du féminisme universitaire, et les impasses du féminisme universaliste français notamment autour des questions d’islam et de laïcité. Dans le chapitre consacré au féminisme et à l’islam, Sonia Dayan-Herzbrun expose ses critiques de l’universalisme paternaliste d’une partie importante des féministes médiatiques en France aujourd’hui, et leur incapacité à appréhender la question de l’engagement religieux et de la piété des femmes autrement que sous l’angle de l’aliénation.
Au premier abord, le titre du livre de Sonia Dayan-Herzbrun évoque le mélange de perplexité et de mélancolie sous-jacent à la question que posait la chanteuse Peggy Lee : « Is this all there is ? » Mais c’est bien l’espoir et la jubilation de la quête qui dominent la déception, comme le résume cette anecdote : « Tous les ans, le soir de la célébration du Seder, où nous laissions une place à table pour le prophète Élie qui devait venir annoncer l’arrivée du Messie, à un moment de la prière, c’était moi, la plus jeune, qui allais ouvrir la porte de l’appartement pour éventuellement l’accueillir. C’était à chaque fois la même déception : il n’était pas là et il fallait continuer à attendre et à espérer ». La déception mène non pas à la mélancolie, mais à l’espoir et à l’action dans le monde, et, par ce biais, à la liberté. Rien qu’une vie fait apparaître l’immense précarité et le courage infini par lesquels la panique éprouvée par la toute petite enfant, en cette nuit de juillet 1942 – lorsque les gendarmes sont venus prévenir sa famille, alors réfugiée dans l’Hérault, qu’ils avaient vingt minutes pour faire leurs bagages avant d’être envoyés dans le camp de Rivesaltes –, s’est transformée en une rébellion éthique, une quête insatiable de savoir et de liberté. Oxymorique et prophétique, Rien qu’une vie donne à entendre cette « voix de fin silence » qu’entendit Élie, au creux de son rocher.