Le thème de la Heimat (qui n’est pas tant la patrie que le lieu natal) anime à partir de la seconde moitié du XIXe siècle toute la littérature autrichienne de langue allemande, devenue un signe de reconnaissance des individus dispersés dans les différentes identités nationales de l’immense empire austro-hongrois. C’est précisément au moment de sa dislocation que la Heimat apparaît avec le plus d’évidence et de force. Comme l’écrit Sebald dans sa préface. « Plus il est question de Heimat, moins elle existe. »
W. G. Sebald, Amère patrie. À propos de la littérature autrichienne. Trad. de l’allemand par Patrick Charbonneau, Actes Sud, 252 p., 22,50 €
Or c’est justement par un écrivain catholique prêtre devenu espion selon ses dires, bientôt de plus en plus hostile à l’Église que s’ouvre le livre de Sebald. En effet, Karl Postl, né en 1793 en Moravie, changera son nom en Charles Seasfield et séjournera de longues années en Amérique. Il est l’auteur de plusieurs récits en anglais dont le plus connu est Le Livre de la cabine qui a pour thème l’élimination inéluctable des Indiens, notamment au Texas ; il tient l’esclavage pour une bonne chose. Postl (Seasfiled) le « déraciné par excellence » considère néanmoins les Allemands comme la race supérieure, destinée à réparer les injustices de la nature. Cet aventurier paradoxal est une sorte de figuration ambiguë de l’errant.
Le « Nouveau monde » est au bout de tous ces voyages vers une Heimat impossible, si souvent incarnés dans des figures d’Émigrés, juifs en particulier. La perte sans retour est le lot des habitants juifs de l’Empire qui soudain libérés de leur enfermement dans la modernité se retrouvent désemparés à Vienne où la nécessité les oblige à s’affirmer
Ce sont surtout les écrivains d’origine juive et d’écriture allemande, plus ou moins ignorés aujourd’hui, tels Leopold Kompert ou Emil Franzos, ceux plus ou moins oubliés ou célèbres comme Joseph Roth et Peter Altenberg qui expriment particulièrement « le sentiment de rester attaché à ce dont on se sait irrémédiablement coupé. » Le Shtetl, la petite ville juive, occupe le fond des esprits. Les habitants de ces petites villes se retrouvaient soudain à Vienne, sans rien avoir su au Shtetl des changements fondamentaux en train de s’opérer dans la société autrichienne, si bien que ces personnages sont d’un coup jetés du Moyen-Age le plus profond dans la modernité. Dans le Shylok de Barnow, Emil Franzos dénonce les ténèbres cependant protectrices de l’orthodoxie qui va basculer dans l’ère bourgeoise comme dans « le sabbat de l’histoire de l’humanité ».
Ce n’est pas par hasard que ce Leopold Kompert, aujourd’hui parfaitement ignoré, écrit un récit intitulé Le colporteur qui retient l’attention de Sebald puisque la condition juive, celle de l’attachement d’autant plus fort au lieu natal qu’il est plus menacé, incarne au plus près le destin suicidaire de l’Europe. Ces récits de l’errance juive ont tracé la géographie d’une Europe en voie de disparition.
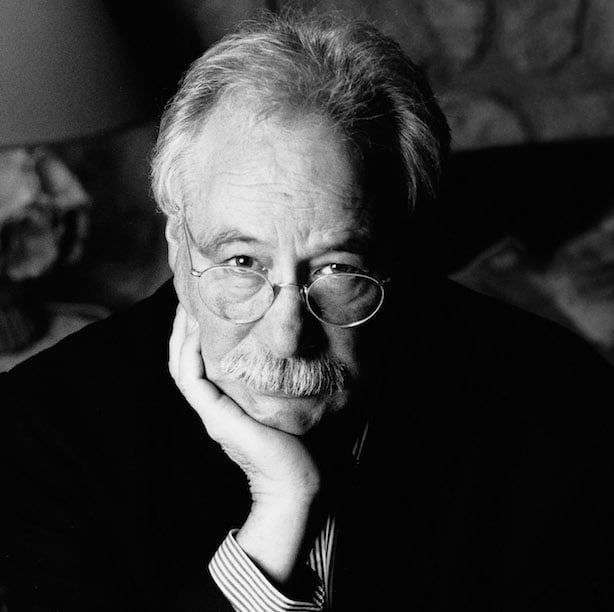
W. G. Sebald © John Foley/Leemage/Éditions Actes Sud
Mais les « histoires juives » ne sont pas le seul fait d’écrivains juifs, pour preuve, l’aristocratique Lepold von Sacher Masoch que l’on connaît pour d’autres raisons pas si éloignées, à cet égard, de cette problématique. Sebald suppose que l’empathie de Masoch pour la condition juive lui serait venue des visites que faisait son grand-père, premier médecin chrétien à travailler dans le misérable quartier juif de Lemberg (Lviv), très bien décrit par Alfred Döblin dans son Voyage en Pologne. Sebald, d’ailleurs, n’épargne pas le style convenu de Sacher Masoch aussi peu que, plus loin, le gonflement vide, le « kitsch » intellectuel de Hermann Broch, comme il l’écrit à propos du Bergroman (Le tentateur). Richard Engländer, lui, prend le nom de Peter Altenberg en hommage à cette petite ville, sorte de patrie qui représente pour lui une Autriche qui n’existe pas, lui qui fait de Vienne et de quelques Viennois les témoins de sa mélancolie.
Il n’est pas étonnant, dès lors, que le cheminement et les distances à parcourir tant réellement que symboliquement soient les motifs de base de toute cette littérature. Joseph Roth, comme nul autre, a fait l’expérience de la patrie perdue et de l’exil, à deux doigts du pogrom dont il repéra tous les signes précurseurs. Il ne passe plus nulle part inaperçu, pas plus à Vienne qu’à Berlin ou à Paris où il finit sa vie dans le plus complet dénuement ; Roth est le porteur même du destin européen en tant que figure absolue de l’exil juif.
K., le personnage du Château de Kafka, figure pour Sebald non l’impuissance, mais la possibilité de troubler l’autorité, rien que par sa persistance à être, à questionner. K. est celui qui délite le pouvoir ou pourrait le déliter. La présence de Klamm, le fonctionnaire du Château dans la cour de l’auberge signifie l’absence de K. La présence de l’un exclut celle de l’autre, le parcours est aussi vain qu’illimité. Pour Sebald, « Le destin de la famille Barnabas est une sociologie synoptique du peuple juif », exclu et exclusif dans sa visée messianique comme expression de son humanité.
Après des pages très sensibles consacrées aux œuvres de l’écrivain Gerhart Roth et à celle de Jean Améry qui finit par se suicider, détruit à jamais par la déportation dans son humanité même, Sebald termine son livre par une longue et belle description de ce que vise, peut-être, l’œuvre de Peter Handke, telle que la formule son récit Le Recommencement, le grand roman de libération de l’auteur à travers des transpositions fictionnelles. Handke tente de transcrire en écriture le visible et de réanimer une perception détournée d’elle-même par l’usage quotidien. Le roman confirme l’effort de Peter Handke pour prendre ses distances par rapport aux origines allemandes de son père. Tout son travail consiste, à bien des égards, à réapproprier la langue allemande à elle-même. Toute son œuvre vise à défaire la langue allemande de la perte irrémédiable qu’elle recèle.












