Ariane Dreyfus, une des poètes les plus lues aujourd’hui depuis Une histoire passera ici, en 1999, s’entretient avec En attendant Nadeau. Elle a fait entrer dans la poésie la danse, le cinéma, le cirque et le jeu des enfants.
Ariane Dreyfus, Le dernier livre des enfants. Flammarion, 16 €, 192 p.
Le premier livre d’Ariane Dreyfus a été publié en 1993, mais c’est Une histoire passera ici qui, en 1999, a fait d’elle un des poètes les plus lus aujourd’hui. Sans rien céder sur le plan de l’exigence, elle s’est immédiatement singularisée en prenant le contre-pied de « ce qui se faisait alors ». Là où les poètes parlaient à un double perdu quelque part sur sa spirale intérieure ou bien parlaient dans l’absolu, elle s’est adressée à un lecteur contemporain et cultivé. Alors que les références des œuvres étaient surtout tirées de la littérature, de la philosophie et des arts plastiques, elle a fait entrer la danse, le cinéma, le cirque et le jeu des enfants. Là où l’érotisme était presque exclusivement nourri du désir masculin, elle a su (avec quelques autres) imposer les sensations et les émotions féminines plus disposées à « accepter le corps » de l’autre qu’à le prendre.
Dix livres plus tard, avec Le dernier livre des enfants, elle s’engage plus loin dans l’exploration du poème narratif. Loin de s’emparer de grandes histoires portant en elles de quoi soutenir l’attention, dans un univers qui a conscience de la venue prochaine du crépuscule, elle forge une écriture capable de porter haut des détails, des actes insignifiants aux yeux de l’époque. Á sa manière, elle relève le défi de parler des trains qui arrivent à l’heure pour mieux mettre en évidence la chance de vivre et les conditions de survie de l’humain dans un monde dont elle ne cache pas la violence. Notamment celle qui s’exerce sur les femmes.
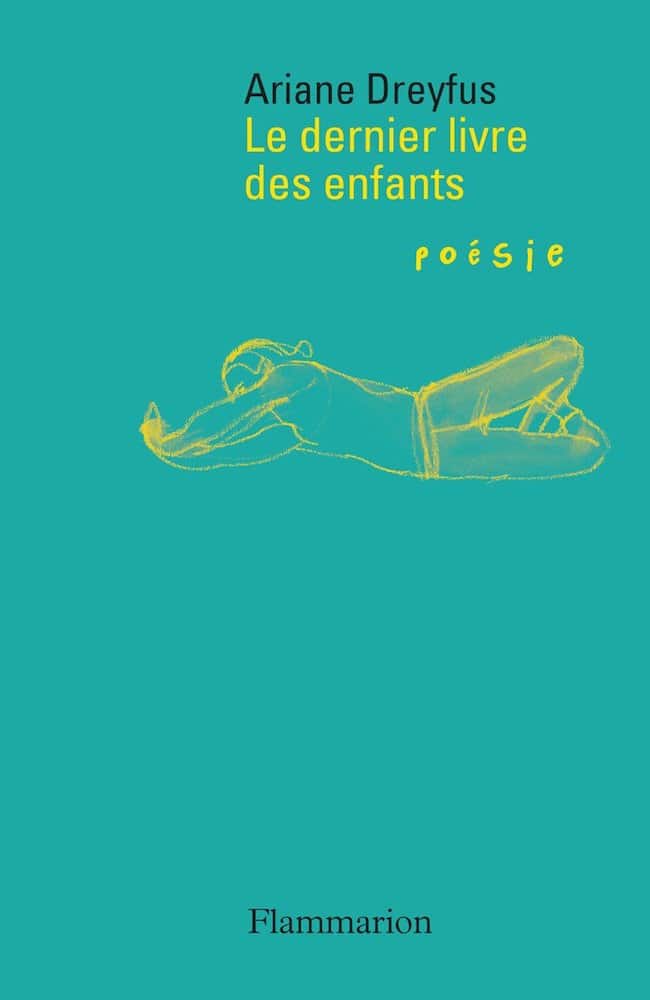
Du côté déchiré
Le ruban noir s’envole, il remue au-dessus du visage
Ses courbes aiment le vide généreux du ciel
Où le vent passe aussi, d’une main je le tiens
Le ruban vivant
Je le regarde comme moi-même ne suis pas épuisé
J’avance un peu plus, encore une heure et ce sera la nuit
L’inévitable sente mais là,
Dans ma main s’agite la joie du ruban noir (Le dernier livre des enfants)
Peut-on dire que ton désir de raconter, au lieu de t’amener à abandonner certaines contraintes propres à l’écriture poétique, les rend plus fortes, voire obsédantes ?
Il les rend en tout cas plus indispensables, si je ne veux pas tomber dans la platitude. D’autant plus que, pour des raisons que je ne m’explique pas moi-même, j’ai un vocabulaire extrêmement pauvre. Il est vrai que je fuis les termes trop littéraires ou trop flous, trop évidemment poétiques, sauf à les travailler pour les rendre plus immédiats en les revivifiant par le prosaïsme ou un contexte surprenant, comme dans : « Pour l’instant, seul le lilas a mouillé ma main [1] ». Cela dit, j’aime parvenir à faire entrer dans ma poésie des mots qui y sont inédits, tels, dernièrement, cuvette, confiture, crème solaire… Je ne dis pas que ces mots n’ont jamais été employés par aucun poète, mais le prosaïsme n’est pas chez moi un but en soi, il n’est pas là pour faire redescendre la poésie sur terre, la désacraliser, plutôt, comme tu le dis très justement, afin de « porter haut des détails, des actes insignifiants ». Ainsi, la confiture doit être merveilleuse, émouvante, appeler quelque chose en nous : « Le pot ouvert la confiture brille [2] ». Ce n’est pas la poésie que je veux élever, mais la réalité, par la part de rêverie et de partage que je tente d’y infuser [3]. Ce qui nous ramène au narratif : je raconte pour élargir et rendre commune l’expérience humaine concrète, temporelle (et donc mortelle), la rendre plus vivante aussi, tout autre projet me semble vain. Me voilà donc à tenir deux bouts très difficiles à maintenir ensemble : être claire et étonner ; maintenir un ton naturel et trouver une place « fraîche sur l’oreiller », comme je le dis souvent, pour dire des choses très communes en fait.
Alors bien sûr le découpage en vers, ou en versets, les blancs aussi, l’absence ou pas de ponctuation, jouent un rôle important, d’autant plus que je veux qu’ils correspondent le plus possible à la lecture qu’on ferait à voix haute. Ils doivent, mais sans « torturer » la langue, introduire plus de « vif » et de complexité, c’est-à-dire de feuilletage de sens. Quand j’écris, à propos d’une petite fille qui s’enroule dans un rideau [4] :
Elle est venue, l’air recommence le long d’elle, il ne faut plus
Bouger, en pleine chrysalide
le rejet de « bouger » ajoute à l’interdit de se mouvoir, à l’affirmation du désir de le faire, à la promesse qu’il représente si on attend, promesse que la majuscule pose en face de soi ; en d’autres termes, l’attente donne des forces.
Il y a les contraintes d’écriture mais aussi de construction du livre…
Oui, bien sûr. Il y a les miroitements que je tente d’établir entre les poèmes, qui relèvent de récits à la fois voisins et solitaires. Au lecteur de savoir s’il veut les envisager plutôt dans l’une ou l’autre perspective. J’espère seulement que viendra un moment où il essaiera d’appréhender mon livre (et là je parle de tous) dans sa progression, qui est pour moi vitale, au sens fort, autant à l’échelle du poème que de l’ensemble que constituent poèmes, titres de parties et citations. Dans le cas particulier de mon dernier titre, il y a aussi ce livre dans le livre que sont les onze poèmes consacrés au roman et au film Cyclone à la Jamaïque, répartis tout au long du recueil, et qui en sont, si j’ose dire, la moelle épinière. Je les voulais encore plus à vif que les autres, d’où le choix du vers court, très court, mais sans cesse débordant et syntaxiquement troublé, et en même temps il me fallait ne pas semer en route ou décourager un lecteur qui, en général, ne connaît absolument pas ces deux œuvres. C’est d’ailleurs une des grandes difficultés de ma façon de faire : partir d’une photo, d’un spectacle, d’un film, ou ici d’un roman, sans que cette source manque au lecteur. Un poème peut ainsi nécessiter des années de « remise sur le chantier ».
Même si les contraintes éditoriales m’ont empêché de choisir ces poèmes longs et souvent articulés en facettes qui forment l’essentiel de ton livre, pourrais-tu nous faire entrer dans le chantier du poème cité ?
Si le vers qui ouvre le livre est : « J’écris parce que je vais disparaître », le dernier est : « Dans ma main s’agite la joie du ruban noir ». Ce poème final, « En quittant la plage », est, avec le premier, le plus ancien du recueil. Il est vraiment un « don du ciel », dans tous les sens du mot « ciel » : un soir, en effet, en remontant de la plage, j’avais constaté qu’un ruban de ma natte de plage s’était décousu, et virevoltait au vent, sous le ciel encore bleu. Ce petit ruban innocent, soudainement si vivant, j’ai eu envie de lui donner un poème. Ce vers final, qui fait danser en l’air la couleur de la nuit et du deuil, contient la même ambivalence que le titre Le dernier livre des enfants. Non que je souhaite que ce soit mon « dernier livre », mais on rêve toujours que le livre que l’on est en train d’écrire soit si juste qu’il en devienne définitif. C’est dire aussi que je suis proche de ma fin, que je suis mortelle, et en ce sens je passe la main aux enfants du titre, à mes personnages enfants, ainsi qu’aux enfants dont je cite les phrases écrites en atelier d’écriture avec moi, à partir d’une consigne leur demandant d’y insérer « pour ne pas mourir [5] ». La mort est donc dans ce livre un horizon à la fois permanent et constamment surmonté par à-coups.
En ce sens, tout le recueil est l’illustration de cette phrase de Michel Tournier, où je me retrouve tout à fait : « Pour l’enfant, une histoire qui se termine mal est une histoire qui ne se termine pas du tout. Il demande la suite aussi longtemps que tout n’est pas rentré dans l’ordre. »
Pour en revenir à ce dernier poème, je l’aime aussi parce qu’il se tient à la lisière exacte du littéral et du symbolique : il s’agit d’un vrai ruban, que j’ai d’abord tenté de décrire tant je l’ai immédiatement aimé, mais qu’il soit noir m’est très vite apparu comme essentiel – les premiers mots qui me sont venus à son propos, et qui resteront dans la version finale, sont : « Le ruban noir s’envole ». Et si finalement ils seront précédés de ce premier vers : « Du côté déchiré », cela ne fait qu’accentuer cette double dimension : ce « côté déchiré » n’appartient pas seulement à ma natte de plage, il est aussi le rappel que toute vie doit se détacher et s’en aller, ou que tout être doit vivre des déchirements, sans compter que j’aimais cette idée d’un dernier poème qui s’évade du livre. Mais, bien sûr, je ne devais jamais perdre de vue ce qui ancre ce poème, peut lui donner de la justesse : ce souci de faire voir cet objet, sa façon de se mouvoir, de se détacher sur le ciel.
Pour arriver à dire le ciel, il y a eu tout un cheminement : d’abord, je ne l’ai pas qualifié, il me semblait que « dans le ciel » convenait à la respiration offerte au ruban mais, au fur et à mesure des versions, j’ai eu envie de ne pas m’arrêter là, de rendre hommage à cet espace sans lequel ce ruban n’aurait pas été le même. Voici donc ce parcours (que je simplifie dans ce qui suit, car je travaillais conjointement d’autres éléments, notamment le vent…) :
Le ruban noir s’envole, il remue dans la beauté du ciel
Le ruban noir s’envole, il remue dans le ciel immense
Le ruban noir s’envole, il remue au-dessus de mon visage
Ses courbes s’ajoutent au vide du ciel
Ses courbes aiment le ciel pour son vide tout bleu
Ses courbes aiment le ciel pour tout le vide généreux
Ses courbes aiment le vide généreux du ciel
Comme on le voit, les deux premières propositions sont trop banales, les suivantes trop alambiquées au contraire. La dernière par contre se déroule avec plus de naturel, et a l’avantage à mes yeux de dire – on ne le répétera jamais assez – combien le monde irait mieux sans Dieu, respirerait, combien sans lui on a tout ce qu’il nous faut !
Propos recueillis par Gérard Noiret
-
Le dernier livre des enfants, p. 128.
-
Ibid., p. 67.
-
J’ai vraiment été formée par Colette et Cocteau !
-
Poème en cours de travail.
-
Consigne inspirée par un long poème de Patrick Dubost, extrait de Cela fait-il du bruit ?












