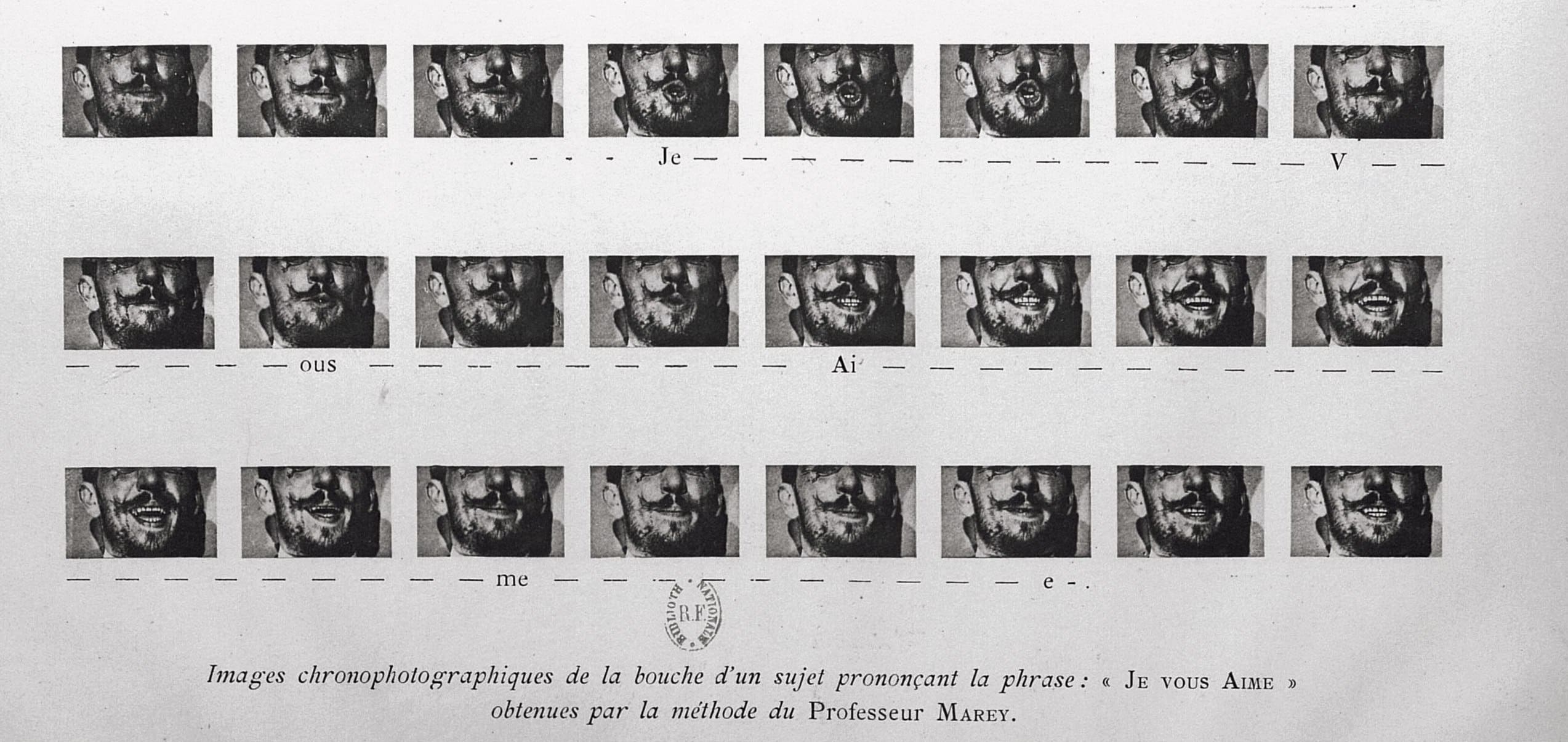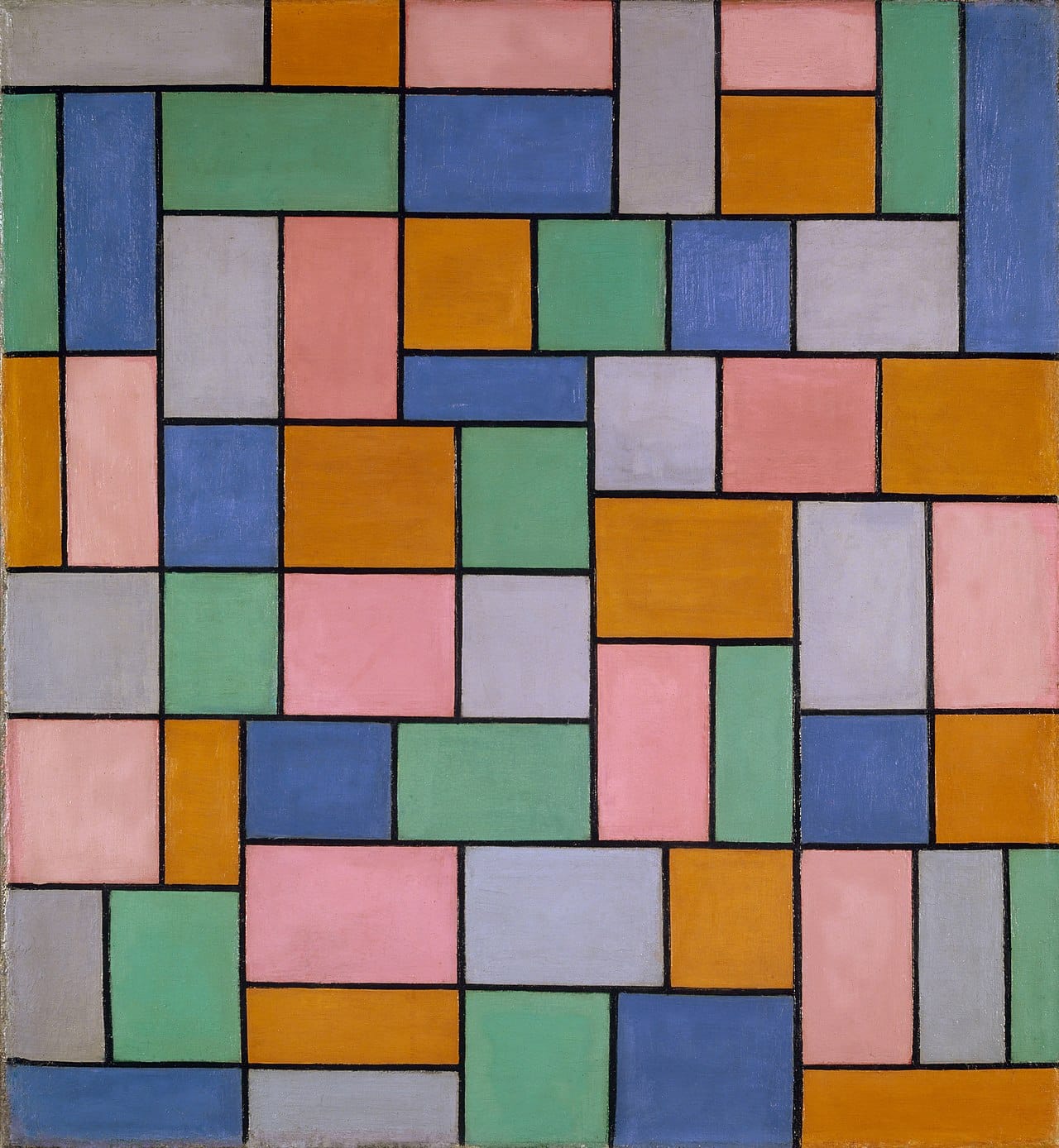Dans Le pouvoir des mots, dont vient de paraître une version augmentée, Josiane Boutet, pionnière de la sociolinguistique en France, défend « une conception actionnelle du langage envisagé centralement comme une pratique sociale ».
Josiane Boutet, Le pouvoir des mots. La Dispute, 260 p., 16 €
Elle s’oppose ainsi aux « conceptions technicistes ou instrumentales de la communication verbale qui voudraient la réduire à un pur transfert d’informations entre des êtres libres, conscients et égaux ». Bien sûr, il y a longtemps qu’on s’est aperçu que le langage n’avait pas qu’une fonction référentielle et que son rôle pragmatique était essentiel ; mais le mérite principal de ce livre est de mettre l’accent sur la dimension politique de ce que l’auteure appelle les « pratiques langagières ».
Si la langue, contrairement à ce qu’affirma Roland Barthes dans sa Leçon (1977), n’est pas par nature « fasciste », il arrive qu’on essaie de lui donner ce caractère. Dans 1984 de George Orwell, le pouvoir entend exercer, au moyen d’un appauvrissement syntaxique et lexical, un contrôle rigoureux sur les significations : pas d’ambiguïtés ni de synonymes.
Dans le même ordre d’idée, Le pouvoir des mots nous apprend que le maréchal Pétain avait une théorie linguistique, qu’il a formulée avec précision : en particulier, il rejetait résolument les adjectifs (« ces ceintures de soie que portent les officiers dans les armées d’opérette ») ; quant au point-virgule – qui, souvent, suggère plus qu’il n’assène le lien qu’il établit entre les propositions qu’il juxtapose –, le Maréchal le traitait de « bâtard ».
La tyrannie parvient à changer la valeur ou le sens de certains mots. Selon Victor Klemperer, qui a étudié la langue du Troisième Reich, celle-ci n’a pas produit de mots nouveaux mais elle a réussi, notamment, à associer à « fanatique » une connotation laudative (l’évolution inverse – vers le péjoratif – est beaucoup plus fréquente dans la vie des langues). D’autre part, la LTI (Lingua Tertii Imperii) a donné une importance inédite aux mots « organiser », « organisation », ce dernier supplantant totalement le terme de « système ».
La langue, peut-être, serait fasciste si elle ne comportait pas deux dimensions fondamentales : la synonymie (plusieurs mots pour un même sens) et la polysémie (plusieurs sens pour un même mot). Le choix – que permet la synonymie – d’une désignation parmi d’autres a souvent une portée politique. Josiane Boutet évoque à plusieurs reprises la distinction entre les « cotisations sociales » et les « charges sociales », deux façons de nommer une même réalité et deux regards complètement différents sur cette réalité.
Dès lors, pour reprendre l’opposition classique de Frege, les synonymes ne partagent pas tant un sens qu’une référence : ils renvoient à la même chose (si l’on admet que le changement de dénomination ne modifie pas la chose elle-même) par des chemins distincts, voire opposés. Le sens, pour Josiane Boutet, est social et non pas commun. Elle cite une affiche du Réseau Éducation sans frontières (RESF) : « Ils ont leurs mots. Nous avons les nôtres. » Dans chaque mot, dans chaque phrase, il y a une injustice repoussée ou admise. À chaque instant, le langage nous enjoint de trouver le mot, l’expression juste.
Albert Camus aurait dit : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. » Josiane Boutet souligne l’embarras qu’ont suscité la désignation de la guerre d’Algérie (« événements », « opération de maintien de l’ordre », « insurrection »…) ou celle des « enfants d’immigrés » : « La seule nomination qui ne pose aucun problème de catégorisation est de les considérer seulement comme des “Français”. »
On parlait des attentats du 11 septembre 2001 ; il a fallu que la France soit frappée à son tour pour que ce substantif inapproprié à de telles circonstances soit concurrencé par une expression comme « crimes de masse ». Mais il est vrai aussi que nommer, c’est faire exister : « et j’ai dû apprendre à mes dépens que la chose n’existe pas, là où le mot fait défaut » (Stefan George) ; inversement, quand on veut conjurer un mal, on écarte parfois le mot qui le désigne. La pensée magique n’est pas loin, mais ceci est une autre histoire (que Josiane Boutet aborde aussi dans ce livre).
Un chapitre très intéressant a trait à ce que l’auteure appelle le « retournement du stigmate » : la façon dont une appellation dépréciative est revendiquée par ceux-là mêmes qu’elle a pris pour cible. Ce fut le cas pour les sans-culottes : « Un mot trivial, méprisant, devient en quelques années le symbole de l’éthique populaire, de la vertu sociale, des valeurs républicaines. » C’est encore le cas des beurs et des Indigènes de la République, entre autres. Ailleurs dans le livre, Josiane Boutet évoque les canuts et le concours qu’avait lancé un journal lyonnais en 1832 pour leur trouver une nouvelle désignation, la leur étant devenue insultante. Finalement, ce n’est pas le mot « canut » qui a disparu, mais la connotation péjorative qui lui était accolée.
La langue n’est pas fasciste parce qu’elle est remplie d’ambiguïtés, grâce en particulier à la polysémie (qu’on peut ici ne pas distinguer – c’est d’ailleurs quelquefois un exercice difficile pour les lexicographes – de l’homonymie). La polysémie, grande pourvoyeuse de jeux de mots, est une arme de résistance très efficace. Le caractère subversif, libérateur, de l’humour lui doit beaucoup. L’auteure cite ce slogan datant des années soixante : « Quand les parents boivent, les enfants trinquent. » Pourquoi cette formule est-elle tellement bien trouvée ? Parce que le verbe « trinquer » est utilisé ici dans son acception familière (subir un dommage), mais dans le champ lexical – celui de la consommation d’alcool – de son sens principal. La force du slogan réside dans l’adéquation de ce rapprochement au contenu qu’on veut transmettre.
De même, ce slogan du MLF : « Un homme sur deux est une femme. » On ne peut s’empêcher d’y entendre « homme » et « femme » comme l’opposition du masculin et du féminin. Mais on comprend presque au même moment qu’« homme » est pris ici au sens où il embrasse la femme. Là aussi, l’emploi d’un mot dans l’une de ses deux acceptions s’accompagne de l’évocation de son autre acception. L’homonymie peut également mettre en jeu des noms propres, d’où ce cri du cœur entendu du temps du ministère de Luc Ferry : « Ferry, t’es pas mon Jules ! »
Dans sa Leçon, Barthes citait comme symptôme du caractère fasciste de la langue l’obligation « de toujours choisir entre le masculin et le féminin, le neutre ou le complexe me sont interdits ». Mais, lors des manifestations contre le CPE (« contrat première embauche »), en 2006, un autocollant a fait vaciller cette contrainte : « Rêve générale ». Ceux qui, trop respectueux de la grammaire, ont préféré corriger en accordant en genre l’épithète avec le nom ont affaibli leur message et ruiné la « suspension du sens », comme dit Josiane Boutet, que provoquait la coexistence du « rêve » et de la « [grève] générale ». Dans ce cas, il ne s’agit plus d’homonymie mais de paronymie (laquelle peut se définir comme une homonymie incomplète).
Plus sans doute que sur la littérature (Barthes donnait ce nom à la « tricherie salutaire […] qui permet d’entendre la langue hors-pouvoir »), à laquelle rien n’interdit d’être servile, c’est sur la langue elle-même en ses multiples usages qu’on peut compter pour ne pas verser dans le fascisme.