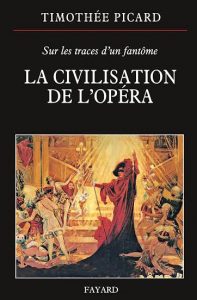 « C’était riche, c’était beau, c’était complet. » La formule de l’architecte Charles Garnier à propos d’un opéra qu’il venait d’entendre, pourrait s’appliquer adéquatement au livre de Timothée Picard. Maître d’œuvre d’un Dictionnaire encyclopédique Wagner chez Actes Sud, auteur également de substantiels travaux sur « l’utopie de l’art total », Timothée Picard manifeste un goût certain pour les ouvrages d’un volume impressionnant. Son dernier livre sur « la civilisation de l’opéra » ne déroge pas à la règle, avec ses 700 pages, d’une étourdissante érudition. Il serait bien délicat d’en rendre compte si l’auteur, dans un utile post-scriptum, ne donnait pas la clef de son entreprise : ce livre est « animé par un souci inquiet » : celui d’« embrasser tout un pan de civilisation qui paraît menacé ».
« C’était riche, c’était beau, c’était complet. » La formule de l’architecte Charles Garnier à propos d’un opéra qu’il venait d’entendre, pourrait s’appliquer adéquatement au livre de Timothée Picard. Maître d’œuvre d’un Dictionnaire encyclopédique Wagner chez Actes Sud, auteur également de substantiels travaux sur « l’utopie de l’art total », Timothée Picard manifeste un goût certain pour les ouvrages d’un volume impressionnant. Son dernier livre sur « la civilisation de l’opéra » ne déroge pas à la règle, avec ses 700 pages, d’une étourdissante érudition. Il serait bien délicat d’en rendre compte si l’auteur, dans un utile post-scriptum, ne donnait pas la clef de son entreprise : ce livre est « animé par un souci inquiet » : celui d’« embrasser tout un pan de civilisation qui paraît menacé ».
Timothée Picard, La Civilisation de l’opéra. Sur les traces d’un fantôme. Fayard, 616 p., 35 €.
Pour illustrer cette confrontation entre l’écrasante tradition de l’opéra et une culture mainstream aujourd’hui triomphante, il a choisi de prendre pour guide Le Fantôme de l’opéra, le feuilleton publié en 1910 par Gaston Leroux, ce « produit de la culture populaire (…) travaillé par des traits élitiste et nostalgiques » et dans lequel Walter Benjamin, dans Sens unique, a cru voir « un des grands romans sur le XIXe siècle ». Cette œuvre a en tout cas aux yeux de Timothée Picard le double intérêt de combiner nombre des leitmotive de l’imaginaire « opératique » de la tradition tout en bénéficiant d’une exceptionnelle transposition dans le « divertissement populaire » avec The Phantom of the Opera, la comédie musicale à succès du compositeur Andrew Lloyd Webber (1986).
On connaît les éléments de l’intrigue un peu ironique du Fantôme de l’Opéra : le grand lustre qui s’effondre, le machiniste qui se pend, la loge n° 5 qui chuchote, Christiane, la cantatrice au talent mystérieux, qui disparaît, Raoul, l’aimable vicomte, et, errant dans les coulisses, les cintres et les caves, le « fantôme » amoureux, Erik, un ancien monstre de foire, un freak magicien, qui médite sa vengeance. Partant de là, l’ouvrage de Timothée Picard n’est pas sans ressemblance avec le bâtiment même qui donne son cadre à ce roman : comme le Palais Garnier, il parvient à réunir plusieurs niveaux reliés entre eux par un réseau complexe d’escaliers, de transitions et de passages, dont le fameux grand escalier, qui assure en fait une circulation fluide dans ce labyrinthe.

Au premier niveau, à l’orchestre, Timothée Picard analyse, grâce aux éléments narratifs qu’il emprunte au roman même, l’ « imaginaire de l’opéra » – les miroirs, les divas, les caprices, etc. – en convoquant un vaste corpus d’œuvres connues ou inconnues (mais dont chacune est résumée) ; l’amateur d’opéra trouvera une surabondance d’intéressantes références littéraires : Hoffman, Balzac (Les Comédiens sans le savoir), Alexandre Dumas (Le Comte de Monte-Cristo), mais aussi Michel Leiris, Julien Gracq, etc.. Surabondance un peu étoudissante, il est vrai, et l’on se prend à rêver à une véritable « anthropologie structurale » de l’opéra, qui organiserait, de manière plus réglée, à la manière de Lévi-Strauss, les variations de ce mythe.
Mais c’est à l’étage supérieur des corbeilles et des loges que Timothée Picard donne son armature théorique à l’ouvrage avec des réflexions assez largement inspirées de Walter Benjamin et Herman Broch sur le kitsch et le « reste d’aura » sacré qui s’attache à lui. Il retrouve naturellement à cette occasion la question de Bayreuth, le temple de l’œuvre d’art totale vers lequel converge en pèlerinage une confrérie internationale d’avance conquise, mais temple qui, pour le visiteur un peu sceptique, comme Nietzsche ou Colette dans Claudine s’en va, est vite démythifié par la « saucisse Wagner » et le commerce des produits dérivés. Où est le « théâtre du peuple » dont avait rêvé Wagner lui-même ?
Au dernier étage, on trouve une interrogation de nature presque politique sur les relations entre l’opéra, art sans conteste jusqu’ici réservé à une certaine élite sociale et culturelle, consciente de ses codes, comme le montre avec force Jack London dans Martin Eden, et la culture de masse qui s’impose partout en recyclant à son profit les références mythiques qu’elle lui emprunte. « Je rêve d’un Opéra aussi libre et populaire qu’une salle de catch ou de cinéma », écrivait Roland Barthes dans « Fantômes de l’Opéra », cité en exergue. Laissons prudemment de côté, comme Timothée Picard, la question du caractère plus populaire de l’Opéra Bastille.
Loin de céder à un pessimisme culturel un peu facile (mais inévitable pour un lecteur d’Adorno), Timothée Picard ouvre, dans une longue troisième partie très informée, le dossier exemplaire des innombrables adaptations musicales et cinématographiques du Fantôme de l’Opéra – non seulement celle d’Andrew Lloyd Webber, mais encore celle, la première, de Rupert Julian, dès 1925, celle de Brian de Palma (Phantom of the Paradise, 1974), les versions chinoises, italiennes, etc. Se pose alors, au terme de cette recherche approfondie, la question de la vie, ou de la survie, aujourd’hui, de l’opéra comme art bourgeois, élitiste, voire snob, mais inscrit dans la continuité des grands mythes littéraires, expression d’une civilisation à son apogée, mais minée par ses contradictions. Et la conclusion de Timothée Picard peut surprendre. « Coup de théâtre ! Au terme de ces pages le lecteur découvrira que, pareil au personnage de Leroux, le revenant n’en est pas un, et que l’opéra est bel et bien vivant. »
La dédicace qui renvoie aux « années passées au Chœur d’enfants de l’Opéra de Paris » révèle la dimension personnelle de cette ample défense et illustration critique de l’opéra. Dès l’enfance Timothée Picard a été familier des « ors de ce vaisseau de luxe », dont il a aussi exploré sans trembler les arcanes inquiétants et, manifestement, le souvenir très intime de la première fois, de l’enchantement de l’initiation, explique l’attachement de Timothée Picard à cet art fantôme, qui fait preuve d’une si surprenante résilience.











